Pour
le vocable "premières palatalisations", voir ci-dessous premières
palatalisations.
Les questions de yod (
Le système phonique du latin classique contenait les
Bien qu'elles soient transcrites avec les mêmes lettres, elles sont
différentes des voyelles i et
u. Pourtant des alphabets plus
anciens contenaient bien deux caractères spéciaux pour yod et waw (yod
et digamma, ci-dessous).
Par exemple, dans l'orthographe latine avvncvlvs "oncle maternel", on éprouve une gêne à la lecture si on n'est pas habitué (VV) ; mais justement à la prononciation, on se rend bien compte que waw est différent de u : /awʋnkʋlʋs/. Le premier V est en position de consonne : intervocalique ; le deuxième V est en position de voyelle : interconsonantique. Voir ci-dessous "on repère yod et waw à leur position dans un mot".
(Velius Longus, orth. IV.3.1) Ex his vocalibus quae apud nos sunt, duae litterae et vocalium vim et consonantium obtinent, ‘u’ et ‘i’.
"Parmi les voyelles présentes dans notre alphabet, deux lettres possèdent la nature des voyelles et des consonnes, u et i" (VLDO:32, trad.it.)
L'alphabet latin provient de l'alphabet étrusque, lui-même provenant d'une variante ancienne de l'alphabet grec (lui-même provenant de l'alphabet phénicien).
(
Ainsi il a existé en grec très ancien deux caractères pour retranscrire waw et yod :
Le digamma : ϝ (< consonne phénicienne waw) a été utilisé par les
grecs, mais le phonème /w/ a disparu des dialectes grecs au cours du
premier millénaire avant J.-C. (
(L'alphabet étrusque a utilisé le caractère digamma (ϝ) pour transcrire le phonème /f/ ; c'est l'origine du caractère F, Wikipédia).
(Quintilien inst. 1, 4, 7-8) sed proprie in Latinis : [8] ut in his ‘servus’ et ‘vulgus’ Aeolicum digammon desideratur
"mais dans les mots purement latins, comme servus et vulgus, où le besoin du digamma éolien se fait sentir" (QPLJ;16, ŒCQ1:37-38).
Voir aussi ci-dessous le groupe consonantique RV.
Caractère yod : son histoire
est plus complexe, mais elle est semblable à celle du digamma (voir
Donc du fait de son histoire, l'alphabet latin ne disposait plus de
caractères spécifiques pour retranscrire /
Les linguistes hésitent sur le statut phonétique de
IPHAF:33 : "une voyelle met en jeu principalement
les muscles abaisseurs de la langue, une consonne les élévateurs. Il n'y
a donc pas de moyen terme". IPHAF:34 : à propos des éléments brefs de
diphtongues i̯ et ʋ̯ , qui sont différents de yod et de waw : "si donc
on tenait à conserver l'appellation de "semi-voyelles", c'est à ces
sons, et à eux seulement, qu'elle pourrait en toute rigueur convenir".
Selon (IPHAF:76), le système phonique du latin exigeait
que
- yod à l'initiale est renforcé en
- yod à l'intervocalique est
(Dans l'espagnol actuel, dans yo,
llamar... certains hispanophones prononcent à peu près
(voir notamment
● (Velius Longus, orth. IV.3.1, en parlant de la lettre i) illud sane animadvertendum, hanc eandem litteram non numquam pro duabus consonantibus sonare, si modo <priori et> sequenti vocali interjecta sit
"cependant il faut signaler que cette même lettre peut parfois sonner à la place de deux consonnes si seulement elle est placée entre deux voyelles" (VLDO:33, trad.it.)
● (Quintilien Inst. 1, 4, 11) Sciat etiam [grammaticus] Ciceroni placuisse ‘ajjo’ ‘Majjam’que geminata I scribere : quod si est, etiam jungetur ut consonans.
(prop.tradu.) Il devrait aussi savoir [le grammairien] que Cicéron préférait écrire ajjo et majja avec j
● (Velius Longus De Orthographia 54.16) et in plerisque Cicero videtur auditu emensus scriptionem, qui et Aiiacem et Maiiam per duo i scribenda existimavit.
(traduction
Et le plus souvent Cicéron semble s'être laissé guider par l'oreille en écrivant ; c'est pourquoi il estimait qu'il fallait écrire Ajjax et Majja avec deux j [I des latins].
● Dans les incriptions ou dans les manuscrits, l'orthographe de nombreux mots témoignent aussi de cette gémination du j intervocalique (PHL4 :106) : cujjus, ejjus, majjorem (CIL, II, 1964), ajjunt (Plaute, Merc. 469 dans le palimpseste ambrosien), etc.
On peut faire la même constatation dans la
(PHL4 :106) "Enfin, l'italien maggiore
peggiore suppose comme ancêtres latins majjōrem,
pejjōrem avec un j
double".
On peut comparer ces mots avec l'italien correggia (< cŏrrĭgĭăm). Que doit-ton déduire de ragione "raison", stagione "saison" où le g n'est pas géminé (< rătĭōnĕm, stătĭōnĕm) ? (à étudier).
Le
- soit vers
- soit vers
À l'écrit, les latins ne distinguaient pas yod et waw respectivement des voyelles i et u. Ils écrivaient simplement I et V. (Alors qu'en grec très ancien et en étrusque, le digamma ϝ a été utilisé pour retranscrire waw). Certes yod et i, waw et u sont très similaires deux à deux. Cette norme graphique des latins entraîne des ambiguïtés nombreuses notamment dans les cas "consonne + V + voyelle" (voir ci-dessous après consonne et devant voyelle, I et V ont des valeurs variables).
Pour résoudre les ambiguïtés, les manuels et les dictionnaires
retranscrivent
Par ailleurs il faut signaler que de nombreux linguistes utilisent des lettres indifférenciées minuscules : u pour tout V latin, i pour tout I latin.
(PHL4:9 §7.II.2°) « [...] L'emploi des
caractères j et v est moderne ; leur introduction est
due aux humanistes et notamment au philosophe et grammairien français
Petrus Ramus (Pierre La Ramée, 1515-1572), d'où le nom de "lettres
ramistes" qu'on leur donne quelquefois. »
Les manuels modernes ont tenté de résoudre les ambiguïtés de l'alphabet
latin en transcrivant waw par v
et yod par j. Mais leur choix
est litigieux dans plusieurs cas.
"Les Latins en leur écriture ne différenciaient pas plus le v de l'u que le j de l'i ; d'où résulte une confusion que les transcriptions modernes n'ont pas toujours réussi à débrouiller, tout en prétendant distinguer la consonne de la voyelle par des signes différents." (GCLC:195).
• cas où v des manuels est en fait ŭ
- Pour malvă "mauve (plante)", le véritable mot semble bien être malŭă (IPHAF:144) : l'influence des dérivés actuels a sans doute poussé les rédacteurs à écrire malvă.
Par ailleurs dans FEW:1-322, bēlŭă,
bĕllŭă "gros animal" (d'où l'a.fr.
savant bellue "bête féroce")
est considéré comme belva ;
mais il s'agit bien de bēlŭă, bĕllŭă.
(voir ci-dessous).
• cas où ŭ des manuels est en fait v
- Pour le groupe SV suivi de a, e en début de mot, V a toujours la valeur waw : suāvĭs "doux", suādēre "conseiller", également dans les mots composés (persuādēre "persuader"...) (voir ci-dessous).
"La conclusion serait d'écrire svadere, svavis, si l'on pouvait avoir la prétention de modifier des habitudes prises" (GCLC:196).
- Pour le groupe NV, les formes gĕnuă "genoux", tĕnuĭs "ténu" sont les deux seuls cas connus où u est en fait v (voir ci-dessous).
- Pour le groupe DV, les mots duellŭm
"guerre", n.pr. Duilĭŭs sont les deux seuls cas
connus où u est en fait v (voir ci-dessous).
- Le groupe QV est toujours un
• cas où ŭ
des manuels est en fait ŭv :
Voir ci-dessous consonne + uv + voyelle (plŭĕrĕ est en fait plŭvĕrĕ).
• cas où ĭ des manuels est en fait j :
- Les manuels écrivent Pompēĭŭs
"Pompée" alors qu'on devrait écrire Pompējŭs.
De même pour Pompēĭī (la ville
de Campanie) qu'on devrait écrire Pompējī
.
- Dans les cas
Comme yod et waw sont des consonnes, on les trouve naturellement
surtout à l'initiale et à l'intervocalique (IPHAF:143 pour waw). En latin, yod et waw se
trouvent en
(Étudier aussi Touratier : QPPPi !)
Christian Touratier (CIAPuL:233) donne une première approche :
"Le latin note par une lettre u
(ou i) deux sons reconnus
comme différents par les grammairiens latins eux-mêmes, à savoir la
consonne [w] (ou [j]) et la voyelle [u] (ou [i]). Et tout le problème
consiste à savoir si [w] et [u] (ou [j] et [i]) fonctionnent comme deux
En effet imaginons que v et u français soient réunis en un seul
v, on aurait par exemple :
"bévve, vevve, nevve, vvvlaire, vvlvaire, vlve, vvlve, vovlve, volve,
évolve". Avec un peu d'expérience, on arrive à lire "bévue, veuve,
neuve, uvulaire, vulvaire, ulve, voulue, volve, évolue" : on peut donc
prédire la valeur de v. (Cela
ne signifie pas pour autant que [u] et [v] soient les
Exemples : iocari "jouer", vinvs "vin".
En début de mot, la distinction entre uv-
et vu- peut ainsi être
délicate à la lecture : vvlpes
vulpēs
"renard", et vvidvs
ūvĭdŭs
"humide", à comparer aussi avec vidvvs
vĭdŭŭs
"veuf".
Exemples :
maior "plus grand" = măjŏr ;
peior "pire" = pĕjŏr ;
pompeius "Pompée (nom de personne)" = Pompējŭs.
cavere "faire attention" = căvērĕ ;
aven(n)io "Avignon" = Avēnĭŏ, Avĕnnĭŏ ;
avvncvlvs "oncle
maternel" = ăvŭncŭlŭs.
Cas particulier v intervocalique = vv
: dans le parfait mōvī
"je bougeai", v représente une
géminée selon IPHAF:154 : [mowwiː]. Je pense que plŭvĭt
"il plut" est dans le même cas : plŭĭt
[pl
Cas particulier vi + voyelle = vĭ + voyelle
Par exemple :
aviolvs "aïeul" = ăvĭŏlŭs ;
salvia "sauge" = sălvĭă ;
Cas particulier iv + voyelle = ĭv + voyelle
nivere "neiger" = nīvĕrĕ ;
vivere "vivre" = vīvĕrĕ ;
Voir aussi ci-dessous IVV
et VVI.
Certains latinistes signalent que v après u n'était pas écrit : on n'écrivait que V et non VV (voir la citation de Max Niedemann ci-dessous). Cela semble souvent négligé voire complètement ignoré dans de nombreux passages de linguistes réputés. Par exemple :
- F. Gaffiot (DFL) ne donne pas l'étymologie de ăblŭō, qui est : ăb + lăvō (tableau ci-dessous) alors qu'il donne l'étymologie des autres mots apophoniques (confĭcĭō = cŭm + făcĭō) ; à l'origine ăblŭō est en fait ăblŭvō (apophonie devant v) ;
- F. de La Chaussée explique l'évolution vĭdŭă > "veuve" grâce à un "w de
consonification", c'est-à-dire que ŭ
devient la consonne w (IPHAF:153). Pourquoi n'envisage-t-il pas au moins
la possibilité d'un scénario
vĭdŭă = vĭdŭvă
> *ved'va > "veuve" (ci-dessous) ? (
Cette habitude graphique des romains crée une confusion parmi les
linguistes contemporains, et sans doute elle créa une confusion chez les
romains eux-mêmes (voir l'extrait
de Varron à "Réfection des conjugaisons" à propos du parfait en
En raison du phénomène d'amuïssement / rétablissement de waw, je pense que selon les époques et les régions, les romains prononçaient ce v ou non. Ainsi il y eut alternance "avec v prononcé / sans v prononcé".
Certains indices permettent de comprendre que le v devait être prononcé en latin vulgaire, ou non :
- les orthographes des substantifs ăllŭvĭō "alluvion", dīlŭvĭŭm "déluge", flŭvĭŭs "fleuve", plŭvĭă "pluie" suggèrent que ăllŭō "je viens mouiller", dīlŭō "je dilue", flŭĕrĕ "couler", plŭĕrĕ "pleuvoir" se prononçaient avec ŭv.
- les descendants de type fr "pleuvoir" < plŭĕrĕ, it vedova "veuve" < vĭdŭă, montrent qu'un v était prononcé dans plŭĕrĕ, vĭdŭă.
-
Les mots de type vĭdŭă "veuve", jānŭārĭŭs "janvier", malŭă "mauve (plante)", Gĕnŭă "Gênes", auraient dû systématiquement être suspectés de contenir soit un v étymologique, soit un v épenthique. Dans les flexions verbales, Christian Touratier éclaircit ainsi certaines incohérences apparentes : voir ci-dessous réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.
|
dans les manuels
|
|
variante avec v (jamais écrite)
|
| 1.
uv d'origine
indo-européenne (*ew > uw) |
||
| clŭāca "égoût",
clŭĕrĕ
"nettoyer" |
clŭvāca, clŭvĕrĕ (pr-i-e. ḱlewH-) | |
| flŭĕrĕ "couler" | flŭvĕrĕ
(pr-i-e. *bʰlewH-) (voir flŭvĭŭs) |
|
| plŭĕrĕ "pleuvoir" | plŭvĕrĕ
(pr-i-e. *plew-)
(voir plŭvĭă)
(1) |
|
| pŭĕr "enfant" | pŭvĕr (pr-i-e. *peh₂w-) | |
| rŭĕrĕ "se ruer ; s'écrouler" | rŭvĕrĕ (pr-i-e. *h₃rew-) | |
| rŭīnă "ruine" | rŭvīnă (de rŭĕrĕ à la ligne au-dessus) | |
| vĭdŭă "veuve" | vĭdŭvă (pr-i-e. *widʰéwh₂) | |
| 2. uv d'origine apophonique (brève + v > ŭv) | ||
| a. Composés en lăvō "je lave" (2) | ||
| ăblŭō "j'enlève en lavant" | ăblŭvō (ăb + lăvō) (2) | |
| ădlŭō > ăllŭō "je viens mouiller" | ăllŭvō (ăd + lăvō) (voir ăllŭvĭō) (2) | |
| dīlŭō "je dilue" | dīlŭvō (dĭs
+ lăvō) (voir dīlŭvĭŭm)
(2) |
|
| pollŭō "je souille" | pollŭvō (por +
lăvō) (2) |
|
| b. Parfait de la 2e conjugaison (conjugaison => apophonie) | ||
| dēbŭī "je dus" | dēbŭvī
(dēbĕ- + -vī) |
|
| c.
Toponymes prélatins |
||
| Gĕnŭă "Gênes ; Genève" | Gĕnŭvă, voir it Genova, voir Genève. | |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : mots écrits
en u dans les manuels,
représentants en fait uv.
(1) Pour plŭĕrĕ, voir plŭĭt prononcé plu-v-it ci-dessous (M. Niedermann) ; ce dernier auteur ne va pas jusqu'à dire que v est étymologique. Et pourtant, tout concourt à l'affirmer.
(2) Pour -lăvō
> -lŭvō, le simple lŭō est une formation secondaire
sur ăblŭō. Pour les composés en
|
dans les manuels
|
|
en réalité (très probablement)
|
| ij d'origine proto-italique |
||
| fīō "(voie passive de "je fais") | fījō (MPL:127) | |
| pĭŭs "pieux" |
pījŭs
(pr-it. *pwījos) comme pĭĕtās en réalité pījĕtās "piété" (voir pitié) |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : mots écrits en i dans les manuels, représentants en fait ij.
Pour pĭŭs, pĭĕtās apparemment, il y a avait réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.
Christian Touratier utilise l'existence à l'oral des yods
et waws étymologiques non écrits (ci-dessous)
pour résoudre les contradictions apparentes dans un même
- entre i bref dans audĭō et i long dans audīre ;
- entre u
bref dans argŭō
"je prouve" et u long dans argūtum
.
Sa solution est de considérer qu'un
yod ou un waw articulé (mais non écrit) s'ajoute à la voyelle brève
pour lui conférer la valeur d'une voyelle longue : il y a
"réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue".
Le même auteur discute dans un autre ouvrage de la quantité longue ou
brève de u dans statuo
"j'établis" (ILLL:104) : "Faut-il décrire statuo
à partir d'une suite phonématique /statuo:/ avec réalisation
biphonématique [uw] du
Les dictionnaires donnent : audĭō,
flŭō, argŭō avec i et
u brefs : si je comprends bien,
l'étude de la
Les mots latins ăllŭvĭō
"alluvion", dīlŭvĭŭm "déluge"
(voir ci-dessus composés en -lŭvō),
flŭvĭŭs
"fleuve", jŭvō
"j'aide", jŭvĕnĭs
"jeune", plŭvĭă "pluie"
étaient écrits respectivement dilvvium,
flvvivs, ivvo,
ivvenis, plvvia. Dans ces
cas-là, uv était donc bien
écrit vv. Il
s'agissait d'éviter l'ambiguïté de lecture
(ci-dessous).
Les conclusions présentées ici proviennent de l'étude de la
Je mets à part les mots composés (ădĭēns ← ădĕō, adjūtārĕ, advĕnīrĕ, invītārĕ...), que je donne entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.
En excluant donc les mots composés, on peut généraliser ainsi :
- Pour I : I est toujours un ĭ
(sauf dans abietem,
arietem, parietem "sapin, bélier, mur") ; cette
situation fait l'objet de la grande partie ci-dessous premières
palatalisations ;
- Pour V :
- dans les groupes LV et RV, V est très
souvent un v (
- le groupe QV est un
- le groupe GV précédé de N est un
- le groupe GV s'il n'est pas précédé de N,
a la valeur gŭ(v) ;
- pour les autres cas, V précédé de consonne a très souvent la valeur ŭ(v).
Les deux tableaux ci-dessous présentent les prononciations de I et V dans les différentes situations pour "consonne + I + voyelle" et pour "consonne + V + voyelle".
|
- prononciation /bi/ : n. ăbĭēs
"sapin", răbĭēs
"rage", ...
- prononciation /b |
|
| RI + voyelle : | - prononciation /ri/
: n. ărĭēs
"bélier", n. părĭēs
"mur", ... - prononciation /r |
| autres cas : | (à part dans les
mots composés de type adjūtō
"j'aide") la prononciation est toujours /i/ et non / |
|
|
|
Tableau ci-dessus: Valeur de I latin derrière consonne et devant voyelle.
|
|
|
| BV + voyelle : | - prononciation /b - prononciation /b |
| CV
+ voyelle : |
toujours prononciation /k |
| DV + voyelle : |
- prononciation /d - prononciation /d - (/dw/ mots composés : advĕnīrĕ "arriver", ...) |
| FV + voyelle : |
toujours
prononciation /f |
| GV +
voyelle : |
- prononciation / - prononciation /g |
| HV
+ voyelle : |
toujours
prononciation / |
| JV
+ voyelle : |
(aucun exemple ?) |
| LV +
voyelle : |
- prononciation /l - prononciation /l - prononciation /l - prononciation /l |
| MV
+ voyelle : |
(aucun exemple ?) |
| NV + voyelle : |
- prononciation /n - prononciation /n - (/nw/ mots composés : convĕnīrĕ "convenir", invītārĕ "inviter", ...) |
| PV + voyelle : |
săpŭĭt (forme
de săpīvĭt "il
sut"), răpŭĭt ("il
emporta violemment"), ... |
| QV +voyelle : |
/ |
| RV + voyelle : |
- prononciation /r - prononciation /r - prononciation /r |
| SV +voyelle : |
- prononciation
/sʋ/ pŏsŭēre
"poser", ... - prononciation /s - (aussi /s |
| TV + voyelle : |
prononciation /t en tŭŭ : fătŭŭs "fade, insensé", mortŭŭs "mort", mūtŭŭs "prêté". |
| /wʋ/ + voyelle : | (aucun exemple ?) |
| XV + voyelle : | (mots composés :
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : Valeur de V latin
derrière consonne et devant voyelle, pour chaque consonne. Je
mets des liens en bleu gras dans les cas où la valeur /
Dans les mots composés, un yod ou un waw peut exister après consonne :
- adjūtō
contient un yod
- convĕnĭō
contient waw
● ăbiĕtĕm, ăriĕtĕm, păriĕtĕm
(à ré-étudier en utilisant LDR, PH-2020:363-364).
Les trois mots ăbĭēs
"sapin", ărĭēs
"bélier", părĭēs
"mur" ont un comportement déroutant pour les linguistes (voir notamment
ISACVH, et surtout SCIYSL). Je présente ci-dessous leurs
particularités, puis des pistes d'explication.
(1) L'étude de la
(2) À une certaine époque, dans un registre où l'on aurait prononcé ĭ comme voyelle, l'accent aurait
porté sur ce ĭ. (Voir règle
3
de l'accent latin ; on est dans le même cas que fīlĭŏlŭm,
mŭlĭĕrĕm, caprĕŏlŭm juste ci-après). Toujours selon la même
règle 3, pour les formes ăbjĕtĕm,
ărjĕtĕm, părjĕtĕm, dans la
(3) Les descendants romans ont perdu le j
: AO
: ab
(4) Dans les descendants romans, le é
fermé ne peut pas s'expliquer par ĕ
étymologique simple (on attendrait è,
voir mutation
vocalique).
(5) Les descendants romans ne montrent jamais une palatalisation du
type ri
> ir, bi
> (u)j.
(6) Remarque pour les descendants de ăbiĕtĕm
: AO
ab
Pistes d'explication
Voici la position de P. Fouché, qui mêle deux explications :
Pour P. Fouché (PHF-f2157-158), il y a eu une évolution ĭ > j pour deux raisons : 1. analogie sur le datif et l'ablatif pluriel (parĭĕtĭbŭs > parjĕtĭbŭs d'où parjĕtĕm), 2. dans les groupes "paríĕte túa, paríĕte ílla", l'accent principal de tūa, ĭlla aurait "attiré à lui l'accent secondaire de paríĕte", d'où paryète. Il faut que je voie si dans son œuvre, il y a une explication pour la suite de l'évolution : aboutissements AO : abẹt, arẹt, parẹt...
Voir l'explication fournie par V. Väänänen (OATLR:2), G. Millardet (LDR:327-328). Voir la "loi
de l'accent sur la voyelle la plus ouverte".
RLR LXI, 357-360.
Intolérance du latin à certains schémas rythmiques
Le latin est intolérant à certains schémas rythmiques, comme R. Garnier l'a démontré (ALLRL).
Le schéma rythmique suivant n'est pas accepté par les latins : [ ͜´ ͜ ͜ ] / [ ͜ ͜´ ͜ ͜ ] (ALLRL:9).
Cela signifie que le paradigme mulier / mulierem n'est "pas toléré".
La forme ăres pour ărĭēs "bélier" est
attestée dans
aries,
quod eum dicebant ares veteres
"aries
[le bélier] tire son nom du fait que les anciens disaient ares"
Dans ares, la quantité vocalique de e n'est pas connue, mais on a sans doute affaire à ē vu les descendants actuels.
Dans les langues romanes, tous les descendants
● mŭlĭĕrĕm, fīlĭŏlŭm
Le caractère v
est toujours prononcé [w] après q
et très souvent après g
: il constitue les
Il s'agit invariablement du
Il est présent dans de très nombreux mots :
æqvvs "plat", aqva "eau", eqvvs "cheval", qvattvor "quatre", qvid "quoi", seqvor "je suis (suivre)"...
Voir évolution de qv ci-dessous.
Il s'agit très souvent du
Voir évolution de gv ci-dessous.
Il y a dix mots concernés (avec leurs dérivés) (RP/Gw/L:109) :
angvis "serpent", ingven "aine", langvet "il est affaibli" (langvor "langueur"), lingva "langue", ningvit "il neige", pingvis "gras", sangvis "sang", stingvit "il éteint", vngvis "ongle", vngvit "il oint" (vngventum "onguent").
On doit rajouter quatre verbes instables qui peuvent se "labialiser" (RP/Gw/L:108-109) :
disting(v)it "il distingue", ling(v)it "il lèche", restring(v)it "il serre", ting(v)it "il teint".
On constate que dans tous ces cas, gv
retranscrivant /
Dans la généalogie des consonnes latines, /
(Exemples de PHL4:92-93, 151) :
pr-i-e. */(V)
- à l'intervocalique : pr-i-e. (acc) *snóygʷʰom > lat (acc) nĭvĕm "neige"
- à l'initiale : pr-it. *gʷenjō > lat vĕnĭō "je viens" ; : pr-it. *gʷīwō > lat vīvō "je vis"
Ce n'est qu'en position
pr-i-e. */n
- pr-i-e. *sni-n-gʷʰ-énti > lat ninguĭt
"il neige" (voir Wikipédia ninguit)
Devant consonne, pr-i-e. */
pr-i-e. */V
- pr-i-e. (nom)
*snóygʷʰos
> pr-it. (nom)
*sniks > lat (nom)
nix "neige"
À la règle "/
- un cas de /
- deux cas de /
ci-dessous N + V + voyelle.
On peut citer ambĭgŭŭs
(RP/Gw/L:108), argŭō "je prouve"
(CIAPuL:235)... Entre les deux voyelles en hiatus,
un waw
épenthique ou étymologique était sans doute prononcé : */ambigʋwʋs/, */argʋwóː/.
Voir ci-dessus ŭv écrit V.
Pour argŭō, le w est sans doute étymologique : voir réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.
Pour cv + voyelle : V représente une voyelle, mais assez tôt, au cours du Ier siècle avant J.-C., la consonification de ŭ après c aboutit à la même prononciation que dans qv, voir ci-dessous évolution de c + ŏ, ŭ en hiatus.
Après l ou r
(
(Quintilien 12, 10, ) Æolicœ quoque litteræ, qua servum cervumque dicimus, etiamsi forma a nobis repudiata est, vis tamen nos ipsa persequitur.
Quant au digamma éolien [ϝ prononcé /w/], quoique nous en ayons rejeté la forme, nous en conservons la force, pour ainsi dire, malgré nous, lorsque nous prononçons certains mots, tels que servus et cervus (QPLJ:472).
Voir ci-dessus le caractère digamma.
Voir DLCALI:119-120 qui cite Touratier (SPQG:247) : « on constate que /w/ n’est possible que dans les groupes biphonématiques et après une liquide : rw (cf. neruus, aruus) et lw (cf. aluus, uoluo) ». Il faudrait nuancer en disant : et très marginalement après d, n, s.
Ci-dessous, solvō provient de se + lŭō, donc tout se passe comme s'il y avait consonification en latin si LV n'est plus à l'initiale : ŭ > v (à étudier).
après l : alvvs, calvvs, fulvvs, gilvvs, milvvs, salvvs (salvare), silva, solvo, volvo...
après r : arvvm, cervvs, cvrvvs (cvrvare), ervvm, nervvs, parvvs, servvs (servire)...
Donc les manuels et les dictionnaires écrivent de façon exacte :
alvus,
calvus, fulvus, gilvus, milvus, salvus (salvare), solvo, volvo.
arvum, cervus, curvus, ervum, nervus, parvus, servus (servire).
Il faut rappeler que ce contact v / u facilite l'amuïssement de v (ervum > erum ; servus > serus...).
Au contraire des cas précédents :
malva "mauve (plante)" est malŭă (IPHAF:144) ; c'est un mot d'origine sémitique, voir l'hébreu מַלּוּחַ (malúakh) ;
belva "gros
animal" serait bēlŭă
(SSL:8,11).
Aussi : prŭīnă "gelée blanche".
Dans cette catégorie entre
aussi le cas des parfaits forts, de type vŏlŭĭt
:
Par exemple : vŏlŭĭt "il
voulut", dŏlŭĭt "il eut mal",
mŏrŭĭt "il mourut"... Il faut
noter l'ambiguité avec les caractères latins : volvit vŏlŭĭt "il voulut" et volvit
vŏlvĭt "il roule".
Pour rŭīnă
"ruine", rŭĕrĕ
"se ruer", ērŭĕrĕ
"déterrer", RV représente rŭv
(ŭv écrit V).
Voir ci-dessous évolution de type corvus > *corbus.
Dans deux cas, V a la valeur /
RP/Gw/L:110-111 : dissyllabiques tĕnŭĭs,
tĕnŭĕ, tĕnŭĕm, tĕnŭīs, trisyllabiques tĕnŭĭă,
tĕnŭĭŭs, tétrasyllabique extĕnŭātŭr.
"Le comportement de /w/ est ici exactement celui qu'on observe dans seruō et soluō."
Il faut remarquer que GENVA gĕnŭă
"genoux" s'oppose à GENVA Gĕnŭvă "Gênes", où
ŭ représente ŭv
(> it Genova)
(ci-dessous).
Cependant tenvis
avait peut-être aussi une prononciation avec V = ŭ
("Tenve représente ten-uis,
qui, comme on sait, se disait à côté de tĕ-nŭ-ĭs"
Littré
"ténu" ; et justement dans ce cas, il est fort possible que a.fr. tenve
représente au contraire tĕ-nŭ-ĭs
selon le scénario
ci-dessous). Les spécialistes ont discuté sur la valeur de ce contact
entre phonèmes : tantôt V est considéré comme consonne, tantôt comme
voyelle, tantôt comme un élément de diphtongue, voir le cas ci-dessous caulŭm
> cavolo).
Dans tous les autres cas, V a la
valeur ŭ(v)
:
Pour Gĕnŭă "Gênes ; Genève", il semble qu'il y ait un w étymologique, voir Gĕnăvă. (ci-dessus ŭv écrit V).
Pour les autres mots, il y avait sans doute souvent un w épenthique, voir ci-dessous : ŏ, ŭ en hiatus : annŭŭs (annŭalĭs) "annuel", contĭnŭŭm "continu", Gĕnŭă "Gênes", jānŭārĭŭs "janvier", mănŭālĭs "à la main", strēnŭŭs "diligent".
- Prononciation /s
La prononciation /s
Il faut mettre à part les dissyllabes avec hiatus :
sŭă
"sa" (voir IPHAF:144 pour cŭī,
fŭī). Pour suō "je
couds" : je ne sais pas si u a
la valeur de ŭ ou w
(suĕrĕ, con
+ suĕrĕ > consuĕrĕ : ?)
suādērĕ "conseiller", suāvĭs "doux", suĕscĕrĕ "s'accoutumer", Suessĭōnĕm "Soissons", Suēvi "Suèves, peuple germain"...
Également dans les mots composés :
persuādērĕ "persuader", consuĕscĕrĕ "accoutumer", consuētūdo "habitude", mălĕsuādă "mauvaise conseillère" : SSL:25.
- Prononciation /s
Si S + V + voyelle n'est pas en début de mot, V est la voyelle ŭ
: pŏsŭēre
"poser" (SSL:26).
Seuls deux mots témoignent d'une prononciation /d
Dans les autres mots, le V est la voyelle ŭ : cardŭŭs "chardon", dŭŏ "deux", dŭŏdĕcĭm "douze", vĭdŭă "veuve", ...
- Pour consonne + I + voyelle :
dans les autres cas (à part abietem,
arietem, parietem), on a affaire à la voyelle ĭ
en hiatus. Cette voyelle évoluera vers une une consonification
quasi-systématique (comme pour ĕ),
à
l'origine des premières
palatalisations ci-après.
- Pour consonne + V + voyelle :
dans les autres cas, en plus des cas cités ci-dessus, on a affaire à ŭ(v) en hiatus. L'évolution de
cette voyelle est complexe, voir évolution
de ŭ, ŏ en hiatus
ci-après.
(27 janvier 2019) Cet aspect dans l'étymologie des mots occitans et français est sous-étudié, sans doute par méconnaissance. Je présente ci-dessous plusieurs réflexions personnelles.
J'appelle yods et waws épenthiques
les yods et waws apparus par épenthèse
dans la succession "voyelle + voyelle appartenant à deux syllabes
différentes", c'est-à-dire dans les
Exemple : jānŭārĭŭ(m)
"janvier" pouvait être prononcé avec un
Or dans les situations "u ou i + voyelle", des yods et waws étymologiques pouvaient déjà très
bien exister. La différence avec les
yods et waws épenthiques devenait alors délicate (mais encore
possible par la bonne connaissance des
Exemples :
- /flʋwéré/
"couler" est écrit flŭĕrĕ
alors qu'il contient un w étymologique (< pr-it. *flūgvere
ci-dessous, voir [gw]
> [w], voir
- sans doute : vĭdŭă(m) "veuve"
était prononcé avec un
Les latins ont pris le parti de
n'écrire aucun de ces sons, sauf les waws dans les mots en juv-
et en -uvi-
pour éviter l'ambiguïté de lecture (ci-dessous)
: jŭvĕnis
"jeune", jŭvō
"j'aide", plŭvĭă
"pluie" étaient écrits avec v.
Concernant
les
yods et waws étymologiques, cela a créé une incohérence notable
à l'écrit, un même
ŭ
et ū :
flŭō, flūxī, flūxŭm, flŭĕrĕ "couler", voir ci-dessous réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue ;
ŭ et ŭv :
plŭĕrĕ, plŭĭt "pleuvoir, il pleut", plŭvĭă "pluie"
Dans plŭĕrĕ, plŭĭt, il y
avait un v non écrit (de
nature étymologique, voir pr-it. *plowō
in pr-i-e.
Remarque : au cours de la
réalisation des pages de ce site, j'ai souvent réalisé que des yods ou
waws non écrits, que je pensais épenthiques, étaient en fait
étymologiques. Les informations sont difficiles à trouver, et cela met
en évidence la mauvaise connaissance de cette habitude graphique des
romains par les auteurs modernes.
Quelques écrits latins contiennent des v épenthiques, ou des i épenthiques :
- i épenthique (TSSLT:58, 98) :
Martiias pour Martias ;
Quintiius
pour Quintius ;
Sallustivo
pour Sallustio (TSSLT:58, 98) ;
ci-dessous, avec effet ouvrant sur la
voyelle
poveri
pour pueri (TSSLT:58, 98).
Voici mes sources :
Explications de Max Niedermann :
PHL4:104,105 : "Dans les groupes i
+ voyelle de timbre différent et u
+ voyelle de timbre différent, formant deux syllabes, i
et u ont développé à leur
suite, comme sons transitoires, les semi-voyelles respectives j
et v. L'écriture, d'ordinaire,
ne marquait pas ces phonèmes parasites. On orthographiait donc pius
"pieux", via "route", duo
"deux", pluit "il pleut", tout
en prononçant
Explications de Solmsen fournies dans MPL:128 :
"Après u
il n'y aurait eu nulle part de v
proprement dit, mais seulement le son de la détente de la voyelle u, quand on passe de cette voyelle
à une autre ; même là où l'étymologie indique l'existence de v,
comme dans juvenis, ce v se serait affaibli jusqu'à se
confondre avec le son de la détente d'u
précédent. A l'époque républicaine ce son fugitif n'aurait pas été noté,
et à l'époque impériale on l'aurait noté seulement dans les mots qui
autrement auraient pu être épelés incorrectement (...)".
Exemples de
Christian Touratier :
- pour yod
: "audio correspondant
à la réalisation [awdijo:] de la séquence phonématique /awdi:o:/" (CIAPuL:234-235).
- pour waw : [Si on a la succession : "liquide initiale ou non précédée d'une voyelle + u + voyelle"], "alors u note un phonème vocalique /u/ qui avait toute chance de présenter une variante [uw], ruo et luo devant très certainement se prononcer [ruwo:] et [luwo:] plutôt que [ruo:] et [luo:] avec hiatus" (CIAPuL:236).
Cas de jŭvō "j'aide" (identique au cas de jŭvĕnis "jeune")
(CIAPuL:235) : "On peut même penser que iuuo, prononcé [juwo:], est la réalisation de /iu:o/ (...) La particularité du verbe iuuo serait alors purement orthographique : la séquence phonique [uwo] y était transcrite uuo et non pas seulement uo (comme dans abluwo: écrit normalement abluo), parce qu'elle était précédée d'un i : une suite graphématique uo ne pouvant se lire après voyelle que [wo] (cf. auo de auus ou lauo), une graphie *iuo aurait correspondu à une prononciation [iwo:], comme dans niuosus ou nominatiuo de nominatiuus, et non pas à [juwo:]"
Je place ici un paragraphe général sur les effets des
D'une façon universelle, l'existence d'un
L'
Mais les hiatus enfreignent le
C'est donc souvent par influence savante qu'ils sont maintenus.
C'est-à-dire que l'
L'insertion d'une consonne
Ce peut être aussi :
- g /g/ (păvōrĕm > *paore > AO pagọr "peur") ;
- z /z/ (vāgīnăm > AO gaïna, gazina "gaine", păvīmentŭm > AO païmen, pazimen, pavimen "pavé") ;
- h
/
- v
(sans passer par le stade waw ?) : par exemple la composition médiévale
dea + -essa > AO dev
- la voyelle é entre i
et
Il me semble qu'une première consonne épenthique a pu évoluer en une seconde, par exemple :
/
/
/
À mieux étudier.
Voir ci-dessous : descendance des waws et g épenthiques,
Les épenthèses peuvent se réaliser en position
Concernant le processus phonétique, Georges Millardet puis Gérard
Genot écrivent :
(LDR:323) "La rencontre des voyelles à la
frontière syllabique produit donc des effets de fermeture comme fait la
rencontre des consonnes. (...) Mais le plus souvent la fermeture aboutit
à une consonification, qui peut être totale ou partielle. Si elle est
totale, l'
Mais la consonification peut être partielle,
c'est-à-dire que celle des deux voyelles qui tend à se fermer, se
segmente en deux éléments : c'est l'un de ces deux éléments, celui qui
touche à la frontière syllabique, qui devient plus fermé que l'autre, et
se consonifie. Là est l'origine des consonnes transitoires si fréquentes
dans certains idiomes romans :
Pour l'italien Bartolomeio, Andreia :
(LDIL:90) "(...) mais il semble bien (voir la
forme Andreia) que l'on ait
ici une épenthèse analogue à celle de /v/ ou /g/ au contact de /u/. Elle
se constitue de la même manière : l'élément déterminant,
qui est le /e/ menacé de perte de valeur syllabique par sa position en
Voir ci-dessous résolution
d'hiatus
par insertion de v au
contact de o, u.
Remarque : En grec, il existait
des sons de transition, LG:14 : "Le mycénien était encore pourvu de
signes notant *y [yod] (mais
dans une mesure restreinte seulement) et *w
[waw], ainsi que des sons de transition (qui ne sont pas des
À l'intervocalique, sachant que v et g étymologiques latins se sont très généralement amuïs au contact de o, u latins, la coexistence des variantes dialectales suivantes laisse perplexe : AO et OM paur / pavor "peur" (< păvōrĕm) ; AO oncle /avoncle "oncle" (< ăvŭncŭlŭm) ; AO et OM aost / agost "août" (< agŭstŭm)... Dans ces paires de mots, pavor, avoncle, agost semblent tenir leur voyelle d'une influence savante du latin ; mais est-ce le cas ?
Examinons les variantes dialectales provenant de quelques mots latins ayant perdu une consonne :
abŭndare → AO aondos, abondos, avondos, ahondos "abondant"
agŭstŭm > AO aost, agost, ahost, asost (azost ?), avost... "août" (Voir les discussions sur la consonne interne à DOM "aost").
păvōnĕm > AO paon, pau, paho ; OM pavon, pabon, etc. "paon".
păvōrĕm > AO paor, paur, pavor, pagor "peur".
Au regard des lignes qui précèdent, on peut proposer la sorte de règle
suivante : pour un mot latin, si l'on connaît des descendants avec des consonnes
épenthiques différentes de la consonne latine, en plus de la la
variante avec consonne latine, il est tout à fait vraisemblable que la
variante avec la consonne latine soit populaire, que sa consonne soit en
fait épenthique ; par exemple dans dans agŭstŭm > AO aost / avost / agost / ahost, la
variante agost peut très bien être populaire, acquise par
En fait le problème est souvent difficile, voir par exemple ăvŭncŭlŭs
"oncle" ci-dessous. Il faut procéder au cas par cas.
La
- lat fāgŭ(m) > */faʋ/ > */faʋ̯/ > pr fau /faw/ "hêtre" (fagum > fau) ;
- l.i.P. cahuchu > fr "caoutchouc" > oc cauchó /kawtʃʋ/ ;
- voir les mots français de type "jouet", "suer" prononcés avec synérèse, mais avec diérèse en français méridional.
La consonification d'une des deux voyelles
permet également de résoudre l'hiatus. Voir notamment les yodisations
ci-dessous.
L'
Par exemple :
- a.fr. meür > "mûr" (LDR:322), voir voyelles longues françaises ;
- quĭētŭs
> *quētŭs (LDR:333) ;
- voir aussi Réduction de diphtongue ou de triphtongue.
L'haplologie
peut se produire si les deux timbres sont identiques : imperii
> imperi (LDR:321).
Sans disparaître, l'
(LDR:332) "... les remèdes apportés laissent souvent les cas d'hiatus à mi-chemin de la guérison..."
- (basculement d'accent : loi de l'accent sur la voyelle la plus ouverte) rēgīnam > */réina/ > reina "reine" ;
Max Nierdemann, cité ci-dessus,
réduit les cas d'épenthèse à "i
+ voyelle de timbre différent et u
+ voyelle de timbre différent, formant deux syllabes". Il faut donner
les précisions suivantes :
- Pour yod
épenthique : l'épenthèse se réalisait sans doute fréquemment
pour les nombreux cas avec ĭ, ĕ
+ voyelle en hiatus, mais la prononciation a abouti, d'une manière ou
d'une autre, au système des premières
palatalisations. Voir aussi les quelques autres
descendants ci-dessous.
- Pour waw
épenthique : l'épenthèse se réalisait certes dans les cas ŭ + voyelle en hiatus, cas fréquent
en latin. Mais certains descendants actuels montrent qu'elle s'est
produite dans d'autres cas :
- parfois entre les deux éléments de la diphtongue au (ci-dessous) : it cavolo < caulum "chou", peut-être par réaction à la monophtongaison de au ;
- dans un hiatus secondaire : agŭstŭm > *aostu (> "août").
Les
- it
continovo
< contĭnŭŭm
"continu" : ici il y a eu épenthèse entre deux u
(mais peut-être influence analogique de continovare < continŭārĕ)
Ce paradoxe n'est pas réellement signalé par les linguistes.
Il s'agit de l'existence des deux évolutions contradictoires :
• amuïssement :
- de yod au contact de e,
i (eus pour ejus,
Pompeus pour Pompejus...
TSSLT:58)
- de
waw au contact de o, u
(ci-dessous)
• rétablissement, ou apparition :
- d'un yod épenthique au contact de e,
i
- d'un waw épenthique au contact de o,
u (et il faut rajouter le rétablissement
savant de waw, ci-dessous).
On pourrait se demander si les latins ne prononçaient pas toujours ces yods ou waws intervocaliques, même sans les écrire. Mais les aboutissements actuels de type oc paur, it paura /paʋra/, fr "peur" < păvōrĕm, fr "paon" < pāvōnĕm montrent que v s'est effacé dans ces mots (ce qui montre très certainement que la consigne de type Prob,176 pavor non paor a été vaine, voir inventaire ci-dessous).
Il y a donc bien deux évolutions contradictoires. Je pense que ce paradoxe peut être expliqué par le fait que l'un ou l'autre phénomène prévalût en fonction des époques, et en fonction des standards dialectaux des régions.
Je donne ci-dessous des exemples de yods et de waw (ou v)
épenthiques ayant pu apparaître à des
époques très différentes (Antiquité, Moyen Âge, et plus tard
sans doute).
Selon les époques et les régions, au moins en domaine d'oc, le yod épenthique peut rester à l'état de yod ou (peut-être ?) évoluer en [dj] (renforcement du yod).
"Premières
palatalisations" : je propose ci-dessous une théorie nouvelle
sur l'influence d'un yod épenthique hypothétique pour expliquer
l'évolution de type līnĕŭm
> linge (également abbrĕvĭăt
> abreuja). Cela affecte de nombreux mots.
Autres cas
:
Voie savante :
ĭdĕă(m) > oc idèa [idèyo], cat idea ([idéya] ("pronúncia vulgar" DCVB)
stătŭă(m) > estatuia (l, g, lim) (voir aussi statova, estadal)
thĕātrŭm
> auv teiatre (voir aussi tiatre)
mĕŭ(m) > esp mío
[miyo]
(TSSLT:99)
tŭŭ(m) > esp tuyo (TSSLT:99) : ici, yod au lieu de waw
Andrēă(m) > Andreia (LDIL:90), voir port Andreia, Eur.cent. Andreja ;
Barthŏlŏmæŭ(m)
> Bartolomeio (LDIL:90)
dēstrŭĕre > *distruiere > (renforcement du yod) destruggere (LDIL:90, mais plutôt *dēstrūgĕre, voir étymologie de destruire).
(parfois le i épenthique n'est pas écrit car il suit un i : Aquītānĭăm > oc Guiana [giyano/a] "Guyenne")
-ātăm
> variante v-a
Aquītānĭăm (Aquītānăm)
> lim Aiguiana
[aygiyano/a], oc Guiana
[giyano/a] "Guyenne",
voir Aquītānĭăm
ci-dessous.
a.fr.
baer
> "bayer" /bayé/ (
a.fr. quaer > "cahier"
carrūcăm > fr "charrue" > (
pūrāre > dér a.fr.
puree [puréë] (purée) >
(
trăgēmăm > AO dragea,
drageia, drigeia,
trageia "dragée" (tr- > dr- ; évolution de
vōcālĕm
> a.fr. voieul
(< *voiel). Le i
est épenthique devant é ; pour
la finale
Voir ci-dessous ŏ,
ŭ en hiatus > v, b
(souvent w épenthique).
Les linguistes donnent :
jānŭārĭŭm > *yan
vĭdŭăm
> a.fr. vedve
*/védv
D'après ces auteurs, ŭ en
hiatus s'est consonifié pour donner v.
jānŭārĭŭm
> "janvier", genovier
Pour jānŭārĭŭm
> "janvier", AO genovier,
contrairement à la position des linguistes ci-dessus, je pense que la
comparaison avec l'AO (genovier)
suggère plutôt un scénario avec "épenthèse
de v puis
jenŭārĭŭm > *jenovariu > a.fr. jenvier > "janvier"
(toutes les formes romanes dérivent de jenŭārĭŭm selon
Je pense qu'il faut voir le même scénario dans a.fr. anvel "annuel", AO mambal "manuel", et probablement aussi dans a.fr. tenve, teneve, terve "ténu". Voir ci-dessous ŏ, ŭ en hiatus.
Le cas de malŭă "mauve" > AO malva... est incertain.
vĭdŭăm > "veuve"
L'erreur est probablement d'un type un peu différent pour vĭdŭăm "veuve", puisque vĭdŭă (VIDVA)
représentait très certainement vĭdŭvă avec un v
étymologique (voir ci-dessus ŭv
écrit V). L'
Pour l'occitan, voir ci-dessous métathèse
de type : vĭdŭă > veusa.
Pour le français on a donc :
*vĭdŭvăm > *vedova > vedve > a.fr. "veuve"
(projetbabel
Certains mots, notamment italiens, parfois AO, contiennent un v qui n'existait pas en latin, et qui ne provient pas de la consonification de ŭ. Il est logique de penser que ce v provient d'un waw épenthique au contact de o, u.
Il en est de même pour les g
provenant de
G. Genot (LDIL:89) signale que cette épenthèse de v
(comme parfois de g dans les
mêmes situations) se réalise en position
Je parle ici de la descendance de waw épenthique dans les hiatus
annŭālĕm > annovale
(DLNI:208), a.fr. anvel "annuel"
attĕnŭārĕ > attenovare
(DLNI:208) (voir tĕnŭĕm ci-dessous)
continŭārĕ > continovare (DLNI:208)
contĭnŭŭm > variante
it continovo "continu" (
ēlectŭārĭŭm > variantes it elettovario, lattovaro "électuaire"
Gĕnŭă(m) > it Genova "Gênes" (
jānŭārĭŭ(m) > variante AO genovier, "janvier"
Mantŭă(m) > it Mantova "Mantoue" (
mănŭālĕ(m) > it manovale
"manœuvre" (
mĭnŭĕrĕ
> mĭnŭārĕ
> a.it. menovare,
cat minvar, esp
menguar
(ci-dessous), etc. (DÉRom)
*pactŭīre
> variante it
pattovire
"convenir" (
Pădŭă(m) > it Padova
"Padoue" (
pæŏnĭă > Pomp PÆVONIA (FEW 7:465b) (voir aussi ci-dessous "pivoine")
plŭĕrĕ, plŭĭt "pleuvoir, il
pleut" (il s'agit d'un w étymologique non
écrit)
rŭīnă(m) > it rovina
"ruine" (
stătŭă(m)
> a.flor.
statova (
strēnŭŭ(m)
> variante it
strenovo
"vaillant" (
tĕnŭĕm > *tenove > a.fr. teneve, tenve, terve "ténu, maigre" (voir attĕnŭārĕ ci-dessus)
vĭdŭă(m) > it vedova (
victŭālĭăm > it vettovaglia "victuailles" (
a.b.fr. *thwahlja
> AO
toalha >
it tovaglia (analogie sur vettovaglie
ci-dessus, ou nouvelle épenthèse)
Les représentants actuels de pæŏnĭă
"pivoine" dans la
Concernant le v, bien qu'on
dispose de l'inscription Pomp
PÆVONIA (ci-dessus), où v
est
L'AO
pezonia "pivoine" semble être
emprunté vu sa terminaison
Je parle ici de la descendance de waw
Le cas est sans doute voisin de tĕnŭĕm
(ci-dessus tĕnŭĕm et attĕnŭārĕ).
Les cas ci-dessous concernent la diphtongue au
tonique suivie de l.
Je subodore une analogie partielle du schéma -aulŭs sur le schéma -abŭlŭs / -ābĭlĭs. En effet, en italien : caulŭm, tăbŭlăm, laudābĭlĕm > cavolo, tavola, lodevole.
caulŭ(m) > cavolo "chou" (
naulŭ(m) > variante
it navolo
(pour naulo, nolo "fret") (
Paulŭ(m) > it Paolo > variantes it
Pavolo, Pagolo, esp
Pablo (
Pour l'espagnol, l'évolution est ambiguë. Par exemple dans Paulŭ(m)
> Pablo, on peut proposer soit une simple consonification de u
devant l : Paulŭ(m) > */pa
L'espagnol semble présenter une "facilité de consonification de u", voir par exemple u après l dans "Îles Malouines" > Islas Malvinas.
Toujours pour l'espagnol, l'évolution părăbŏlăm > *păraulăm
> a.esp.
parabla > (métathèse)
esp palabra présente
la même ambiguïté que Paulŭs ci-dessus, c'est-à-dire qu'on ne
sait pas si u devant l s'est consonifié en b, ou
si un v épenthique est apparu entre a et u (*paraula
> *parabula > *parab'la) ; l'évolution directe lat.cl. părăbŏlăm > (
Je parle ici de la descendance de waw
ădultĕră(m) > *aultera > AO av
agŭstŭ(m)
> aost > avost
"août" (voir augŭstŭs)
Causalone > *Cawalone > *Cawlaone >
Caulaho > Calavon (
dōgă(m) > doa > prov, v-alp... dova "douve"
interrŏgārĕ > *interroare > oc
entrevar,
a.fr. enterver
Lŭdŏvīcŭs > *Luois > oc Loís,
Lovís
Nātālĭs (dĭēs) >
(dissimilation
a-a > o-a) *nōtālĭs > fr Noël > (
pāvōnĕ(m) > *paonem > variantes it pavone, pagone, oc pavon "paon", AO paho
păvōrĕ(m) > paorem
> variantes AO pav
*Radolfŭs > Raolfus > oc Ravós (Ravoux), "Raoul"
tēgŭlă(m) > *tēula > piém tivola,
tivula
(
vōcālĕm > a.fr. vouel, sans doute prononcé [vówéːl] (> angl vowel "voyelle"). On a un w épenthique derrière ó, voir aussi l'autre variante a.fr. voieul ci-dessus. Le c latin devant a disparaît (voir jocari > jouer) et entraîne l'hiatus. Voir aussi ci-dessous power. En AO, seul le mot savant vocal "vocable, voyelle" est attesté.
Tous les cas avec v latin au contact de o, u, b latlin au contact de o,u, sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie.
En occitan, on trouve un v
d'
Dans "pouvoir" < *pŏtērĕ,
il y a eu amuïssement de t
latin en français (t
> ∅) (> a.fr.
poeir, pooir), mais selon
Pierre Fouché (PHF-f3:646) le v,
attesté seulement au XIIIe siècle, ne serait pas
Pour l'anglais power
"puissance, pouvoir", issu de l'angl-norm poer
(< a.fr. poeir),
il faudrait étudier si w a la
même origine que ci-dessus, ou bien s'il est d'origine
Pour vōcālĕm > a.fr. vouel > angl vowel, voir ci-dessus.
Pour le français généralement, P. Fouché (PHF-f3:645-647) estime que les waws
Le yod
L'évolution du yod
L'évolution du yod
Cette évolution est un d'abord un renforcement (
Pour comprendre la nature du yod, il faut se reporter à "nature
du
yod
et du waw".
D'abord, le système phonique du latin exigeait que ce yod fût prononcé
de façon particulièrement énergique (IPHAF:76). Cela est un renforcement "par nature",
"automatique", du yod. On peut distinguer :
- renforcement en
-
Ensuite, le yod a eu d'autres origines dans l'histoire, et on peut
distinguer trois phases où le yod est
apparu secondairement, et où il est susceptible
d'être renforcé. La 2e phase et surtout la 3e
phase sont le fruit de réflexions personnelles. Voici ces trois phases.
- 1e phase (affectant toute la
- 2e phase : (affectant toute la
- 3e phase : (seulement en nord-occitan
et en français) au Ve siècle (?), la spirantisation du g intervocalique
Concernant la consonne obtenue /dj/, elle reste prononcée ainsi de nos
jours en occitan, et n'a pas subi la "désaffrication" comme en français
(perte de la composante
Examinons le devenir du yod en fonction de ses trois phases
d'apparition ci-dessus.
On parle ici du yod
En plus du yod
(Je pense que la première étape de
À l'initiale
À l'initiale, le yod primaire ainsi que dy,
gy évoluent très généralement en dj
en domaine d'oc. Seul le béarnais voit un affaiblissement en /y/.
|
latin LPC
|
|
occitan
|
|
français
|
|
/ dĭ-, gĭ- : voir dĭ |
|
/y/ (béar) |
|
/j/ |
|
dĭŭrnŭm / |
|
iorn /yʋr/, /yʋrn/ (béar) |
|
jour |
|
jăcĕrĕ / |
|
iàser (béar) |
|
gésir |
|
jăm / |
|
ia (béar) |
|
(déjà : dès ja) |
|
jŏcārĭ / |
|
iogar /yʋga/ (béar) |
|
jouer |
|
jŏgum / |
|
iog /yʋ/ (béar) |
|
joug |
|
|
|
|
|
|
Tableau : exemples de l'évolution de
yod à l'initiale, identique à celle de dy.
Après consonne
Après consonne, le yod primaire ainsi que dy, gy évoluent très généralement en dj en domaine d'oc. Seul le béarnais voit un affaiblissement en /y/.
|
latin LPC
|
|
occitan
|
|
français
|
|
C + /yy/ dĭ, gĭ : voir dĭ |
|
C + /y/ (béar) |
|
C + /dj/ > /j/ |
|
hŏrdĕŭm |
> |
òrdi |
|
orge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau : (à continuer)
À l'intervocalique
Selon (IPHAF:77) : "Par la suite en Gaule (et en Ibérie) le yy géminé intervocalique s'est affaibli et simplifié en y au Ve siècle."
L'auteur omet le sud de la Gaule, ou yy intervocalique a souvent donné /dj/, par exemple :
nominatif mājŏr > oc màger ;
accusatif mājōrĕm > oc major.
(Pour le français "majeur", la prononciation initiale était maieur : FEW 6/1:59b).
|
latin LPC
|
|
occitan
|
|
français
|
|
/ -dĭ-, -gĭ- : voir dĭ |
|
/y/ (béar) |
|
/j/ |
|
rădĭāre |
|
raiar |
|
(couler) |
|
cŏrrĭgĭăm |
|
correia |
|
courroie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mājŏr |
|
màier (béar) maire "maire" |
|
(aîné)
maire |
|
|
|
|
|
|
Tableau : évolution de yod à
l'intervocalique, identique à celle de dy,
gy intervocalique.
À l'intervocalique, l'évolution de g
intervocalique donne plusieurs aboutissements, voir ci-dessus évolution
de
g intervocalique.
Les deux aboutissements populaires principaux sont /y/ et /dj/.
Ainsi on peut supposer les deux scénarios suivants :
- plāgă(m) >
- plāgă(m) >
L'aboutissement plaga semble
être une le fruit d'une influence savante.
(K intervocalique devant e et i
a déjà subi les
Devant a, o, u, à
l'intervocalique :
- Devant a :
Citons GIPPM-2:85 : "Dans la
région
À continuer.
pedica > piège.
Voir aussi la convergence de v, b, f latins à l'intervocalique.
Voir par exemple la carte ALF:923 "du vin nouveau". On y voit à la fois l'évolution du v initial (vin) et du v intervocalique (novèu). Ces deux évolutions mènent exactement aux mêmes aboutissements dans les mêmes aires géographiques : /v/ à l'est et /b/ à l'ouest : lo vin novèu / lo bi(n) nobèu.
Concernant la position postconsonantique, les aboutissements sont, eux aussi, conformes au même schéma, voir par exemple la carte ALF:1226 "servante" (le type servènta/serbènta est représenté à peu près partout, malgré l'emploi d'autres types, notamment chambriera).
En Gascogne
existent deux autres aboutissement, seulement en position intervocalique
: /w/ ou /
Enfin, le v intervocalique devenu final évolue en
Dans toutes les régions du domaine d'oc, les destins de v et b latins intervocaliques se sont confondus (évolution de b intervocalique), même en position intervocalique devenue finale : clăvĕm > clau "clef", trăbĕm > trau "poutre". (Il faut que j'étudie finement les cartes AFL en Gascogne, où je ne sais pas si v et b donnent exactement la même répartition de w, β).
| v /w/ latin (1) | > | v
/v/ à l'est, b /b/
à l'ouest (de l'Hérault et la Lozère à la Gascogne) (2) (cartes ALF "du vin nouveau", "laver", "servante") |
| u /w/ à l'intervocalique en Gascogne
(avec une variante / |
||
| -u /w/ en position
intervocalique devenue finale, dans tout le domaine occitan (carte ALF "clé") |
(1) Si intervocalique au contact de o, u : amuïssement de v (pă(v)ōrĕm > paur)
(2) À l'ouest du domaine d'oc, la graphie normée écrit v tout en prononçant [b].
PCLO:25 : (trad.oc.) "La distinction entre les noms B = bé
haute (B nauta) et V = bé basse (V bassa) est surtout
utile en gascon et en languedocien, qui prononcent ces lettres
indentiquement." La notation
(3) En gascon, voir l'orthographe du même aboutissement pour b latin > u. Par exemple pour [lawa] "laver", on écrit lauar, mais l'orthographe lavar est possible :
- voir w (w n'est utilisé que pour les mots d'origine étrangère) ;
- ARLOG:4 : "Dans les parlers où le b et le v latins intervocaliques aboutissent à u (w semi-consonne) au lieu de v, on admettra les doubles graphies: víver ou víuer, déver ou déuer, dava, ou daua, ivèrn ou iuèrn."
- PCLO:30 : "(...) dins certans parlars gascons parlaua, sentiua [par'lawɔ, sen'tiwɔ] que podèm escriure tanben parlava, sentiva."
Voir schéma général ci-dessus.
|
latin
|
|
occitan
|
| v- | v- est [v], ouest [b] | |
| văccă(m) |
vaca "vache" |
|
| vĕnīrĕ |
venir "venir" |
|
| vĕntŭ(m) |
vènt "vent" |
|
| vīnŭ(m) |
vin "vin" |
|
| vōcĕ(m) |
votz "voix" |
|
| *vŏlērĕ |
voler "vouloir" |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : exemples de
l'évolution de v initial.
Voir schéma général ci-dessus.
|
latin
|
|
occitan
|
| -v- non au contact de o, u | ||
| -v- | -v- est [v], ouest [b], g [w] | |
| -īvă(m)
(1) |
-iva "-ive" (1) |
|
| avellānă(m) |
avelana "noisette" |
|
| Avennĭōnĕ(m) |
Avinhon "Avignon" |
|
| căvārĕ |
cavar "creuser" |
|
| lăvārĕ |
lavar "laver" |
|
| -v-
au contact de o, u voir amuïssement de v (pă(v)ōrĕm > paur) |
||
| -v-
intervocalique devenu final ou préconsonantique voir vocalisation de v (clāvĕm > clau, vīv(ĕ)rĕ > viure) |
||
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : exemples de l'évolution de v intervocalique.
(1) Pour le suffixe
Ci-dessous, voir l'évolution dialectale de ăquă : ăquă(m) > èwe > dial.O. ève (aussi sav èva).
Ci-dessus, voir *pŏtērĕ > pouvoir, pæŏnĭă > pivoine.
Voir schéma général ci-dessus.
advenire > avenir
*adventura > aventura
invadere > envazir
invidiam > enveja
inversus > envers
inviar > enviar
invitare > envidar
Arvernia > Alvernha (dissimilation rv > lv)
|
latin
|
|
occitan
|
| - |
- |
|
| cĕrvīcĕ(m) |
AO
cervitz "nuque" |
|
| sĭlvātĭcŭm > sălvātĭcŭ(m) |
sauvatge "sauvage" |
|
| sĕrvīrĕ |
servir "servir" |
|
| v après consonne devenu final | ||
| - |
||
| calvŭ(m) |
cau, AO calv "chauve" | |
| cĕrvŭ(m) |
AO
c |
|
| sĕrvŭ(m) |
AO
s |
|
| type cŏrvŭs > *cŏrbŭs (ci-dessous) | ||
cŏrvŭs > *cŏrbŭs cĕrvŭm > *cĕrbŭm |
- AO c AO c |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : exemples de l'évolution de v post-consonantique
Voir ci-dessous cŏrvŭs > *cŏrbŭs.
Ainsi les constatations ci-dessus montrent que v /
Dans l'Empire Romain, au cours du Ier siècle après J.-C., le
waw
Donc dans le courant du premier siècle :
v
/w/ > /
(sauf à l'intervocalique au contact de o, u où v s'amuït : pă(v)ōrĕm
> paur "peur")
vīnŭm
/wiːnʋ/ >
clāvĕm
/klaːwé/ >
sĕrvīrĕ
/serwiːré/ >
Pour les valeurs phonétiques de la lettre grecque β, voir β grec.
D'après les linguistes, les translittérations grecques de noms latins
au cours du Ier siècle après J.-C. montrent que v
latin évolue de /
Les hellénistes utilisent les translittérations grecques pour
déduire que β grec évolue de /b/ vers /
(DHANJ:159) "A une époque ancienne, le v
latin, qui sonnait w, se trouve rendu par ου : Valerius,
Οὐαλέριος [Oualérios]. Or, au commencement de l’ère chrétienne on
voit apparaître des graphies comme Βαλέριος [Balérios], ou
Βεργίλιος [Bergílios] pour Vergilius. Il s'en faut que le
phénomène soit alors de règle : pendant plusieurs siècles encore ου
alterne avec β; mais en tout cas cela montre bien que le b grec
s’est changé en
(PHMGA:55) : "Lors de la conquête romaine, les
D'autre part, les latinistes utilisent les translittérations
grecques pour déduire que v latin /
(ILV:50) "La semi-voyelle w avait à
l'origine le son fricatif labiovélaire qu'a le fr. oui et
l'angl. wind, ainsi que cela résulte de notices de grammairiens
romains et de transcriptions grecques telles que Ούαλεριος [Oualerios]
= Valerius, Ούεσούιον [Ouesouion] = Vesuvius.
Puis à partir du 1er siècle de notre ère, on commence à
transcrire par ex. Nἐρβας [Nérbas] à côté de Nἐρουας [Nérouas]
= Nerva, Βέσβιον [Bésbion] = Vesuvius ;
Pompéi 2837, 2840 Βειβιω [Beibiô] = Vībiō. [...] [À
propos de b et v :] C'est que l'un et l'autre étaient
passés à la constrictive bilabiale
(IPHAF:145) "Jusqu'au Ier siècle les
transcriptions grecques des noms latins rendent régulièrement le w latin
par la graphie ου, ce qui atteste du caractère labio-vélaire. Dans le
courant du Ier siècle apparaît une transcription concurrente
à l'aide du bêta (lui-même devenu
On peut citer aussi les translittérations en grec de différents noms latins :
- Le nom de l'empereur Vespasien Vespasianus (empereur de 69 à 79 après J.-C.) : Ουεσπασιανός (Ouespasianós) et plus rarement Βεσπασιανός (Bespasianós).
- Le nom de l'empereur Valérien Valerianus (empereur de 253 à 260 après J.-C.) : au tout début du Moyen Âge, Zosime hésite encore entre deux orthographes : Βαλεριανός (Balerianós) (I, 29, 1) et Ούαλεριανός (Oualerianós) (I, 30, 1) (ESSA:109).
- Le nom de la ville de Vienne Vienna
(
Voici mes réflexions (ce sont seulement des réflexions éparses, menant à des hypothèses parfois contradictoires, mais nécessaires pour construire un raisonnement cohérent, qui reste encore à construire) :
● Il est certain que la prononciation classique de v latin est
/
● La prononciation classique de b latin (et β grec ?) est moins
bien assurée : en général /b/ est admise, mais /
● Par un raisonnement sur l'évolution phonétique, depuis /
● Malgré les considérations des linguistes, il faut remarquer que si la
lettre grecque β était réalisée /b/ au Ier siècle (et non /
● On peut se poser la question de l'influence réciproque du latin et du
grec l'un sur l'autre : à partir de l'an 31 avant J.-C., l'Empire romain
a la maîtrise totale sur la Grèce et les royaumes hellénistiques ; la
prononciation latine aurait pu influencer la prononciation grecque (ou
réciproquement), aboutissant à une coïncidence temporelle de
l'apparition /
● Les exemples de mots latins ci-dessus ont fréquemment v à
l'initiale : Valerius, Valerianus, Vesuvius, Vergilius, Vespasianus
; pourtant, même s'ils sont passés par un stade
Il existe des inscriptions latines où v et b
initiaux sont confondus après un mot se terminant par une voyelle. Cela
montre que dans ces cas, v et
b avaient très probablement convergé vers une même prononciation,
à savoir /
Cette confusion a dû être corrigée par la suite, "par suite d'un
nivellement analogique" (
(RDL:203)
Les attestations ci-dessous témoignent très certainement d'une prononciation identique de b et v intervocaliques, car les deux lettres ont été confondues à l'écrit.
● v est écrit à la place de b :
- à l'initiale après un mot se terminant par une voyelle : patronae vene merenti (CIL VI, 12210) pour patronae bene merenti ; habe vene valeas (CIL XIV, 1169) pour ave bene valeas ((in
● b est écrit à la place de v :
Explication générale de l'évolution de v et b latins
Par exemple : vīnŭm /wiːnʋ/
> /
Je reprends les arguments présentés par les linguistes (qui ne me semblent pas développés à fond), et je tente de raisonner plus avant.
Le schéma ci-dessous explique mon
raisonnement sur l'évolution de
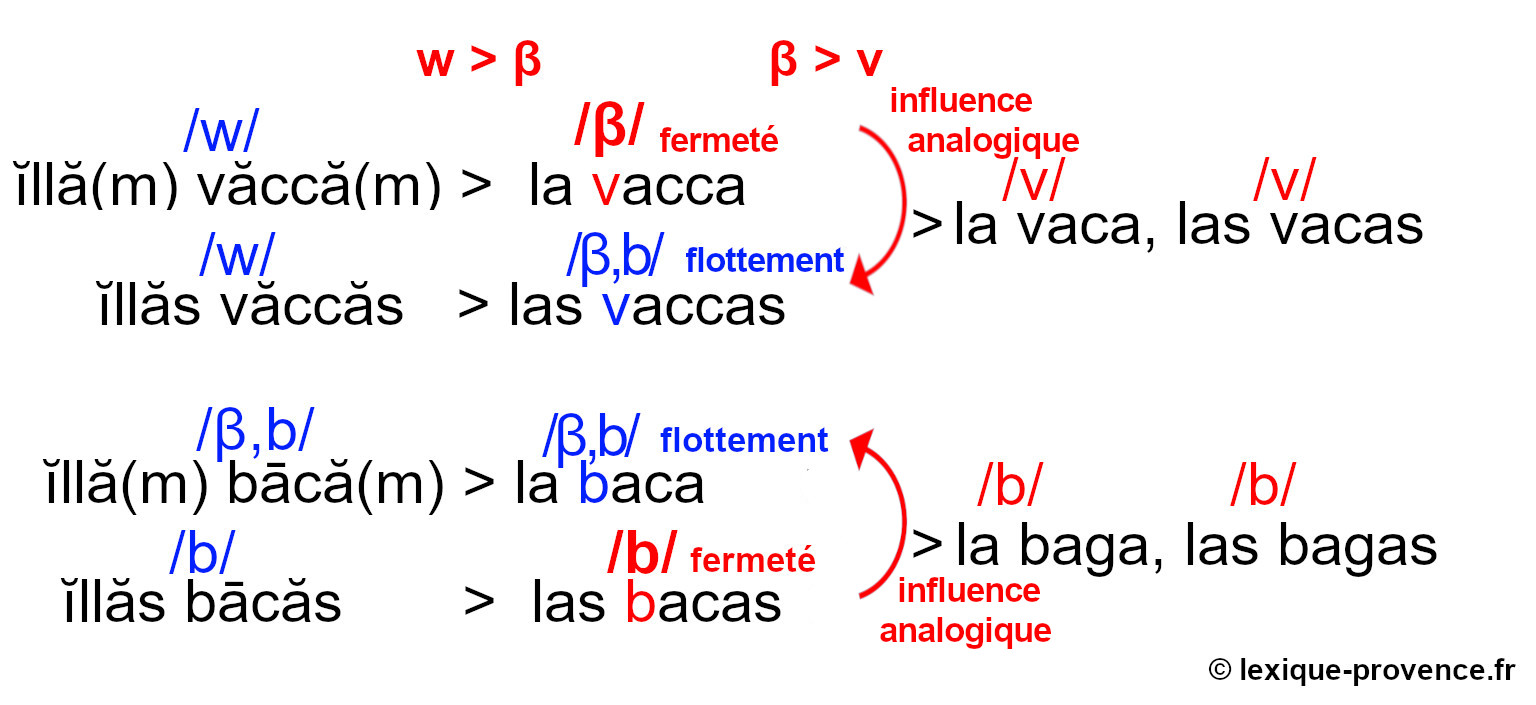
Tableau ci-dessus : conservation de la distinction v initial
/ b initial. (Raisonnement personnel inspiré de
Pour acc ĭllă(m),
le (m) n'était plus prononcé depuis longtemps au Ier
siècle après J.-C.(amuïssement
de
Le v dans la vacca a évolué vers /
Le /b/ dans la baca est en position intervocalique sur
le plan
L'évolution de v intervocalique rejoint ainsi celle de b
intervocalique, probablement
prononcé
[
(Voir convergence de b, v, f intervocaliques).
|
b
intervocalique (prob.
/ |
> |
/ |
| v
/ |
Convergence de b intervocalique et de v au cours du Ier siècle après J.-C.
● Les deux translittérations en grec du nom de l'empereur Nerva (né 30 après J.-C. — mort en 98 après J.-C.) attestent de cette transformation /w/ > /β/ au Ier siècle après J.-C. : Nἐρουας / Nἐρβας, Nérouas / Nérβas) (IPHAF:145) : le
Voir notamment cŏrvŭs > cŏrbŭs ci-dessus.
Les attestations ci-dessous témoignent très certainement d'une prononciation identique de b et v intervocaliques, car les deux lettres ont été confondues à l'écrit.
● v est écrit à la place de b :
juvente pour jubente (Ier siècle après J.-C.), incomparavili pour incomparabili, liventer pour libenter, avetat pour habitat, aveo pour habeo (CIL in
● b est écrit à la place de v :
- à l'initiale après mot se terminant par une voyelle : Vitalio baliat pour Vitalio valeat, a bobis pour a vobis, qui bixit pour qui vixit (CIL in
À partir de cette étape où /
Selon F. de La Chaussée (IPHAF:183), dans la deuxième moitié du IIIe
siècle, il y a renforcement (
L'évolution /
Selon une proposition ci-dessous (vocalisation
du v), la fortition de /
Donc dans la deuxième moitié du IIIe siècle dans une bonne partie du sud de la Gaule :
/
/kla:
/ser
Si le v devient final au
moment des apocopes, il se vocalise en /ʋ̯/, voir vocalisation
du
v devenu final en occitan
:
/klavé/ > /klav/ > clau "clé"
Après cette étape, de nombreux mots germaniques a.b.fr. en
Une petite série de mots latins en ŭv montrent une évolution en ŏv ; il en est de même pour ōvŭm > ŏvum "œuf".
Au cours du premier siècle après J.-C., l'évolution /
Je cite F. de La Chaussée : "Le passage de
jŭvĕnĕ > *jŏvene
'jeune" ;
ōvŭm > *ŏvum
"œuf".
Pour plŭĕrĕ, et d'autres mots, il y a v non écrit : les évolutions de jŭvĕnĕm et plŭĕrĕ sont exactement les mêmes :
plŭĕrĕ (plŭvĕrĕ) > plŏvĕrĕ "pleuvoir" (Pétrone) ;
fluvium > *flovium >
clŭācă (clŭvācă ?) > clŏvācă, clŏācă "égoût" (voir clŭĕrĕ "nettoyer").
J. Ronjat ne donne pas d'explication à cette évolution ŭ
> ŏ, mais pour ōvŭm > ŏvum, dans sa note (1↓)
il écrit : "ōvum > *ōum > *ŏum
comme *dēus > dĕus (...) et
extension analogique de *ŏ- aux
formes où
P. Fouché suit exactement la même position, si ce n'est simplement "la
différenciation de
(PHF-f2:219)
"Remarque
I. — Tandis que l'esp. joven, le port. joven,
le roum. june, etc. remontent à jŭvene, forme du latin
littéraire, le v. fr. juefne (auj. jeune), l'ital. gi
Aussi (PHF-f2:368) :
(j.m.c.g.) "Remarque
I. — Jŏvenis pour jŭvenis s'explique sans
doute par la différenciation de
(PHF-f2:219) :
"Remarque
II. — Le v. fr. uef (auj. œuf), ainsi que
l'esp. huevo, l'ital. uovo, etc. supposent un type *ŏvu,
différent du lat. litt. ōvum. L'ŏ du type en question
peut s'expliquer par la tendance latine à l'abrègement des voyelles
longues devant une autre voyelle dans une étape où *ōŭ, provenant
de ōvŭ par suite de la chute de
(IPHAF:147)
Après l et r,
Par exemple, le passage corvus"corbeau"
à a.fr., AO c
(PHL4:111) "Mais, sauf en roumain, le passage de v à b
après r et l
n'a laissé dans les langues romanes que des traces isolées, v
ayant le plus souvent persisté (...) . Ce manque d'uniformité n'a pas
encore trouvé d'explication satisfaisante."
(PHL4:110-111) "Par la suite [après l'évolution
/w/ > /β/ dans la seconde moitié du Ier siècle après
J.-C. environ], la fricative v
s'est changée en l'
À étudier : ville belge de Carvo /
Carbo (IA).
Prob,70 alveus non albeus "alveus, pas albeus" (alveus "auge ; bassin ; lit d'un fleuve")
Voici la position de Pierre Fouché (PHF-f3:798) :
"Comment expliquer *cor/bu au
lieu de *cor/vu ? Si l'on songe
que le passage de r/v à r/b se constate en roumain, en
Voici ma position personnelle :
Outre le fait que cette évolution phonétique atteint particulièrement
la
Paires de mots semblables ayant pu causer l'évolution lv > lb et rv > rb (voir ci-dessous exemples de type cŏrvŭs > cŏrbŭs)
- acĕrbŭs
/ cĕrvŭs => *cĕrbŭs
> AO cȩrp
"cerf"
- albŭs / alvĕŭs => albĕŭs "auge" (Prob,70 "alveus non albeus")
- corbĭs, carbō / cŏrvŭs, cŭrvārĕ => *cŏrbŭs, *cŭrbārĕ > AO cǫrp "corbeau", corbar "courber"
- verbŭm / vervix => *verbix > (assimilation v-b > b-b) AO berbitz "brebis"
De plus, il est possible que la réaction des grammairiens de type Prob,70 "alveus non albeus" (alveus "auge ; bassin ; lit d'un fleuve") ait réussi à lutter contre certaines évolutions rv > rb.
Les quelques cas "inverses" où l'on a : /rb/ > /rv/ pourraient s'expliquer par des hypercorrections : var AO vervena, fr "verveine" < verbēnăm ; fr "verve" < verbŭm ; AO arvire , a.fr. arveire (< arbĭtrĭŭm) (FEW 25:67b).
|
latin LPC
|
|
langues romanes
|
| -lv- | -lb-
/ -lv-
/ -l- -lp / -lf ? / -l (fin de mot) |
|
| calvŭ(m) |
AO calv,
cal, fr "chauve" |
|
| Ilvă(m) | Elba
(île d'Elbe) |
|
| malŭăm
> malvă(m)
? |
rou
nalbă |
|
| sălvĭă(m) |
AO salvia,
oc sàuvia
rou salbie / salvie |
|
| sălvŭ(m) |
(adj) AO
salp,
saub, salv,
salf, sal,
fr "sauf" |
|
|
|
|
|
| -rv- | -rb-
/ -rv-
/ -r- -rp / -rf ? / -r (fin de mot) |
|
| cĕrvŭ(m) |
AO c fr "cerf", it cervo, esp ciervo, rou cerb |
|
| cŏrvŭ(m) | AO c a.fr. corp, corf, dér "corbeau", rou corb, it corvo, esp cuervo, port corvo |
|
| cŭrvārĕ | oc corbar, fr "courber" | |
| cŭrvŭ(m) | AO c |
|
| ervŭ(m) |
AO
(pl) ȩ cat erp |
|
| nervĭŭ(m) |
AO nęrvi, esp nervio | |
| nervŭ(m) |
AO ner, fr "nerf", it nervo |
|
| servirĕ |
AO servir, fr "servir" | |
| servŭ(m) | fr "serf" AO sȩ |
|
| vervēcĕ(m) | it berbice, rou berbece, oc lim berbitz, fr "brebis" | |
Tableau. Exemples de la
diversité des aboutissements de /l
En bleu : /w/ > /b/ (/p/ en position finale) ;
En vert : /w/ > /v/ (/f/ en position finale) ;
En rouge : /w/ > /v/ par la voie savante (mots en -i, -ia) ;
En mauve : aboutissements par amuïssement de v au contact de o, u.
Dans PHL4:110-111 ont été pris notamment les exemples
en roumain.
Remarque : il faut que j'étudie la convergence de W germanique avec QV
latin comme dans ăquăm
ci-dessous, avec des traitements dialectaux semblables. Voir aussi le digramme GV ci-dessus.
Dans les lexiques occitan et français, certains mots sont d'origine
germanique. Une bonne proportion a dû être amenée au moment des grandes
invasions (au Ve siècle, voir superstrat),
mais certains d'entre eux ont peut-être trouvé leur place très tôt dans
le lexique latin : *warnjan
> garnir ; *wîsa > guise
(IPHAF:151).
Il est connu que le waw (
- > /
- > /v/ en allemand et en néerlandais.
- Parfois on trouve l'équivalent /
Cependant dans le domaine
Voici les mots concernés ; ils proviennent de l'a.b.fr. apporté par les francs, et peut-être
d'introductions encore plus anciennes pour *warnjan
> garnir, *wîsa > guise.
| ancien bas francique /w/ |
/g/ |
/w/, /vw/, /gw/ |
/v/,
/b/ |
/v/ allemand, néerlandais |
|
|
|
|
|
|
|
|
oc gatge, fr "gage" | all Wette | ||
|
(angl wait) |
oc gachar, fr "guetter" | (voir
fr emprunt "bivouac") |
all, néerl wachten | |
|
|
oc gaire, fr "guère" | - S-W waire, gwaire | m.h.all unweiger | |
|
(angl win) |
oc gasanhar, ganhar, fr "gagner" | "cultiver
;
semer" - 57 wẽñè, 39 vwèñi, vwañi, - sav wañi, vwañir.. - Gen wòñir "gagner" - a.wal. waignier, wall wangni, wâgni ; - poit goigni ; - Metz wẽñi |
"cultiver ; semer" - 88 vẽñi, 25 võñi... - sav vagnir, vagner... - Gen vòñir "gagner" - vsoan vañér |
all winnen |
|
(angl well) |
AO
gala "réjouissance",
AO
galant, fr "galant" |
all wohl, néerl wel | ||
|
(angl well leap) ou *walhlaup (1) |
AO galaupar, fr "galoper" | all wohl laufen, néerl wel lopen | ||
|
- oc gama,
rouerg
gòma "goître des brebis" - AO gambais "pourpoint rembourré ; sorte d'étoffe" ; - oc (d) gambèi "estomac d'un cochon tué" |
- Val wamba "estomac d'une bête de boucherie" | Lim vama, rouerg, bòma,Vel bama "goître des brebis" | |
|
| oc gant, fr "gant" | -
wall want, - S-W gwant |
all Wanten, néerl want | ||
| oc gardar, fr "garder" | all warten | |||
| oc garant, fr "garant", garantir |
all bewähren |
|||
| oc garir, fr "guérir" |
-
Val warir, werir, vwarir, - wall warir, - S-W warir, gwarir |
- Sav varir | ||
| oc garnir, fr "garnir" | all warnen |
|||
(angl war < a.norm. werre) |
oc guèrra, fr "guerre" |
|
||
| oc guisa, fr "guise" | PassClerm vise (wise ?) | PassClerm vise | all Weise |
|
| AO gazarma, guizarma, fr "guisarme" | ||||
| fr "gâtine" | ||||
|
|
|
|
|
|
Ci-dessus
: étude dialectale du devenir des étymons a.b.fr. en w-. Dans le domaine
gallo-roman, on voit que /w/ a évolué en /g/ de façon majoritaire, mais
d'autres variantes existent : /w/, /vw/, /gw/, /v/, /b/.
à étudier :
a.b.fr. *wrakkjo > gars, garçon
a.b.fr. *wratja
> garança "garance"
a.b.fr. *wrokkôn
> AO
garr
a.b.fr. *gart
ou *gardo « clôture » >
jardin
a.b.fr. *dwaligôn
> AO
galiar "tromper ; séduire"
a.h.all. Willahelm (angl William) > oc Guilhèm, fr "Guillaume"
a.h.all. wankôn > gancilhar (allemand wanken)
a.h.all. wandjan > gandir (allemand wenden)
*warôn
> garar, garer
got wahsjan > AO gaisar "drageonner ; s'élargir"
got *garwon
> galbe, garbier2, *garwi
> gabarit
celtique gal- "force" > galhard "gaillard"
gall. *warna
> garna "ramée de pin ou de sapin" "tranche de pomme
séchée..."
L'évolution en latin /
(IPHAF:97)
"Les Germains introduisent dans la langue, à l'initiale des mots, des
-
-
-
L'évolution décrite ci-dessus est la même que pour le w (و) arabe initial passé en espagnol :
ar wād (واد) "oued, fleuve" > esp guad- /gwad/ : Guadalquivir, Guadalajara, Guadalope (> "Guadeloupe"), etc.
Voir aussi ci-dessus (en position non initiale) lat
mĭnŭĕrĕ >
mĭnŭārĕ > menguar
"amenuiser", et également les réalisations (en position initiale) güevo [gwé
Ainsi selon moi, il apparaît qu'au fil des siècles, l'espagnol ait conservé une tendance ancienne de transformer /w/ initial en /gw/, tendance autrefois très répandue dans l'Empire romain, après l'évolution /w/ latin > /β/.
eee
Certains mots latins montrent une évolution de v
initial comme le waw germanique ci-dessus :
/
vădŭm >
gasa "gué"
vastārĕ > gastar "gâter"
vĕspăm > guèspa "guêpe"
Cette évolution s'expliquerait de la manière suivante :
(IPHAF:97)
"Il [le traitement du w germanique] a contaminé des mots bien latins, par croisement avec des mots germaniques de même sens qui leur ressemblaient :
vadum X
*wad- > gwadʋ
[gué]
vastare X
*wôst- > gwastare [gâter]
vespa X *wafsa > gwespa [guêpe]"
Aussi :
vagina X
*wagi > gaina [gaine]
Concernant le
- le gaulois n'aurait pas possédé /gw/ à l'initiale (par contre
les
« The Proto-Celtic voiced labiovelar *gʷ
(from PIE *gʷʰ) became w: *gʷediūmi
→
(
« Celtic /w/ (written u in Latin texts and ou in Greek) became gw- in initial position, -w- internally, whereas in Gaelic it is f- in initial position and disappears internally:
- Proto-Celtic
- Proto-Celtic *wassos
"servant, young man" became Welsh, Cornish and Breton gwas.
Contrast Middle Irish foss. »
Pour */
(gaul) *wadana "eau" > (dial) gasne
"mare", "guenipe", "guenon" (CNRTL
"guenipe").
(gaul) *werno > "verne" (aulne) (CNRTL "verne").
Pour /v/ gaulois à l'initiale : A. Moroldo cite Verodunum > "Verdun", de (gaul) vero "puissant", (gaul) dun "forteresse" ; il illustre ainsi le passage /v/ gaul > "/v/ latin" (mais ce dernier n'existe pas !) > /v/ français. Il donne d'autres exemples pour illustrer /v/ gaul > /w/ (Wavrille, Woëvre dans l'Est), /v/ gaul > gw > g (Le Gavre, 44 ; Gavres 56 ; Gavrai 50 ; Gavrelle 62) de (gaul) *vobero "ruisseau caché". (/W/LG:11).
L'existence de /v/ à l'initiale en gaulois semble donc bien difficile à
prouver.
À l'intervocalique : ??
Comparaison avec les langues germaniques
(voir ci-dessous : évolution du waw
germanique)
Les consonnes v
et b se rejoignent dès
le premier siècle pour donner /
Le v / b final se vocalise toujours en occitan, mais jamais en français :
clāvĕ(m)
> oc clau,
fr "clef" (a.fr. /kléf/)
Le v / b préconsonantique montre de nombreux cas de vocalisation en occitan, mais rarement en français :
vīvĕrĕ > (syncope) *vīvrĕ > oc viure, fr "vivre"
scrībĕrĕ > (syncope) *escrīvrĕ > oc escriure, fr "écrire"
(Voir aussi évolution de v devenu final à "Apocopes").
Lorsque v / b parvient en
position finale au moment des apocopes,
il est vocalisé en /
Déclinaisons de l'ancien occitan :
En AO et en a.fr., v / b est suivi de s final au CSS. Donc on doit intégrer ce cas au paragraphe suivant (v / b préconsonantiques), en n'oubliant pas les interactions analogiques entre les CSS et les CRS qui n'ont pas manqué de se produire.
(n.)
clāvĭs
> AO
(CSS) claus
/klaʋ̯s/ "clé"
Conjugaisons de l'ancien occitan :
En latin, la consonne du radical dans bibere, vivere... parvient en position finale après les apocopes seulement au présent, à la 1e.p.s. bĭbō > *bév, et dans le futur domaine occitan aussi à la 3e.p.s.) car il y a
Pour l'AO :
bĭbō > beu "je bois".
Dans les formes conjuguées, l'a.fr. donne aussi un -f final dans les verbes à radical en -v, à la 1e.p.s. :
vīvō >
je vif "je vis" (
lăvō >
je lef "je lave" (
lĕvō > je lief "je lève" ;
bĭbō >
je boif "je bois".
Pour la première conjugaison, comme attendu pour l'a.fr., les 2e.p.s. et 3e.p.s. sont en -ves, -ve(t) :
Pour la troisième conjugaison, "tu vis", "tu bois" représentent probablement d'anciens *"tu vifs", *"tu boifs").
lăvās > (tu) leves "tu
laves"
lăvăt > (il) leve(t) "il
lave"
bĭbĭs > (tu) *boifs > (tu) bois
vīvĭs > (tu) *vifs > (tu) vis
bĭbĭt > (il) *boift > (il) boit
vīvĭt > (il) *vift > (il) vit
Je considère v / b préconsonantique comme :
- v / b
parvenant au contact antérieur d'une consonne à la suite d'une syncope
: cīvĭtātĕm
> *civtate
- le cas v / b devant ĭ,
ĕ en hiatus > /ʋ̯dj/ doit être rapproché du cas
précédent : abbrĕvĭăt
> abreuja "(il) abrège" ;
- ou bien b
latin devant une consonne (en général r
ou l : les groupes br
et bl sont des muta cum liquida : *oblītārĕ, labră).
Pour cīvĭtātĕm > ciutat "cité" :
cīvĭtātĕm
> (syncope)
*cīvtātĕ > oc ciutat,
a.fr. ciptet
(Alexis)
"cité".
En occitan, il n'y a pas sonorisation de t : ciutat ; en espagnol il y a sonorisation : ciudad.
Selon ALLRL:7, le français "cité"et l'italien città s'expliquent probablement par le scénario :
*cīvtātĕ /
Dans PassClerm il y a deux variantes :
variante de type français : ciptat
; variante de type occitan : ciutat.
(Voir commentaire
sur PassClerm).
Est-il possible qu'en occitan et en catalan (ciutat),
la vocalisation de v conduisît
à une diphtongue iu ayant le
même effet que au ?
C'est-à-dire qui empêcha la sonorisation de la consonne
clāvĭs > AO (CSS) claus (ce dernier cas est rattaché aux apocopes dans le site).
À continuer.
jŭvĕnĕm "jeune" : voir évolution de jŭvĕnĕm (a.fr. juefne)
Français : Cavillonum > Chalon (Chalon-sur-Saône) (en
occitan, cela aurait donné
Devant r :
Pour le français, souvent on aboutit à vr ("vivre"), mais pas toujours ("écrire"). Pour l'occitan, on aboutit souvent à ur (escriure, viure), mais pas toujours : un libre "un livre".
lībrăm > oc liura, fr sav. "libre" (adj.), "livre" (nom fém.)
mŏvērĕ > oc mòure, fr "mouvoir"
scrībĕrĕ > oc escriure, fr "écrire"
vīvĕrĕ > oc viure, fr "vivre".
Après de nombreuses années de réflexion, je pense qu'on peut proposer
une solution à ce qu'on peut considérer comme un grand problème dans
l'évolution phonétique du latin à l'occitan. Je propose ci-dessous trois
pistes d'explication, mais la première a nettement ma préférence, et
aucune explication n'est contradictoire avec une autre.
À première vue, le français est plus logique car il suit le durcissement
de la consonne devenue finale (ou préconsonantique) -v
> -f :
- clăvĕm > "clef" (a.fr. /kléf/) ;
- vīvŭm > "vif" ;
vīvŭs
> *vifs > a.fr.
(CSS) vis
()
- également devant consonne, certaines graphies a.fr. montrent une prononciation dure (bien que leur prononciation réelle soit inconnue) : jŏvĕnĕm > (syncope) a.fr. juefne > "jeune" (Rou) ; cīvĭtātĕm > (syncope) *cīvtātĕ > oc ciutat, a.fr. ciptet (Alexis) "cité", *ciftate ci-dessous.
Donc pour expliquer cette différence d'évolution entre français et
occitan, il me semble qu'il faut trouver une explication qui convienne à
la fois pour les finales et pour l'intérieur des mots.
Voici mon explication la plus plausible :
On peut situer l'évolution de v / b dans un contexte plus général : les nombreuses vocalisations de consonnes devant d'autres consonnes en occitan (pătrĕm > paire...).
Au moment des apocopes, les CSS évoluent ainsi :
...
Ces CSS auraient excercé leur action analogique sur les CRS pour donner clau, viu...
On peut aussi penser que les formes
latines avec v amuï au
contact de o, u
(ci-dessous) de type flāvŭs >
flāŭs "jaune", ont favorisé l'apparition des mots des CSS (AO) de type claus
"clé".
Concernant spécifiquement b, v,
on pourrait considérer une période de prononciation /
En effet au moment des apocopes (vers
le VIIIe siècle ?), la différence entre le français
/kléf/ et l'occitan /klaʋ̯/ pourrait s'expliquer par une prononciation
différente de v :
- /v/ en domaine d'oïl ;
- /
Une prononciation /
Cependant de nos jours, la prononciation /
_________________________________________
Je donne ci-dessous quelques aspects détaillés de cette question.
Je remarque que plusieurs mots concernés
courants (clāvĭs "clé", nāvĭs "bateau") sont de la troisième déclinaison latine. En latin populaire,
même les
Exemple pour l'occitan
: clāvĭs "clé" :
- nom.s. clāvĭs > */klavés/ > (VIIe s. : apocope) */klavs/ > (vocalisation rapide ?) /klaʋ̯s/ claus (CSS)
- acc.s. clāvĕ(m) > */klavé/ > (apocope) */klav/ > (analogie sur les trois autres cas?) > clau (CRS)
- nom.pl.
clāvēs
> */klavés/ > ...
> claus
(CSP) (ou bien
régularisation précoce en clāvēs >
clave > clau)
- acc.pl.
clāvēs
> */klavés/ > ...
> claus
(CRP)
Voir :
AO, CSS la claus (SBen in HLPA)
AO, CSS lo rius (JRud)
(pour rius il est possible aussi qu'il y ait eu amuïssement de v : rīvŏs > rīŭs)
- Groupe f + consonne en français : dans les formes françaises en -fs (CSS...), il est probable que f ou s disparût car -fs était difficile à prononcer : (a.fr.) CSS la clef / clé, le nief "le neveu" (< nĕpŏs), le bues "le bœuf"... Voir aussi juefne >? "jeune".
Voir GEAF:55 :
"F
finale s’amuït quand elle est suivie de s.
On disait autrefois : uns sers, uns
cers et au cas régime un
serf, un cerf.
Des traces de cet amuïssement sont restées dans œuf
et bœuf, que l’on écrit au
pluriel œufs et bœufs,
mais que l’on prononce eu et beu."
Entre deux voyelles, voire après consonne, waw a pu disparaître dans
des conditions favorables. Signalons que l'
(GAP:147)
« Entre deux voyelles, v se maintient si les voyelles qui l'entourent sont toutes deux palatales (a, e, i) ; il disparaît quelquefois quand il est en contact avec une voyelle labiale (o, u) (note : cf le traitement du b intervocalique).
Ex. Provinciam > Proensa ; pavorem
> paor [...]
Dans les terminaisons des parfaits en
À cette citation de Joseph Anglade, il convient de rajouter que l'amuïssement de waw peut se réaliser aussi après consonne, voir ci-dessous : servus, ervum (et sans doute vŏlvĕrĕ, *vŏlvūtŭm > vŏlūtŭm). Il faut remarquer que la situation est similaire à qu + o, u > k + o, u ci-dessous.
Preuves :
Les preuves sont nombreuses, non seulement d'après les descendants
médiévaux ou actuels du latin, mais aussi d'après les témoignages
antiques. Par exemple :
Par exemple Prob blâme quatre erreurs à ce sujet.
Prob,62 flavus non flaus (flavus "jaune")
Prob,174 rivus non rius (rivus "ruisseau", voir ci-dessous)
Par ailleurs Consentius blâme ce barbarisme dans l'exemple de uvam passam.
(prop.tradu.) "Ne paraît-il pas faire un barbarisme par
(ci-dessous ūvăm passăm)
Voir ci-dessous la liste des mots concernés.
Remarque 1 : je pense qu'il est aussi possible que V disparaisse au
moment où il était prononcé /
Remarque 2 : pour les quelques mots en ŏ
Explication phonétique :
Waw et o, u sont
Remarque :
Mais d'autres preuves indiquent que le waw a pu être rétabli : voir le
paragraphe suivant.
Voir ci-dessous Sensibilité à
l'amuïssement de waw.
Les élites ont réagi à plusieurs reprises pour rétablir le waw (IPHAF:144), comme
Prob ci-dessous.
Dès l'Antiquité, cette voie savante a fourni des formes alternatives aux formes populaires. Les formes occitanes comme pavon, pavor pourraient être issues de ces alternatives, voir importance du latin écrit dans la langue d'oc).
Cependant il est souvent difficile de distinguer ces formes de celles issues d'une résolution d'hiatus par épenthèse (paragraphe suivant). Voir ci-dessus Distinguer des épenthèses de restitutions savantes.
La restitution de v s'intègre dans la résolution d'hiatus par épenthèse (ci-dessus).
Ainsi, une autre cause que la réaction savante peut expliquer le
rétablissement de v : la
résolution d'
Voir le paradoxe amuïssement / rétablissement du waw ci-dessus.
Ci-dessous je donne une liste compilée à partir de LILG, Pomp, Prob et Consentius.
Les spécialistes ont été attentifs au fait que le doublet vv, pouvait s'écrire v́ (v avec l'apex, ou accent aigu : serv́s pour servvs). "Cependant il paraît bien établi que la généralité de ces graphies sans v représentait la prononciation réelle." (LILG:63).
| aevŭm > aeŭm "durée, temps" LILG |
| ăvŭncŭlŭ(m) > ăŭncŭlŭ LILG, Pomp (pour AO oncle, avoncle "oncle", voir ci-dessous ăvŭncŭlŭs) |
| ăvŭs > ăŭs "aïeul" LILG, Prob ci-dessus. |
| bătāvŭs > bătāŭs "batave" LILG |
| făvŏr > făŏr "faveur" LILG |
| flāvŭs > flāŭs "jaune" Prob ci-dessus. |
| jŭvĕnālis > juenalis, joenalis "jeune" LILG |
| jŭvĕncŭs > juencus "jeune (animal)" LILG |
| jŭvĕnis > juenis "jeune" LILG (jŭvĕnem > jove / jŭĕnem > joine, voir discussion à jŭvĕnĕm) |
| ? jŭvĕntĭă > juentiă
"?" LILG |
| jŭvĕntĭŭs > juentius (nom de famille ?) LILG |
| jŭvĕntŭs > juentus ; iventi (?) "(de la) jeunesse" LILG (> l g ? joènt / pr jovènt) |
| lascīvŭs > lascīŭs "fôlatre" LILG |
| navŭs > naŭs "diligent ?" LILG |
| nŏvŭs > nŏŭs "neuf, nouveau" LILG |
| ŏctāvŭs > ŏctāus
"huitième ; Octave" Pomp, LILG |
| păvŏr
>
paor "peur" Prob ci-dessus ; voir l'évolution de
l'accusatif păvōrĕm
> AO pa
|
| prīmĭtīvŭs > prīmĭtīŭs "premier (en date)" LILG |
| quadruis (?) LILG |
| rivus
> rius "ruisseau" |
| servŭs > serŭs "esclave" LILG |
| ūvăm passăm > ūăm passăm ( |
| vīvŭm > vīŭm "vivant" LILG |
| vīvŭnt > vīŭnt "ils vivent" LILG |
L'amuïssement de v au contact
de o, u peut se déduire des
descendants dans les langues romanes dans les mots ci-dessous.
| bŏvĕm > esp buey "bœuf" (GIPPM-2:114) |
| *căvōnĕm > *căvōnăm > cauna
(FEW 2:558b) (comme păvōrĕm > paur)
|
| căvŭs > căŭs "creux" (GIPPM-2:114) |
| clāvŭm > clāŭm (IPHAF:118) |
| ĕrvŭm > *ĕrŭm (esp yero "caroube", LEAI:126) |
| gilvus
> gilus ("jaune pâle") (source à mettre) |
| nŏvīcĭă > nŏīcĭă "nouvelle" (GIPPM-2:114) |
| ŏvĭcŭlă(m)
> |
| pāvōnĕ(m)
> |
| păvōrĕ(m) > paore (> paur / pavor "peur") ("pavor non paor" Prob) |
| Prŏvĭncĭă(m) > *Prŏĭncĭă > AO Proença "Provence" |
| rīvŏs > rīŭs > rīvŭs > rīŭs "ruisseau" ("rivus non rius" Prob) (voir ci-dessous) |
| ūvăm > *ūă > (Tarn) usa "luette" (FEW 14:90a, 91a note 1), aussi (Piémont, Nice) ua, uga, uwa, (uva) "raisin ; groseille" (FEW 14:90a) |
| *ūvĭttăm
> *ūĭttă "luette" (voir ūvăm
> ūvăm |
| *ūvŭlăm
> AO l |
Le latin ăvŭncŭlŭ(m) a donné "oncle" ; les linguistes ne s'accordent pas sur le scénario.
1. Selon F. de La Chaussée, le /w/ s'est amuï devant ŭ et a
donné
2. Dans la synthèse de FEW 25:1264b, l'auteur estime que c'est une forme
abrégée *ŭnc(ŭ)lŭ(m) qui est à la base des termes
- oc
- roum
- cat
oncle
Le français "oncle" ne permet pas de conclure puisqu'en tonique, /òn/ comme /ón/ mènent à /ò̃/ (Nasalisations) ; par exemple : cŏntrā > "contre" ; ŭngŭlŭm > "ongle". (Même en a.fr. ?).
(FEW 25:1264b) "Quant à ᴀᴠᴜɴᴄᴜʟᴜs (ou même
1269b (note 97) : "La diphtongue resterait intacte en roumain alors qu'elle aboutirait à [ò] en catalan, cf. Badía² 129, alors que la voyelle accentuée de oncle y est fermée."
(note 98) : "Due, peut-être, à la fausse coupure de la préposition ᴀʙ que l'on croyait reconnaître au début du mot."
Aussi, note 100 analysant les positions de certains auteurs (voir GAP:115 : "Dans oncle il n'y a pas probablement aphérèse de a, mais réduction de deux syllabes en une : avunculum > aunculum > oncle"), l'auteur remarque : "mais la diphtongue devrait rester intacte en occitan !".
L'auteur (FEW 25:1264b) conclut, surtout à partir de
l'aboutissement catalan (mais l'occitan et le roumain le soutiennent
aussi), à l'existence d'un étymon
Les formes AO avoncle, aoncle, mettent les
linguistes dans l'embarras : s'agit-il de formes héritées de ăvŭncŭlŭm
ou de formes savantes ? L'auteur de (FEW 25:1264b) range ces formes dans les
"latinismes". Je dirais que l'absence des formes
Pour de nombreux mots, des formes du même
Même pour des deux mots où v est suivi et précédé par o, u : nŏvus "neuf, nouveau" ; ōvum "œuf", cette lettre a finalement été rétablie.
Voici quelques exemples :
adj. nŏŭs "neuf, nouveau" / nŏvă, nŏvā, nŏvăs, nŏvārum => nŏvŭs "neuf, nouveau"
n.n. ōŭm "œuf" / ōvă... "les œufs" => ōvŭm "œuf"
adj.
vīŭs "vivant" / vīvă...
"vivante" => vīvŭs "vivant"
f.v.
vīŭnt "ils vivent" / vīvĭt...
"il vit" => vīvŭnt "ils
vivent"
Citons GIPPM-2 (p. 115) : "(...) on comprend que toutes
les langues
(1) Voir note de l'auteur reportée ci-dessus.
Pour ces mêmes mots, l'occitan est d'une certaine manière ambigu,
puisqu'il confond les
continuateurs de
(GIPPM-2:115) (r.g.f.d.e.a.) « [...] nos parlers, avec iòu
~ ouéu, etc..., nòu ~ nau, etc., vièu ~ vìu ~
Le français "clou" témoigne d'un amuïssement de v
: clāvŭm > /klaʋ̯/
> /klòʋ̯/ > /klʋ/ "clou" (IPHAF:191), sinon on aurait abouti à
Le sud de la Gaule a sans doute vu pareillement
cette restitution du v dans nŏvŭ(m) etc. Cependant pour
certains mots, il faut procéder à des analyses plus fines. Par exemple rīvŭs "ruisseau", GIPPM-2:115 : "le mot est peut-être plus usité au
sing. qu'au plur." (esp río < rīŭ ? / a.fr. rif
: v restitué GIPPM-2:115).
Contrairement au cas α ci-dessus, certains mots ont un groupe "v
intervocalique en contact avec o, u"
faisant partie de la base radicale, donc insensible à la
Pour la Gaule du Sud (futur domaine d'oc), selon moi, il est probable que ce soit différent : les formes avoncle, ovelha, pavon "paon", pavor sont attestées en AO, parfois en OA. Cette différence entre la Gaule du sud et la Gaule du nord peut provenir de trois causes, sans qu'il soit pour le moment possible de privilégier l'une ou l'autre cause :
- le latin parlé dans le sud est d'origine plus ancienne ;
- l'occitan est plus proche du latin écrit ;
- il y a eu davantage de résolutions
d'hiatus dans le sud (ci-dessus).
Il faut quand même constater que pour les formes comme jŭvĕnis / jŏvĕnis, jŭvĕntŭs / jŭvĕncŭs..., le v a souvent été rétabli, en provençal comme en français (a.fr. jouvent, jovente ; "jouvence", "jouvencelle", pr jovènt, jovènça ; jŏvĕnis > jʋ̯òvene > jʋ̯òvne > jeune IPHAF:112, et voir ci-dessus pr jove, joine).
Voir Dissimilations de labiales (à "Assimilations et dissimilations consonantiques à distance").
Un
Voir aussi hăbēbās > *hăbēās.
Dans Prob, on trouve :
Prob,73 favilla non failla "favilla, pas failla" (făvilla "cendre chaude").
On connaît aussi le cas Faventia
> Faenza (ville d'Italie).
De ce fait, beaucoup d'exemples cités dans le paragraphe ci-dessus "Amuïssement de waw au contact de o, u" peuvent aussi s'expliquer par des dissimilations (comme le signale très justement GIPPM-2:114 : novembrĕs, movĕre, pavor, favor, Favōnius, Flāvōnius > noembres, moere, paor, faor, Faonius). Également Prŏvĭncĭă(m) > AO Proença "Provence", etc.
Le groupe qv transcrit
toujours la consonne /
Son évolution rejoint dans une certaine mesure c + ŏ, ŭ en hiatus
(ci-dessous).
(IPHAF:57)
Schéma général :
QV /
La perte de l'élément
Cette
latin archaïque : sĕquŏndŭs > sĕcŭndŭs
Plaute : cŏquŭs > cŏcŭs
Pomp : quōmŏdŏ > cōmŏdŏ
Prob,37
equs [ĕquŭs]
non ecus (à comparer au fém
ĕquăm > AO
Pour cŏquŭs > cŏcŭs :
cocus (Plaute)
Prob,38 : coqus [cŏquŭs] non cocus (coquus "cuisinier").
| cŏquŭm /ko |
|
| > (plusieurs siècles av.
J.-C. : délabialisation) /kok |
|
| > ( | |
| → AO
c |
|
cŏquŭm
> cŏcŭm
*/kòk
voie 1 : pas de diphtongaison (domaine d'oc : géographie mal définie)
> (vers l'an 400 : sonorisations)
*/kòg
> (vers les VIIe et VIIIe siècles : apocope
puis durcissement
de la consonne devenue finale)
> (diphtongaison
spontanée) */k
> (sonorisations)
*/k
voie 1 :
sud de la Gaule :
nord de la Gaule : (d'après IPHAF:56, qui ne donne que la variante cuou, mais "queux" provient de la variante *cueu, voir type fuego) :
> (Ve siècle : spirantisation
puis amuïssement de g)
*/k
(
fŏcŭm > */fwòw/ "feu",
paucŭm > a.fr. pou
*/pòw/ "peu",
græcŭm > a.fr. grieu */gryèw/ "grec"...)
> (vers l'an 1200 : bascule
des diphtongues) */k
Pour antīquŭs : (à refaire, en s'aidant de Fouché)
(fr
"antique" est un emprunt au latin)
L'aboutissement de antīquŭm est du même
type que pour ămīcŭm
> a.fr.
ami, AO amic.
Or a.fr. ami
est mal expliqué. Les masc a.fr.
ami et anti
pourraient être analogiques de variantes féminines amie
et antie, variantes sans v comme eau
est une variante de ève "eau"
(si je comprends bien le raisonnement de IPHAF:56).
antīquŭ(m)
>
*antīcŭ
> (vers l'an 400 : sonorisations)
*antigu
nord de la
Gaule : évolution pas claire > a.fr. anti
(IPHAF:57, DALF) :
Si la composante
antīquŭ(m)
> (vers l'an 400 : sonorisations)
> (Ve siècle : spirantisation
et amuïssement de g)
> (renforcement tardif w
> v)
> (apocope
et durcissement
de v devenu final)
a.fr.
Il existe aussi la voie 2 ci-dessous : ăquăm > *èʋ̯e > eau ;
logiquement antīquŭm aurait
abouti dans cette voie à
sud de la
Gaule :
> (-ŭ > -o) *antigo
> (apocope
et durcissement
de v devenu final)
AO antic
La consonne QV /
Je qualifie ces
Devant ĕ en hiatus :
Exemples :
lăquĕārĕ
> laçar "lacer"
lăquĕŭm > laç "lacet"
On peut construire le scénario :
/
Donc la délabialisation /
Aussi
en
On peut construire le scénario :
/
tŏrquĕrĕ > tòrcer "tordre"
Cas de quīnquĕ > cinc "cinq" : il y a eu dissimilation des deux qu, le premier est devenu c /k/, le deuxième a subi une délabialisation tardive. De même pour quīnquāgintā "cinquante".
Prob,39 coquens non cocens (coquens "en train de cuire")
Prob,40 coqui non coci (coqui "cuisiniers")
Je qualifie ces
En
QV se délabialise après la palatalisation
ke, ki > che, chi
(début IIIe siècle), et sans doute après la palatalisation
ka- > cha-,
c'est-à-dire après le début du Ve siècle : en français, les
cas ci-dessous mènent à "car", "onques", "jusque" (et non à
quĕm, quĭd
> que (pronom relatif)
quĭd >
qué (pronom neutre)
quī >
cu, quau (pronom interrogatif)
quærĕrĕ
> quèrre "quérir (chercher)"
quĭētŭs > *quetus > AO quet "coi"
quīnquĕ > (dissimilation kw-kw > k-kw > cinc "cinq")
quārē > AO car, quar
unquam > AO ọncas "onques, un jour"
ĭndĕ ūsquĕ > enjusca
"jusque" (ci-dessous ĭndĕ
ūsquĕ)
Hormis les cas de qu
devant ĕ en hiatus traités
ci-dessus, il s'agit de tous les cas de qu
en
Je qualifie ces
Quand elles se réalisent, ces délabialisations sont tardives car leur produit k/g n'est jamais affecté par les troisièmes palatalisations ni par les quatrièmes palatalisations.
Il faut que j'étudie les convergences de QV avec le W germanique ci-dessus, voir aussi digramme GV ci-dessus.
(Pour le français : PHF-z:149 ; IPHAF:58, 119, 125, 210 ; PHF-f2:264, 338 ; PHF-f3:644, 724 ; pour l'occitan, voir une analyse bibliographique dans ÉGPACL:108)
|
ăquă(m)
/a
|
→ it
aqua
|
| (vers l'an 400 : sonorisation)
*/a |
→ esp agua |
|
français
|
|
| → ( |
|
|
voie 1 (dialectes de l'Ouest : PHF-f3:645, et
|
|
→ ( (voir ăquărĭŭm > "évier") |
|
|
voie
2
|
|
|
> */è
|
|
| → ( |
|
|
> (a >
|
|
|
> (chute de ə final ?)
*/è
|
|
|
> (
|
|
|
voie
2a
|
|
| → iau
/yó/ (variante ( |
|
|
voie
2b
|
|
|
> (affaiblissement de
è) > */
|
|
|
> (XVIIe s.
: monophtongaison) /ó/
|
→ eau
/ó/ |
|
occitan
|
|
|
voie
1
|
|
|
> (délabialisation gw
> g) */aga/
|
→ AO aga |
|
voie
2
|
|
|
> (anticipation de w)
*/awgwa/
|
|
|
voie
2a
|
|
|
> (délabialisation gw
> g) */awga/
|
→ AO auga |
|
voie
2b (mal élucidée)
|
|
|
hypothèse 1 : (dissimilation
*[awgwa] > *[aygwa])
|
|
|
hypothèse 2 : (au̯
> ai̯)
|
|
|
hypothèse 3 > (action
analogique de */aygis/
< loc.pl.
Ăquīs ?) */ayga/
|
→ AO aiga |
|
|
|
(1)
(2) Pour
(2) Pour ève, èva : il faut expliquer la variante des Vosges au Doubs : /óv/, /óf/.
(3) L'évolution de */èʋ̯e/ est détaillée dans (IPHAF:58,119), qui fait intervenir l'élément
faible de diphtongue [
(4) Pour */èaʋ̯ə/, selon PHF-f3:644, c'est la chute du ə final qui déclenche la monophtongaison ɑʋ > ó : ʋ perd son caractère intervocalique. Mais la monophtongaison a pu aussi se produire plus tard.
ăquĭlăm > aigla "aigle" (mot mi-savant : les formes populaires se trouvent en a.fr. aille, fr-pr aye, alye) (à développer)
ăquĭlōnĕm > AO aguilon "nord ; vent du nord" (mot mi-savant : le i latin est conservé)
aquisanam, aquisaniam, année 739 (avec ī ? : ăquīsănăm ?) > La Guisana (05) (aflluent de la Durance)
Aquītānĭăm
(Aquītānăm) > lim
Aiguiana [aygiyano/a],
oc La
Guiana [giyano/a] "Guyenne" /güiyèn/
(voir ci-dessus yod
épenthique ; la prononciation française avec gü est déformée par
une mauvaise
interprétation de l'orthographe "type aiguille")
ĕquăm >
AO
(IPHAF:58 : français : ĕquăm > */iè̯gwa/ > */iè̯
æquālĕm > AO egau, (a.fr.) uel, oel, evel, ivel
æquăt > AO
Le fr "suivre" est analogique des formes conjuguées ci-dessous.
sĕquĭt > AO sec, siec
(IPHAF:58-59
français : *sĕquĭt
> siégwét > sié
Remarque : en italien et en espagnol, la réalisation labialisée
et maintenue dans certains cas :
quadrŭm > it quadro /kwadro/, esp cuadro /kwadro/
ăquăm > it aqua /akwa/, esp agua /agwa/
æquālĕm
> it uguale
/
Mais :
quī > it chi /ki/, esp quien /kyén/.
En latin, le groupe gv,
presque exclusivement présent dans le groupe ngv,
transcrit /
Le
ĭnguĭnĕm > engue "aine"
lĭnguăm
> lenga "lange"
La réalisation /gw/ est conservée en italien : lingua
/lingwa/, aussi en espagnol devant a
(lengua /léngwa/).
Voir aussi ci-dessus waw germanique.
J'utilise le vocable "premières palatalisations", conformément à la terminologie de IPHAF:178. Les premières palatalisations commenceraient au début du IIe siècle après J.-C.
La plupart des mots latins concernés étaient des
Les philologues considèrent qu'au Ier après J.-C. (ou
avant ? ci-dessous), les voyelles brèves ĭ,
ĕ en
ĭ,
ĕ en
Ainsi par exemple :
brāchĭŭm [braː-ki-ʋ] > [braː-kyʋ] "bras"
Pour une explication plus précise de la consonification, voir ci-dessus
la citation de G. Millardet.
Des témoignages antiques :
Dans Prob, on trouve les items suivants :
Les items suivants dans Prob blâment visiblement des "yodisations" :
Prob,63 cavea non cavia ["cage"] ;
Prob,66 cochlea non coclia ["coquille d'escargot ; ..."] ;
Prob,72 lancea non lancia ["lance, pique"] ;
Prob,80 solea non solia ["sandale ; ..."] ;
Prob,81 calceus non calcius ["chaussure"] ;
Prob,157 linteum non lintium ["toile de lin ; étoffe ; ..."] ;
etc.
Prob,113 alium non aleum ["ail"] ;
(de même DFL Prob, "ālĭum" : "aleum était considéré comme vulgaire par Porph. [commentaire sur] Hor. Epod. 3, 3")
Prob,114 lilium non lileum ["lis"] ;
etc.
La datation des "yodisations" est : Ier siècle après J.-C. (IPHF:40), idem pour NDSAF:93. Cependant IPHAF:173-174 donne : "les derniers siècles de la république", (c'est-à-dire avant 27 avant J.-C.).
(J'ai commencé à développer ce paragraphe en février 2019.)
Remarque : Le yod épenthique est apparu à d'autres époques et dans
d'autres conditions, voir ci-dessous.
Je pense que dans certains cas, le yod peut provenir d'un yod
épenthique non écrit. On aurait donc :
Exemple : brāchĭŭm
*[braːkiyʋ]
>
(
Il est même possible que ce yod épenthique fût
Exemple : brāchĭŭm
[braːkiyyʋ] > (
Il me semble que ce processus peut expliquer du même coup le renforcement
consonantique
devant yod, mais ce n'est qu'une hypothèse personnelle. La
Exemple : brāchĭŭm
[braːkiyyʋ]
> (
Cette voie doit être mieux étudiée.
Un indice sérieux peut donner une indication sur ce qui pourrait être une prononciation gauloise : le "cartouche de Martialis" découvert à Alise-Sainte-Reine (LDDMAA, RIIG CDO-01-19) :
|
|
|
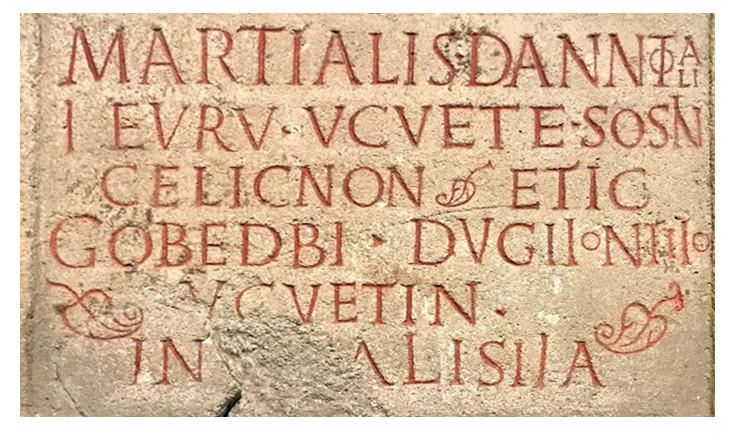 |
Transcription (in RIIG
CDO-01-19)
:
1. MARTIALIS▴DANN⁽OT⁾ALI 2. IEVRV▴VCVETE▴SOS⁽IN⁾ 3. CELICNON ❦ ETIC 4. GOBEDBI▴DVGIIONTIIO 5. ❦ VCVETIN▴❦ 6. IN ALISIIA
Traduction du gaulois proposée par Emmanuel Dupraz (in RIIG CDO-01-19) : "Martialis, fils de Dannotalos, a
offert à Ucuetis ce bâtiment-corporatif et [cela] au nom des
forgerons qui honorent Ucuetis à Alésia". |
|
|
|
Ci-dessus : photographie du "cartouche de Martialis" (Wikipedia Commons). Dans ce texte gaulois, on voit à trois reprises une i longa sans doute à valeur de yod : DIGIIONTIIO, ALISIIA. (Voir aussi i longa à valeur de i long). Selon LDDMAA:253 (ci-dessous), cette i longa représente un yod ; il semble bien que ce yod soit épenthique, peut-être typique d'une prononciation gauloise (hypothèse personnelle).
Voici l'analyse de Michel Leujeune sur cette i longa :
(LDDMAA:253)
"[...] Il n'est donc pas question de pouvoir (ainsi que certains l'ont
fait) reconnaître un e « vulgaire » dans les trois séquences de
deux
Ce texte apporte un regard nouveau sur le gaulois, apparemment sur la façon dont était prononcée le nom de la ville Alesia en gaulois, mais il pose de nouvelles questions, notamment comment interpréter la différence d'orthographe entre Alisiia ci-dessus et Alesia (Alĕsĭa) employé par César ?
La yodisation de ĭ, ĕ a lieu derrière toutes les consonnes sauf dans les cas suivants.
● Si yod est trop difficile à prononcer.
-après qu,
(voir ci-dessous) ; quĭētum
-dans caprĕŏlŭm
[ka-pré-o-lʋm] >
● Si le mot est dissyllabique : ĭ porte toujours l'accent tonique, et une loi semble se dégager en occitan : (voir Dissyllabes de type vĭăm > via à "Évolution des voyelles latines") :
vĭă(m) > via "voie" (voir IPHAF:174) ;
pĭŭm > AO piu, pios "pieux" (mot savant selon MÉ-ainz:576) ;
diam > esp dia "jour" (MÉ-ainz:576).
● type antius > anceis ?
(avec déplacement d'accent sur le i) (Antoine Thomas
(Février 2020) Ce paragraphe est le résultat d'une réflexion personnelle.
Pour plusieurs schémas latins, on observe une tendance, non pas à la
palatalisation de la consonne, mais à sa conservation avec apparition de
/dj/ (ou /dz/) après elle. Après p,
on obtient non pas /dj/ mais /
Pour n et r
suivis de ĭ, ĕ en
Par la palatalisation "normale", on aurait abouti respectivement à /ñ/ et /i̯r/, voir ci-dessous.
n
+ ĭ, ĕ en
- pour n, type līnĕŭm > AO linge "linge" → voir ci-dessous type līnĕŭm > linge.
mn
+ ĭ, ĕ en
- pour mn, type somnĭŭm > AO somge, songe "songe" (à côté de somnhe, sonhe, somni, somi) → voir ci-dessous mn.
r
+ ĭ, ĕ en
- pour r,
type sŏrōrĭŭ(m)
> a.fr. et dial.oïl serorge,
AO
ser
Pour b, v, m, ou p
suivis de ĭ, ĕ en
b,
v, m ou p
(labiales) + ĭ, ĕ
en
Les consonnes b,
v, m, p ne sont pas "palatalisables" (ci-dessous)
; on ne connaît donc pas d'autre aboutissement populaire que cette
consonne suivie de /dj/. Les autres aboutissements connus sont en
Ci-dessous, pour les deux premiers exemples, la diphtongue occitane en u représente l'aboutissement de b ou v en position préconsonantique, voir ci-dessous b, v > /ʋ̯/.
- pour b, type *răbĭă(m) > (g) rauja "rage" → voir ci-dessous b, v + ĭ, ĕ en hiatus.
- pour v, type abbrĕvĭăt > AO abrèuja "il abrège" → voir ci-dessous b, v + ĭ, ĕ en hiatus.
- pour m, type *blasphēmĭārĕ > *blastēmĭārĕ > AO blastenjar "blasphémer" → voir ci-dessous m + ĭ, ĕ en hiatus.
- pour p, type săpĭăt > AO sapcha "(qu'il) sache" → voir ci-dessous p + ĭ, ĕ en hiatus.
La consonification en yod, apparemment
anodine, va avoir des conséquences très importantes sur l'évolution de
la consonne
Pour le vocable "premières palatalisations" ; voir ci-dessus.
Vers le milieu du IIe siècle
après J.-C., le yod, lui-même consonne
Ce domaine est très mal étudié et mériterait
des recherches approfondies. De ce fait, je suis souvent très hésitant
dans certains paragraphes ci-dessous.
En latin vulgaire, certains auteurs
signalent un "renforcement
consonantique devant yod" (si la consonne concernée est
précédée d'une voyelle). C'est-à-dire que l'articulation de la consonne
devant yod devient très marquée, s'allonge en durée, et devient
Pour les "demi-palatalisations",
c'est-à-dire pour les consonnes difficiles à palataliser (r,
s, t), un élément faible de diphtongue i
apparaît : bāsĭārĕ > baisar
(on a donc l'impression que le i
se déplace vers l'avant, voir la synthèse pour i diphtongal de transition).
Ce domaine est mal connu ; F. de La Chaussée en présente une étude
intéressante (IPHAF:74).
Les consonnes palatales obtenues on entraîné
la diphtongaison de è ou ò
Il s'agit d'une ancienne notion, que j'avais
moi-même nommée ainsi, à abandonner. Elle concerne uniquement b,
v + ĭ, ĕ en hiatus ; c'est le type abbrĕvĭăt > abreuja
"il abrège".
Elle constitue une différence avec le
français (diphtongaison
devant
/dj/).
En fait à présent, j'estime qu'il ne s'agit
pas d'une diphtongaison mais d'une conservation de
Toute consonne
Par
contre une demi-palatale n'assure pas l'
Remarque : je me demande dans quelle mesure
cette entrave et ce comportement "comme une géminée" ne recoupe pas le renforcement
consonantique signalé juste ci-dessus. Il est donc possible que
cette théorie développée par F. de La Chaussée soit à rattacher à un
renforcement consonantique.
Ainsi vers le milieu du IIe siècle après J.-C., une vague de
palatalisations atteint toutes les consonnes (sauf qu
/
Voir voie savante : -i, -ia, -iar.
Le suffixe adjectival
Parfois les étymologistes reconstituent des variantes latines en
ăquā, -æ + -ānĕă > *ăquānĕă > aiganha "rosée"
mŏns, -tĭs + -ānĕă > *mŏntānĕă > montanha "montagne"
*berŭnă
(thème berŭlă) > *bernă,
+
De même la variante "savante" bèrlia peut s'expliquer aussi par *berlĕă. Voir bèrla, bèrli, bèrnha, bèrlha.
Le suffixe latin
|
latin
|
latin
|
occitan
|
| arbŏr + -ĕŭs | > arbŏrĕŭs "d'arbre" | |
| argĕntŭs + -ĕŭs | > argĕntĕŭs "d'argent ; argenté" | |
| cĭnĭs + -ĕŭs | > cĭnĕrĕŭs "cendré" | |
| fāgŭs + -ĕă | > fāgĕă "de hêtre" | >
faia
"faine" |
| grāmĕn + -ĕŭs | > grāmĭnĕŭs "de gazon" | |
| lāna + -ĕŭs | > lānĕŭs "de laine" | > lange,
lani "lange" |
| līnŭm + -ĕŭs | > līnĕŭs "de lin" | > linge
"de lin ; linge" |
| vīmĕn + -ĕŭs | > vīmĭnĕŭs "d'osier" | |
| vīnŭm + -ĕă | > vīnĕă "de vin ; vigne" | >
vinha
"vigne" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : exemples de dérivés latins en -ĕŭs avec quelques aboutissemnents en occitan.
Le suffixe élargi
Voir par exemple
Voir aussi :
extrānĕŭ(m)
> estranh(e), estrange
"étranger ; étrange"
Ce suffixe a notamment servi à la formation d'adjectfs par
Le suffixe élargi
vĭŏlă
"violette, fleur" + -ĕŭs >
violācĕŭs "violet"
Ce suffixe est à l'origine du suffixe occitan très productif
Le tableau ci-dessous donne l'aboutissement pour chaque consonne de son
évolution après palatalisation par
|
latin
|
|
occitan
|
| B |
||
| raja,
rauja "rage" |
||
|
|
|
|
| lăncĕă(m) |
lança
"lance" |
|
|
|
|
|
| dĭŭrnŭ(m) |
jorn
"jour" |
|
|
|
F
|
|
| (grăphĭŭm,
cŏfĭă ?) |
còfa
"cosse de légume" |
|
|
|
|
|
| cŏrrĭgĭă(m) | correja "courroie" | |
|
|
|
|
| (jĭ
n'existe pas, yod est |
màger
"aîné" / maire "maire" |
|
|
|
|
|
| fīlĭă(m) |
filha
"fille" |
|
|
|
|
|
| vĭndēmĭă(m) *blasphēmĭārĕ |
AO vendenha
"vendange" AO blastenjar, *blastenhar "blasphémer" |
|
|
|
|
|
| mŏntānĕă(m) |
montanha
"montagne" |
|
|
|
|
|
| săpĭăm |
sache
"(je) sache" |
|
|
|
(QU)
(1)
|
|
| quĭētŭ(m) | quet
"coi" |
|
|
|
|
|
| vărĭāre |
vairar
"changer de couleur" |
|
|
|
|
|
| ma(n)sĭōnĕ(m) |
maison
"maison" |
|
|
|
|
|
| rătĭōnĕ(m) |
rason,
raison "raison" |
|
|
|
V
(
|
|
| plueia
/
plueja "pluie" |
||
| căvĕă(m) | cauja
/
gàbia "cage" |
|
|
|
Z
|
|
| a.h.all. *sazjan |
sasir,
saisir "saisir" |
|
Bilan schématique de la palatalisation de
chaque consonne par yod (< ĭ, ĕ)
(1) Derrière la consonne
Un certain nombre de mots latins contiennent dĭ,
dĕ, gĭ, gĕ en
Schéma général :
| d, g + ĭ, ĕ en
|
> -j- /dj/ ou /dz/, -i- (variantes dialectales ci-dessous) |
|
> -g, -tz, -i en finale
après les apocopes
(mieg, gaug / mietz,
gautz / miei) (-g toujours prononcé /-t |
|
Importance de la voie savante : la voie savante a eu un rôle majeur dans le rétablissement des consonnes d'origine (òrdi "orge", òdi "haine") ou bien dans le cas d'emprunts plus tardifs (stŭdĭŭm > estudi "étude" ?...) (voie savante ci-dessus).
Remarque 1 : Les aboutissements de d, g + ĭ, ĕ en hiatus sont les mêmes que pour yod primaire, et pour g suivi de e, i en position forte (GIPPM-2 p. 19). Ce sont aussi presque les mêmes que pour b, v + ĭ, ĕ en hiatus ci-dessous.
Remarque 2 : Les
transformations présentées ci-dessous concernent d,
g + ĭ, ĕ + en
Je donne le scénario de F. de La Chaussée (IPHAF:76-77).
Scénario de F. de La Chaussée (IPHAF:76-77) : au cours du Ier siècle
après J.-C., pour ces groupes dĭ, dĕ,
gĭ, gĕ avec ĭ, ĕ en
Si on revoit le scénario avec les prononciations [
Il faut remarquer que le latin classique măjŏr
(< *măgĭŏr) montre déjà une telle évolution (pour la
quantité vocalique, voir măjŏr et non mājŏr).
Le phonème /g/ a donc dû disparaître très tôt dans ce cas.
L'évolution postérieure de /yy/ est décrite à renforcement
du
yod. L'aboutissement est le plus souvent j
/dj/, voir les évolutions dialectales ci-dessous.
Évolution en finale :
En fin de mot, /yy/ devient -g
: gaug, mieg, pueg, mueg, prononcé
/t
L'évolution en finale /dj/ > /t
Diphtongaisons conditionnées :
L'apparition de ce yod entraîne une diphtongaison de è,
ò
Cette partie concerne les aboutissements de d,
g + ĭ, ĕ en hiatus, et on constate une coïncidence partielle
avec b, v + ĭ, ĕ en hiatus et
yod primaire (voir plueia, plueja
"pluie", cauia "cage"
ci-dessous).
L'aboutissement essentiellement de deux types : type j
et type i, mais également type
Remarque : Pour J. Ronjat (GIPPM-2:10-11), g aurait dû disparaître.
(r.g.f.d.a.) "si nos parlers ne font aucune
différence entre d
- type j
: pour la plupart des mots dans la plus grande part du domaine d'oc en
toute position (initiale, après consonne, ou intervocalique), prononcé
/dj/, /dz/, /j/ ;
Pour ces deux mots, on n'a pas de type j en domaine occitan.
Pour hŏdĭē
"aujourd'hui", aucun descendant n'a suivi le type j
: la finale /t
Pour ădjăcēns "étant
situé près", la forme usuelle latine aiace
(> oc aise)
(EPF:211,
217...) implique la même évolution générale. Voir l'étymologie de aise.
- type i :
- en béarnais (40,
64, 65) : /yy/ > /
- pour certains mots provençaux en
- type
- type ch (t
- influence du renforcement devant yod ?
Voir le renforcement
devant yod ci-dessus. Le problème est complexe car certains
auteurs pensent que d et g intervocaliques latins étaient
prononcés
pour g :
X. Gouvert (in DÉROM2-PLRT:42-43) estime que cŏrrĭgĭă,
fāgĕă étaient prononcés avec /
pour d :
Pour l'Italie, certains auteurs font
intervenir la
À continuer pour les autres langues romanes
(espagnol : radium > rayo).
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
latin LPC ( > occitan)
|
| dĭ en hiatus | > |
j /dj/ -g /-t |
| dĕ en hiatus | > |
|
| gĭ en hiatus |
> |
|
| gĕ en hiatus | > |
|
|
Claudĭŭm /Claʋ̯- |
Claudi, Glaudi "Claude" | |
| cŏrrĭgĭăm /kor-ri- |
> |
correja
"courroie", d, béar
correia |
| dĕorsŭm (1) |
> |
AO
j |
| dĭānăm /di-aː-nam/ |
> |
AO jana "cauchemar" (GlosDer) |
| dĭŭrnŭm /di-ʋr-nʋm/ |
> |
jorn, béar iorn |
| exagium /ek-sa- |
> |
assag (> assajar), assai |
| fāgĕăm |
> |
faia
"faine, fruit du hêtre" |
| Gaudĭācŭm |
> |
oc Gaujac,
Jaujac, fr.pr.
Joyeux, fr Jouy...,
Joué... (2) |
| gaudĭŭm /gaʋ̯- |
> |
gaug "joie" |
| glădĭŏlŭm
/gla- |
> |
AO glaiǫl
"glaïeul", lang glaiòli (voir ci-dessous glăvĭŏlŭm) |
| glădĭŭm
/gla- |
gladi, glasi
"glaive" (voir ci-dessous glăvĭŭm) |
|
| hŏdĭē /hó- |
> |
uèi
"aujourd'hui" (3) |
| hŏrdĕŏlŭm | > |
orjòu "orgelet" |
| hŏrdĕŭm /hór-dé-ʋm/ |
> |
v-alp
òrge
"orge"
prov
òrdi "orge"
|
| ĭndĕ ūsquĕ /in-dé-ʋːs-kwé/ | > |
enjusca
"jusque" |
| ĭnŏdiăt /in-o- |
> |
enuia,
enueja "il ennuie" (3) |
| mĕdĭānŭm /mé- |
> |
mejan "moyen" |
| mĕdĭĕtātĕm /mé- |
> |
mitat
"moitié" |
| mĕdĭŏlŭm /mé- |
> |
AO mojǫl "jaune d'œuf", mujòu... |
| mĕdĭŭm /mé- |
> |
mieg "mi-" (3) |
| mŏdĭŏlŭm /mó- |
> |
mujòu
"moyeu" |
| mŏdĭŭm /mó-di-ʋm/ |
> |
mueg,
mieg, miòg... "muid" (3) |
| ŏdĭŭm /ó- |
> | òdi "haine", voir
ci-dessus ĭnŏdiăt. |
| pŏdĭŭm /pó- |
> | pueg, pieg... "colline" (3) |
| Pŏdĭŭm altŭm |
> | Pujaut, Pijaut "Pujaut" (30) (3) |
| rădĭārĕ /ra- |
> |
rajar, raiar "couler ;
rayonner" |
| rĕgĭōnĕm /ré- |
> |
AO
reion region "région" |
| > |
saia,
saja "saie, manteau" |
|
| stŭdĭārĕ /stʋ- |
> |
AO
estujar, estuiar
"rengainer" estudiar "étudier" |
| stŭdĭŭm /stʋ- |
> |
AO estug "étui", estudi "étude" |
| > |
tarjar (pr.ma.) "tarder" |
|
| vĭrĭdĭārĭŭ(m) |
> |
vergier "verger" |
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de dĭ, dĕ, gĭ, gĕ en hiatus en LPC. Les deux premières colonnes présentent les coupures syllabiques par des traits d'union ; l'accent est marqué par le soulignage de la voyelle. En rouge : mots obtenus par la "voie savante", contenant encore le i après la consonne.
(1) Pour dĕorsŭm, voir l'origine dēvorsŭm en ancien archaïque ci-dessus.
(2) Gaudĭācŭm "domaine de Gaudius" a dû donner (DENLF:313) :
- les nombreux Gaujac du domaine d'oc (TGF1:467) ;
- Jaujac (07) en nord-occitan (TGF1:468) ;
- Joyeux (01)
en
- les nombreux Jouy en domaine d'oïl (TGF1:462)
(même probablement Jouy-en-Argonne, 55,
malgré l'attestation Mont Jovis
du XIe siècle,
- les nombreux Joué des dialectes de l'Ouest (TGF1:560) ;
- les nombreux Gouy de Picardie et de Normandie (TGF1:560).
Pour la fin du mot, voir -ĭācŭm.
(3) L'apparition du yod entraîne la diphtongaison conditionnée sur ĕ et ŏ
(IPHAF:74,75)
Dans les cas de Bŭrgŭndĭă, grŭndĭăt,
nd
+ ĭ, ĕ en
Dès le Ier siècle, avant la destruction de Pompéi (79 après
J.-C.) dans par exemple vĕrēcŭndĭăm,
la palatalisation de d conduit
à
/nd
> (palatalisation) /n
> (assimilation réciproque) /ññ/
> (VIIe siècle ? simplification
des
géminées) > /ñ/ écrit nh
en graphie classique
Verecunnia (pour verecundia "vergogne") est attesté dans Pomp (Littré, supplément)
Grunnio "je grogne" est blâmé dans Prob :
Prob,214 grundio non grunnio "grundio, pas grunnio"
Voir aussi plangĕrĕ. Voir ci-dessous le cas différent de căntĭōnĕm.
Remarque : cette évolution populaire latine n'a pas affecté le domaine castillan : vĕrēcŭndĭăm > vergüenza "honte (vergogne)". Là dans vĕrēcŭndĭăm, n et dĭ sont toujours restés disctincts, comme dans hŏrdĕŏlŭm > orzuelo "orgelet".
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
latin LPC ( > occitan)
|
| ndĭ en hiatus | > |
/ndy/
> /n |
| ndĕ en hiatus | > |
|
|
|
||
| Bŭrgŭndĭă(m) | > |
Borgonha "Bourgogne" |
| (Compĕndĭŭm), *Compĕndĭăm | > |
Compienha (Fier) "Compiègne" (60) (1) |
| grandĭŏr
/gran-di-or/ |
> |
"plus
grand" (voir grandĭŏr > AF CS graindre) |
| grandĭōrĕ(m)
/gran-di-oː-ré/ |
> |
AO
granh (AF CR graignor) |
| grŭndĭăt /grʋn-di-at/ | > |
gronha "il grogne" |
| > |
redonha "il rogne" | |
| vĕrēcŭndĭă(m)
/wé-réː-kʋn-di-am/ |
> |
vergonha "honte" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de dĭ, dĕ, gĭ, gĕ en hiatus en LPC. Les deux premières colonnes présentent les coupures syllabiques par des traits d'union ; l'accent est marqué par le soulignage de la voyelle.
(1) Pour Compĕndĭŭm
> Compiègne, il y a eu diphtongaison
conditionnée par /ñ/.
Les
(IPHAF:77, IPHAF:144 : "aïeul", "geôle", GIPPM-1:134-137).
Certains mots latins contiennent bĭ,
bĕ, vĭ, vĕ en
Voyelle + b, v + ĭ, ĕ + hiatus :
| b,
v + ĭ, ĕ en |
||
| > rarement -/t |
||
Voir diphtongaison apparente en u devant /dj/ en occitan, mais pas en français.
Consonne + b, v + ĭ, ĕ en hiatus :
Le cas existe dans sălvĭăm >
sàuvia, sàlvia "sauge", Sălvĭācŭm
> Saujac (
Par ailleurs, pour la langue d'oïl : Ambiānos (peuble des Ambiāni) > "Amiens", Anmien en picard /ɑ̃myè̃/ (Wikipédia). Le /dj/ ne s'est pas développée ; le b a disparu.
Pour b, v entre voyelle et ĭ, ĕ en hiatus, on peut penser à
première vue que la voyelle subit une diphtongaison en /ʋ̯/ en occitan.
J. Ronjat écrit (GIPPM-2:137) : "L'ensemble de ces
(1) Note : L'alternance
L'auteur considère donc l'élément de diphtongue ʋ̯ comme induit par des
analogies. Par
ailleurs, il n'explique pas comment /dj/ apparaît.
(février 2020,
Il me semble clair que comme toute labiale
suivie de ĭ, ĕ en hiatus,
il y a conservation de la labiale (ou plutôt de son dérivé), et
évolution de
En occitan, la labiale v
/
En français, le /
Par exemple pour le type abbrĕvĭăt,
on peut imaginer une prononciation */abbrewiya(t)/,
avec
Les formes a.fr. (il) abriege "il
abrège", fr "liège"
< *lĕvĭŭm, montrent une diphtongaison
spontanée de è (è
< ĕ). Si è se
trouve devant /βy/, /βyy/, ou /βdj/ (scénario 1 ci-dessous), la
diphtongaison est normalement impossible puisque è
est
Par ailleurs, une forme écrite semble soutenir également le scénario 2
ci-dessous, car elle contient i
entre la labiale et /dj/ (absence possible de
Novientum > */nówiyyènt
Le cas est semblable à AO domejon "donjon" ci-dessous.
|
abbrĕvĭăt
*/abr
|
|
| scénario 1 : renforcement du
yod qui suit la labiale (conformément à la position de IPHAF:77) |
|
|
> (/β/
> /ʋ̯/) */abbrè |
|
scénario 2 : renforcement d'un yod épenthique puis syncope (proposition personnelle, février 2020 ; ce scénario me semble plus probable, voir juste ci-dessus : /dj/ < yod épenthique) : |
|
|
*/abbr |
|
|
> (renforcement
du
yod) > */abbr |
|
|
> ( |
|
Remarque 1 : cette
diphtongaison apparente "par l'arrière" peut s'ajouter à la
diphtongaison romane, "par l'avant" :
Remarque 2 : Il faut étudier "-u̯j- avant l'accent, -j- après [en fait sous l'accent]" ainsi que la note (1) (GIPPM-2:137) ci-dessus. Cette alternance existe-t-elle vraiment en AO ?
Voir aussi ci-dessus une certaine coïncidence avec évolutions dialectales pour d, g + ĭ, ĕ en hiatus ci-dessus.
(à mieux étudier, étudier pour le français PHF-f3:906 : "chute de w devant y" : *aviolu > (a.fr.) aiuel > "aïeul", etc.)
Jules Ronjat ci-dessus signale que dès le latin, v pouvait être amuï dans certaines régions.
W. von Wartburg (FEW 9:106b) (trad.all.) "Sur une vaste région, *plovia s'est simplifié en *ploia."
| pluvia |
pluvia |
Aussi : scénario pour cavea ?
Mais dans ces cas, on pourrait aussi invoquer un amuïssement de v par dissimilation de labiales. Par exemple :
*Flāviācu > *Flāiācu > Flaiac (GIPPM-2:137, voir ci-dessus la bipartition Flaiac / Flaujac) (et "Flayat ?", 23);
*Flāvioscu > *Flāioscu > Flaiòsc (83) (GIPPM-2:137) ;
*plŏvĭăm > *plŏjăm > plueia / plueja.
Ce dernier cas (*plŏvĭăm > *plŏĭăm)
peut aussi s'expliquer par amuïssement
de v au contact de o,
u. Voir la note 2
ci-dessous.
Pour les mots essentiellement bordelais ci-dessous, on ne peut pas faire intervenir une dissimilation de labiales ni un amuïssement de v au contact de o, u :
- cauia et auiòu ci-dessous montrent l'évolution b / v > /ʋ̯/ décrite ci-dessus, mais avec yod non renforcé :
- bord cauia "cage" < caveam (TDF "cauyo, cauye") ;
- bord auiòu, aiòu "aïeul", var.lang. auiòl, b.lim. (< ăvĭŏlŭm).
- la disparition de v dans Blaia peut s'expliquer par
"chute de w devant y" comme décrit ci-dessus pour le français, ou bien
peut être issue d'une dissimilation de labiales (puisque B est
une labiale) :
- bord Blaia "Blaye" (33) (< Blāvĭă).
|
|
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
latin LPC (Ier après J.-C.)
|
|
occitan
|
| b +
ĭ, ĕ en |
> |
/ |
> |
/(ʋ̯)dj/ |
| v +
ĭ, ĕ en |
> |
|||
|
(ăbiĕtĕm)
|
|
|
|
cas particulier : ăbiĕtĕm "sapin"
|
|
abbrĕvĭăt
|
|
|
|
abreuja
"(il) abrège"
|
| ăvĭŏlŭ(m) |
aujòu "aïeul" |
|||
| cămbĭārĕ |
AO camjar, cambiar "changer" | |||
| căvĕă(m) |
bord cauja,
pr gàbia
"cage" |
|||
| dīlŭvĭŭ(m) | dilúvi "déluge" |
|||
| *Dīvĭōnĕ(m) | Dijon ( "Dijon" (21) |
|||
| Flāvĭācŭ(m) | Flaujac "Flaujac" ( |
|||
| flŭvĭŭ(m) | flúvi "fleuve" |
|||
| glauja "glaïeul, iris
faux-acore" |
||||
| glaujòu, glaviòl
"glaïeul ; iris faux-acore" (voir ci-dessus glădĭŏlŭm) |
||||
| glavi "glaive" (voir ci-dessus glădĭŭm) |
||||
| lat.class. gōbĭŭ(m) / lat.imp. gōbĭōnĕ(m) |
gòbi "gobie" / "goujon" | |||
| AO
greujar "charger ;
torturer" |
||||
| AO
g |
||||
| leugier "léger" |
||||
| lèuge ; lim
lièuge "léger" ; |
||||
| AO l |
||||
| nŏvĭŭ(m) | nòvi "jeune marié ; fiancé" | |||
| fr "ogive", oc augiva (? voir CNRTL "ogive") | ||||
| pīpĭōnĕ(m) > *pīvĭōnĕ(m) (↓) | pijon "pigeon" (↓) |
|||
| plŭvĭă(m),
|
AO
pl ( |
|||
| quadrĭvĭŭm > *quadrŭvĭŭm
(EPF:260) |
AO
cairọi
; a.fr. carroge, carroi "carrefour,
place" |
|||
| răbĭĕ(m)
>
*răbĭă(m) |
g rauja, pr ràbia "rage" | |||
| rŭbĕŭ(m) |
AO
r |
|||
| AO sabi,
savi, sapi, sage (franc) "sage" |
||||
| sălvĭă(m) | sàuvia, sàlvia
"sauge" |
|||
| Sălvĭācŭ(m)
(3) |
Saujac (12) (3) |
|||
|
|
|
|
|
Sarjac (24), Sergy (01, 02), Cergy (95), Sargé (72) (4) |
| servĭĕntĕ(m) |
|
|
|
sergènt "sergent" |
| Servĭŭs, Sergĭŭs |
|
|
|
Serge (5) |
| tībĭă(m) |
franc : tija, (l) tisa
; "tige" (6) |
|||
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de b, v +
ĭ, ĕ en hiatus en LPC.
En rouge : mots réputés obtenus par "la voie
savante", contenant encore le i
après la consonne.
(2) Pour *plŏvĭă "pluie", le variante *plŏĭă (que j'écrirai *plŏjă) était répandue (CNRTL), et rejoint donc l'évolution de yod. Voir évolution dialectale ci-dessus. Dans l'oc plueja, l'évolution ŏ > ue est une diphtongaison conditionnée par yod dans le mot latin *plŏjă.
(3) Pour Sălvĭācŭm > Saujac, voir GIPPM-2:252.
(4) Pour *Servĭācŭm, *Cervĭācŭ(m) : Sargé (72) : de Cerviaco, IXe siècle,
de Cergiaco, XIIe siècle (DENLF:643 "nom d'homme latin Cervius ou Servius
et suffixe
(5) Les rapports entre Servĭŭs et Sergĭŭs ne sont pas clairs, voir par exemple le nom du consul du IIe siècle Sergius Octavius Laenas Pontianus. Il est possible que les deux noms antiques Sergius (gens Sergia) et Servius (praenomen Servius) convergeassent pour des raisons phonétiques en Sergius.
(6) Pour tībĭăm, on ne connaît pas de descendant en AO : tija est probablement un
Voir GIPPM-2:247.
Quelques rares mots contiennent mĭ,
mĕ en
À l'étude des aboutissements populaires, on peut constater que ceux-ci
convergent vers l'évolution de n + ĭ,
mn + ĭ, voir le modèle
de somnĭŭm.
Schéma général
| m
+ ĭ, ĕ en |
oc. / fr. / |
Évolutions dialectales
Les régions avec /
On trouve aussi le type vendenja
(certains points du 84 ; 87 : Limoges, Eimoutiers),
et il n'est pas évident qu'il s'agisse d'un
Le type vendeima
existe dans la basse vallée de la Drôme, à Monestier-de-Clermont (38) : il s'agit peut-être d'un
traitement populaire (métathèse mi
> im ?).
Détails de l'évolution m + ĭ, ĕ > /ñ/, / ˜ dj/
Par la "voie populaire" les mots en m(n)
+ ĭ,ĕ évoluent en /ndj/ en français, en /
*blasphēmĭārĕ
> *blastēmĭārĕ > AO blastenjar "blâmer"
sīmĭŭm
> "singe"
vĭndēmĭăm > vendenja "vendange"
Aboutissements
en /ñ/ :
Pour les aboutissements de mots latins en ny, my, mmy, mby, mny, selon Pierre Fouché (PHF-f3:937), les variantes françaises en /ñ/ (a.fr. estragne, ligne, chalogne, dongnon, ...) seraient issues des formes en ndj : estrange, linge (?), chalonge, donjon... L'auteur déduit cette filiation en réalisant le parallèle avec les aboutissements de ndĭca, ndŭca : les variantes magner, vengnance (< manducare, vindicare) et quelques autres mots rares, ne peuvent être issus que de "manger", "vengeance". Il déduit une réduction ñ(d)jy > ñ. Cette évolution a eu lieu quasi-exclusivement dans le nord-est de la France et en Wallonie.
Je pense qu'on ne peut pas réaliser un tel raisonnement pour les mots
occitans. En effet, je ne connais pas les variantes
Il me semble qu'on peut proposer plutôt une réfection
de type m
+ ĭ,ĕ > mn + ĭ,ĕ. Les mots AO vend
Aboutissements en /
Comme toutes les labiales suivies de ĭ, ĕ en hiatus, la conservation du son de la labiale (ici son équivalent : nasalisation de la voyelle précédente) suivi de /dj/ peut être expliqué par deux scénarios différents :
- renforcement du yod suivant la labiale (IPHAF:77) ;
- renforcement d'un yod épenthique (scénario personnel). La variante AO domejon "donjon" peut fournir un argument en faveur de ce scénario, avec les étapes possibles :
*dŏm(ĭ)nĭōnĕm
> */domniyyóːné/
> */dómnédjóné/ >
AO
domej
Tableau d'exemples (m + ĭ, ĕ en hiatus)
|
|
|
|
|
latin LPC |
|
occitan / français
|
| m +
ĭ, ĕ en |
> | oc. / fr. / |
| *blasphēmĭārĕ > *blastēmĭārĕ | AO
blastenjar ; blast "blâmer ; (il) blâme" |
|
| blasphēmĭŭm > *blastēmĭŭ(m) | AO
blast |
|
| Maxĭmĭācŭ(m) | Marsangis (51, 89), Massangis (89), Massingy (21 : 3 communes, 89, 74) (1) | |
| Prīmĭācŭ(m) | Pringy (51, 74, 77), Pringé (72), Prangey (52), Prenhac "Preignac" (33), Pranzac (16) (2) | |
| sīmĭŭ(m) | AO simi, fr. singe | |
| vĭndēmĭă(m) |
AO
vend |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de m + ĭ, ĕ en hiatus en LPC. En rouge : mots obtenus par la voie savante, contenant encore le i après la consonne.
(1) Pour Maxĭmĭācŭ(m), source : DENLF:426 ; aussi : Maissemy (02), Messimy (01), Meximieux (01).
(2) Pour Prīmĭācŭ(m), source : DENLF:546 ; pour Pranzac (16) : on est dans la "zone sifflante" (argènt /ardzè̃n/ : le /dz/ équivaut à /dj/ dans la "zone chuintante" ; aussi Prigny (44) < Prumiacum (PP:247-248).
Quelques mots contiennent pĭ, pĕ
en
Schéma général :
p + ĭ, ĕ en
Détails :
Comme toutes les labiales
suivies de ĭ, ĕ en hiatus,
il y a d'abord eu conservation du son de la labiale, suivi d'un autre
son mal déterminé (/dj/ ou son équivalent : /
Ci-dessous dans le tableau, la graphie médiévale dans apropchar,
propchan... exprime selon moi une prononciation conservatrice,
avec p articulé. On peut se
demander si pch était prononcé
[pt
/p
Évolutions dialectales :
À faire.
Tableau d'exemples :
|
|
|
|
|
latin LPC |
|
occitan (et français)
|
| p +
ĭ, ĕ en |
> |
/t |
| ăpĭŭm |
|
AO
api, "ache"
(céleri) |
| apprŏpĭāre |
AO
apropchar, apropïar aprochar > g apropiar, "approcher" |
|
| a.h.a. happja |
|
AO
apcha, "hache" a àpia "hache" |
| a.b.fr. *krippia |
AO
cr |
|
| pīpĭōnĕ(m) (↑) |
|
(du
|
| AO
propchan > prochan,
"prochain" |
||
| săpĭăt |
|
(que) sache, "(qu'il) sache" |
| sēpĭă(m) |
súpia, "seiche" |
|
| Sĭpĭă(m) |
"La
Seiche" (rivière bretonne) |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de p + ĭ, ĕ en hiatus en LPC. En rouge : mots obtenus par la voie savante, contenant encore le i après la consonne.
De nombreux mots latins contiennent lĭ,
lĕ, nĭ, nĕ en
| l
+ ĭ, ĕ en |
> / |
|
n
+ ĭ, ĕ en |
> / |
| > /ndj/ |
Au cours du Ier après J.-C., on obtient /ly/ et /ny/. Puis,
très probablement au cours du IIe siècle après J.-C.,
l'assimilation de
Remarques :
- /
- /
- évolution de nd + ĭ, ĕ en hiatus (vĕrēcŭndĭăm > vergonha) ;
- évolution
du
latin -nge- (plangĕrĕ
> plànher) ;
- évolution
de
-gn- (agnellŭm
> anhèu).
- dans certains cas, la palatalisation lĕ
> lh a pu se produire plus tard (?), voir ci-dessous l'
L'apparition de ces
Pour l initial :
lĕŏ /
lĕōnĕm >AO css
lèu / crs le
lĕŏpardŭs
/ lĕŏpardŭm > AO leopart,
leupart, lhaupart "léopard"
Ces traitements semblent savants, mais la variante graphique lhaupart
semble montrer un traitement populaire, avec palatalisation du l
en position initiale.
Le l
ll + ĭ, ĕ
en hiatus > /
Exemples :
pĭllĕŭm > pelha "haillon",
Căbellĭōnĕm > Cavalhon,
mŏllĭārĕ > mulhar, molhar
"humidifier".
On peut logiquement penser que le scénario suivant s'est réalisé :
/ll
Le n
- (rad.pr.rom.
>)
- sans doute dans des évolutions de somnĭŭm "songe" ;
Par ailleurs, dans le cas ci-dessus nd
+ ĭ en hiatus, la situation est semblable car on aboutit
sans doute à
vĕrēcŭndĭăm > Pomp verecunnia > oc vergonha "honte" ;
grŭndĭō "je grogne" : Prob,214 grundio non grunnio.
On peut proposer le schéma général :
nn + ĭ, ĕ
en hiatus > /
On peut logiquement penser que le scénario suivant s'est réalisé :
/nn
(Voir aussi somnĭŭm à "groupes consonantiques").
Pour mn + ĭ, ĕ en hiatus, une évolution se réalise souvent, pour aboutir à /ndj/. Voir ci-dessus consonne + ĭ, ĕ en hiatus > consonne + /dj/.
călŭmnĭārĕ > AO calonjar "contester ; interdire" (à côté de calonhar, calomniar, calumpniar, voir a.fr. chalengier, chalonger)
*dŏmĭnĭārĭŭm > *dŏmnĭārĭŭm > AO, a.fr. dangier "danger"
*dŏmĭnĭōnĕm > dŏmĭnĭōnĕm > AO donj
somnĭŭm > AO somge, songe "songe" (à côté de somnhe, sonhe, somni, somi)
Certains mots latins avec ĭ, ĕ
en hiatus montrent une évolution différente des "premières
palatalisations normales" décrites ci-dessous : la
consonne devant ĭ,
ĕ demeure inchangée et
elle est suivie de g /dj/ :
n
+ ĭ, ĕ +
exemple : līnĕŭm > linge "linge"
(au lieu de
Voici les cas recensés dans PHF-f3:936-937. Ils concernent surtout
le français, mais aussi l'occitan dans une moindre mesure. Trois adjectifs, peut-être
quatre, sont dans ce cas :
lānĕŭm "de laine" > oc lange "de laine ; lange" (aussi lanhe, lani) ;
līnĕŭm "de lin" > oc linge "linge" (mais līnĕăm > linha "ligne") ;
extrānĕŭm "du dehors" > oc estrange (estrani) "étrange ; étranger" (aussi estranhe, seul attesté en AO, quoique estrangier soit attesté).
(peut-être *crīnĕam > a.pic. cringe, gringe et crigne "crinière").
Certains linguistes interprètent ces évolutions de la manière suivante
: comme la consonne devant ĭ, ĕ
demeure inchangée, il s'agit de "mots adoptés tard dans la langue" (IPHAF:85). "À cette date [Ve, VIe
siècle], la consonne précédant le
Ces mots sont réunis à ceux de type
"Ainsi donc, à la limite des Ve et VIe siècles apparaît un nouveau yod, que l'on conviendra d'appeler tardif" (IPHAF:86).
Pour Jules Ronjat, les mots de type estrange,
linge proviennent de dérivés latins non attestés en
De même, Walter von Wartburg range le type (oc et fr) linge "mince ; grêle ; délicat" comme dérivé de *līnĭcŭs (FEW:5,365b-366a) : (trad.all.) "Cette famille de mots pourrait représenter au nord un līnĕŭ ; mais les formes occitanes imposent un līnĭcŭ." L'auteur ne développe pas sa pensée, mais la forme lirgue, fém lirga (lag12) (TDF "linge" rouerg lirgue), semble bien confirmer un *līnĭcŭs "en lin", voir -nĭcŭm > -rgue.
(Je mets à part les mots en
(Février 2020). Je propose cette nouvelle explication : les mots en
question (līnĕŭs, sŏrōrĭŭs...)
n'ont pas été adoptés tardivement dans la langue, mais il existait une
variante de prononciation, notamment en Gaule du nord, avec un yod
W. von Wartburg exprime également son scepticisme sur la position des
linguistes à propos de extrānĕŭs
(FEW 3:332-333) :
(trad.all.)
"En
Voici le scénario précis que je propose, avec l'exemple de "lange" :
| français
: |
|
| lānĕŭm "en laine" */laːnéyyʋ/ | |
| > */laːné |
|
| > (syncope, causant l' |
→ fr "lange" |
J'étudie ces groupes à part, car certains montrent une absence de palatalisation ("Orly"). Pour le moment, je n'ai que des toponymes.
Une tendance à la
|
latin
|
|
occitan
|
|
français
|
| m-l |
||||
| Camillĭācŭm |
Camilhac (bou33) | Type
Chemilly Chamilly (71), Chemilla (39), Chemillé (37 2 communes, 49), Chemilli (61), Chemilly (03, 70, 89 2 communes) Type Chambly Chambly (60), Chambley (54) (1) |
||
| r-l |
||||
| Aurēlĭācŭm |
Type Aurilhac
Aurilhac (15, 30) Type Orliac Orliac ou Orlhac ? 19, 24, Orleat 63, Orleac patr 31, 66..., Orliac patr 46, 82) |
Orly (77, 94) (voir Aurēlĭānīs > Orléans) |
||
| Marillĭācŭm |
Marilhac (16) (aussi Marliac 31, patr 19) (fr-pr Marlieux 01) |
Marly (02, 57,
71, 71, Port- 78, 95) (Merléac 22) |
||
| m-n |
||||
| r-n |
||||
| Garinĭācŭm | Garinhac (Garignac patr 31) |
Jarny (54) | ||
| Marinĭācŭm |
Type
Marinhac (17, 26, 31 : x3, 82) Type Marnhac ? Marnhac ? (Margnac 46, 87) (2) |
type Margny (à continuer DENLF:437) type Marigny |
||
| Matrinĭācŭm | Type
Mairinhac (Mairinhac 46, Merinhac ou Mairinhac 16, 17, 33) |
type Margny (à continuer) type Marigny |
||
Tableau ci-dessus. Évolution de -r (voyelle) lĭācŭm. Parfois la syncope ne se réalise pas en domaine d'oc (Aurilhac, Marilhac).
Références :
Camillĭācŭm : PHF-f3:940, DENLF:168 ;
Aurēlĭācŭm : DENLF:510a etc.
;
Marilĭācŭm : DENLF:436a,b, PHF-f3:940 qui donne Marelliacum ;
Garinĭācŭm : DENLF:366a-b, PHF-f2:487, PHF-f3:940.
(1) Pour le b dans Chambly, Chambley ; voir m'l.
Pour Chambley (54),
PHF-f3:940 donne Camillĭācŭm mais DENLF:135a donne Camulus
"nom d'homme gaulois" + suffixe
(2) Pour Marinĭācŭm > oc Marnhac,
on n'a pas de formes anciennes, donc on peut voir aussi une origine Marnius (mot gaulois) +
- Pour -r(voyelle)nĭācŭm : pour Aurinĭācŭm, on obtient
aussi bien Aurinhac / Origny
(ce dernier fréquent), que Ornhac
/ Orny (références : DENLF:510b).
- Absences de palatalisations :
Aurēlĭācŭm > Orly
Marilĭācŭm > Marly
*Garinĭācŭm > Jarny
*berlĕăm
> bèrlia (mais bèrlha
existe).
P. Fouché estime que l'absence de palatalisation dans Orly, Marly, Jarny est due à "une raison savante" (PHF-f2:487).
On pourrait invoquer des raisons phonétiques
: "r battu" doit limiter la
palatalisation l ou n
Par exemple : cŏchlĕārĕ(m) > culhier "cuillère".
Il est probable que le groupe cly
ait mené à une géminée /
/kl
Tableau ci-dessus : évolution de lĭ, lĕ en hiatus en LPC. En rouge : mots obtenus par la voie savante (?), contenant encore le yod après la consonne.
|
|
|
|
|
latin LPC |
|
occitan |
| nĭ en
|
> | nh
/ |
| nĕ en hiatus | > |
|
|
|
|
|
|
ăgrĭmōnĭă(m) |
> |
agrimònia "aigremoine" |
| |
> |
aiganha "rosée" |
| ărānĕă(m) | > |
aranha "araignée" |
| Arvernĭăm > Alvernĭă(m) |
> |
Alvèrnha, Auvèrnha "Auvergne" |
| Avennĭōnĕm,
Avēnĭōnĕ(m) |
> |
Avinhon "Avignon" |
| călcănĕŭ(m) | > |
AO calcanh "talon" |
| cĭcōnĭă(m) | > |
AO cegọnha,
cigọnha "bascule d'un puits" AO ciconia "cigogne" |
| căstănĕă(m) | > |
castanha "châtaigne" |
| cŏtōnĕŭm (mālum) | > |
AO codonh
"coing" |
| cŭnĕŭ(m) | > |
AO conh
"coin (pour fendre le bois)" |
| lŭscĭnĭŏlăm > |
> |
rossinhòu |
| > |
montanha | |
| *mŭnnĭo- |
> |
AO m |
| tĭnĕă(m) | > |
tinha "teigne..." |
| vīnĕă(m) | > |
vinha "vigne" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de nĭ, nĕ en hiatus. En rouge : mots obtenus par la voie savante, contenant encore le yod après la consonne.
Il faut distinguer :
- l'apparition très hypothétique d'un i
diphtongal devant /
- les problèmes de l'orthographe de type montainha ;
- une fermeture fréquente de la voyelle devant /
- la diphtongaison conditionnée (voir à cette partie : devant /λ/, devant /ñ/).
On parle ici du i diphtongal
de transition (voir i diphtongal de transition).
F. de La Chaussée (IPHAF:74) réfute l'apparition de ce i
diphtongal puisque l et n se palatalisent facilement, sauf
si /ñ/ parvient en fin de mot ou devant consonne (
Devant /
Certains ouvrages supposent une évolution de type pălĕăm > /p a i̯ λ i̯ a/ vers le le IIe siècle après J.C. (PHF-z:100) (également P. Fouché, référence). Tobias Scheer (PH-2020:443) précise :
"Le <i> dans les graphies de l'AF (et jusqu'au FC) a un statut tout à fait différent devant r où
il représente un yod (puis la seconde partie d'une diphtongue) et devant
l (ou <ll>) dont il note simplement la palatalité sans avoir de
réalité phonétique lui-même : <ill> ainsi représente [
Devant /
- Certains ouvrages supposent une évolution de type montānĕăm
> /montai̯ñi̯a/ vers le le IIe
siècle après J.C. (PHF-z:100 ; PHHL:156). Gaston Zink soutient que ce i
diphtongal est celui qu'on trouve encore à l'écrit dans certains mots
français : "l'articulation plus ferme de ñ implosif maintient y : bain,
loin, poing" (PHF-z:100-101, voir aussi p. 217). Au contraire,
F. de La Chaussée (IPHAF:74) donne une apparition plus récente (VIIIe
siècle) pour /i̯/ qui n'apparaîtrait qu'en position finale ou devant
consonne : "bain, loin, poing, plaindre", voir
- Des variantes occitanes du suffixe -anha (-aina, -èina), si elles existent, semblent très marginales, et de plus pourraient être expliquées de diverses manières. Voir doçanha, docèina, où je donne une plus grande vraisemblance d'un emprunt de docèina à l'ancien français.
En a.fr., mais
aussi en AO de façon moins unifiée, le
Voir ci-dessus i diphtongal devant /λ/ et /ñ/ ?
: il n'y a pas de rapport entre les orthographes françaises ou occitanes
-ign-, -ill-... et un supposé
ancien
De plus, on n'écrivait que le latin à l'époque d'un supposé ancien i prononcé. Il est difficile d'imaginer que la mise à l'écrit de la langue française à partir du IXe siècle gardât la mémoire d'un ancien i diphtongal.
Pour les orthographes en a.fr.
du type montaigne, Bretaigne,
restées dans Michel de Montaigne,
seigneur, poignée, oignon..., ign
était un
Pour l'ancien occitan, c'est toujours le même
- type -IN- : -in-, -ni-, -inn- ;
- type -GN- : -gn-, -ngn-, -ign-, -gni-, -ingn-, -ngni-, -igni-, ingni- ;
- type -NH-
: -nh-, -nnh-, -inh-.
Pour l'ancien français, la situation est semblable :
(HSPGF:8) "La graphie des consonnes palatales [ʎ], et [ɲ] et, dans les régions qui la connaissent, du [ʧ] issu de la palatalisation médiévale de [k], a cependant constitué un véritable défi. Le plus souvent, on a utilisé les lettres ‹h›, ‹g›, ‹i› en leur attribuant une valeur auxiliaire de palatalisation: ‹ch, lh, nh›, ‹lg, ng›/‹gl, gn›, ‹in, il›/‹ni, li›, ou encore la géminée ‹ll› pour [ʎ] (et peut-être aussi ‹nn› pour [ɲ]), ainsi que de nombreuses combinaisons de ces trois moyens, p. ex., ‹ilh, ilg, igl, lgl, ill› et ‹inh, ing, ign, ngn, inn› (cf. Dees 1980 : 335). Très vite, certaines combinaisons se sont démarquées [...]".
Cependant, les choses ne sont pas si simples. Examinons les différents problèmes :
En fin de mot, -ng, -ing ont
souvent été employés pour retranscrire l'ancien /ñ/ (PPH,
non paginé). Mais en français,
il ne faut pas oublier que /ñ/
devenu implosif induit un i
diphtontal. Le
- Action fermante de nh
L'action
fermante de nh a pu
s'exercer sur a
Voir PPH
(non paginé sur internet) : "Attention aux graphies de n mouillé : le
Donc tout laisse à penser que l'ancienne variante orthographique aign (a + ign) a
été maintenue opportunément pour exprimer ai
+ gn /èñ/ comme dans "châtaigne", voir le digramme
ai. On retrouve aussi en
anglais : mountain, Britain
(mots d'origine anglo-normande : comment étaient-ils prononcés au départ
? Logiquement ils n'ont jamais comporté de diphtongue /ay/, /èy/). Voir
aussi Espaigne, Charlemaigne,
gaaigne dans les textes
français du XIVe et XVe siècles, rimant avec des
mots en /-èñ
Par contre, en occitan, il
semble que cette fermeture de a
devant nh ne se soit jamais
réalisée. Les noms de lieux occitans retranscrits avec aign
en français correspondent à une prononciation agn
en occitan : Saignon pour Sanhon
(84), Saignes pour Sanhas
(15, 46),
Cassidaigne pour Cassidanha (13 écueil près de
Cassis, [kasidaño/a] enq.p.
et TDF
: Cassidagno). Il faut étendre
l'étude. Cette habitude graphique provenant de l'a.fr. est un problème : elle induit fatalement
une mauvaise prononciation, qui finit par être employée par les locaux
eux-mêmes (Saignon, 84 est
prononcé [séñõ]).
Conclusion : je déduis que concernant la graphie française aign, celle-ci peut selon les mots et selon les régions :
- représenter une "véritable" prononciation /èñ/ issue de l'action fermante de nh sur a (sans doute uniquement en domaine d'oïl) ;
- représenter une prononciation /añ/ (en domaine d'oil ou d'oc) ;
- représenter une prononciation /èñ/ par influence de l'écrit : c'est le cas de Montaigne l'écrivain, seigneur de Montaigne (Montanha en Dordogne), Saignon pour Sanhon (84), etc.
Autres exemples (aign, eign, oign, uign)
Les nombreux
On peut faire des constatations parallèles pour oign. L'influence de l'écrit s'est exercée dans :
- "poigne" (Littré : "po-gn' ;
quelques-uns prononcent poi-gn'") ;
- "poignard" (Littré : "po-gnar ; quelques-uns disent poignar") ;
(voir CNRTL "poignée"
: "Dans la famille de poing (poignant, poignard, empoigner,
etc.) [wa] résulte d'un découpage erroné de
- dans "oignon", certaines personnes prononcent /wañõ/ ;
- Appoigny (
- Pour Joigny (
- Par contre dans "soigner", la prononciation est logiquement /swañé/ car le verbe est dérivé de "soin", mais on a sonhar en occitan (voir n implosif).
Je cite ADoi:69 : "On retrouve la graphie oi
dans le groupe -oign-, encoignure,
empoigne, moignon, oignon, poigne (à comparer avec pognon,
ancienne graphie poignon), où
le groupe oi, en fait, est dû
à la fusion des graphies o et
-ign de la consonne palatale
nasale, l'interprétation de cette graphie ayant entraîné les
prononciations concurrentes [ɔŋ] et [waŋ]." (Mais pour moignon
: voir moing > moignon... ?)
Pour uign
: par exemple, voir ci-dessus Juigné.
Pour eign,
l'ambiguïté de prononciation s'efface puisque e
comme ei se prononcent [é] (ou
[è]) : sĕnĭōrĕm
> "seigneur" où le
En AO,
les manières de retranscrire /
Selon RLCP (263, 270, 271, 288, 290), pour les chansonniers, il y avait surtout ilh, lh, ill, parfois iyl. Il y avait en outre ll, li, lli, yl, yll (voir DOM agulha).
En graphie classique actuelle, même si /
Pour le français actuel (où l'évolution /
Remarque : au niveau de l'évolution de la prononciation, on peut voir une ressemblance entre le type "aiguille" ci-dessous et le type "foyer" (à mieux étudier).
Pour "aiguille", "cuillière", "juillet", il y a eu évolution de /
- "aiguille"
La prononciation actuelle du fr
"aiguille" /ég
- "cuillère"
La prononciation actuelle du fr
"cuillère" /k
- "juillet"
La prononciation actuelle du fr
"juillet" /j
- "bruyère" /brüiyèːr/,
/bruyèːr/
- Autre cas : "Guyot", "Guyon", "Guyenne"
Au contraire, pour les dérivés de Guy /gi/ (<
Bibliographie : GIPPM-1:137-138, IPHAF:110,116, CDVSF:132. Etudier R. Gess (GGHF:456 §461) : le
On observe souvent une fermeture des voyelles devant lh
ou nh. Cela signifie que les
voyelles obtenues sont plus fermées (actions
fermantes) que si elles avaient subi simplement la mutation
vocalique. Soit i
remplace é attendu, soit u remplace ó
attendu.
Exemples :
Avēnĭōnĕm > (attendu)
Măssĭlĭăm > (attendu) Marselha / (dialectal) Marsilha
bŭllīrĕ
> (attendu)
bolhir > (dialectal)
bulhir (voir étymologie
de bolir)
vĭgĭlārĕ
>
Les auteurs estiment parfois que la fermeture
Remarque : Ces voyelles auraient pu disparaître par syncope, en tant que voyelles prétoniques, mais la présence d'une consonne palatale, qui cause l'entrave, empêche cette disparition (source à mettre).
Certains auteurs estiment que devant /
Il faut cependant signaler qu'au nominatif, la voyelle en question était accentuée dans Avēnĭō, pāpĭlĭō, *quădrĭnĭō ; elle n'était pas en position prétonique. Il est difficile d'aller plus loin dans les déductions.
Montānĭācŭ(m) > oc Montinhac / Montanhac (nombreux toponymes) ; fr Montigny / Montagny (nombreux toponymes).
Sur Montagny / Montigny, voici ce qu'explique Gérard Taverdet (DSPO:5) :
"Dauzat et surtout Rostaing (qui, pris par
le temps, ne pouvait utiliser les cartes) ont considéré que ces formes
appartenaient à deux étymons différents : Montagny
était le représentant d’un nom d’homme latin Montanius,
alors que Montigny était le
représentant d’un autre étymon (
Note : Comme plus récemment Marie-Thérèse MORLET (1985).
En Bourgogne, nous avons rencontré de nombreux sites appartenant aux deux séries, tout simplement en bourlinguant à travers les campagnes profondes à la recherche d’éventuels témoins. Et nous avons rencontré un fait incontestable : les Montagny sont au sud, bien groupés en Saône-et-Loire, au sud de ce que les géographes appellent la dépression « Dheune-Bourbince », et, au nord, en Côte-d’Or, nous avons des Montigny.
Note : Il existe cependant en
Côte-d’Or des formes en
Nous ne parlerons pas ici de l’étymologie des Montagny-Montigny, noms d’hommes ou souvenir d’une montagne qui n’était le plus souvent qu’une modeste motte et peut-être aussi tout simplement une zone boisée.
Quoi qu’il en soit, la question de la base des Montagny-Montigny semble aujourd’hui bien tranchée en faveur de l’étymon unique ; mais rien ne nous empêche de nous arrêter en si bon chemin. Si l’on continue à porter sur la carte les noms qui ont les mêmes finales, on retrouve la même répartition. Est-il encore bien utile aujourd’hui de distinguer les Chevagny et les Chevigny, les Germagny et les Germigny ? Et les Champagny (nom d’homme Campanius, selon Dauzat) et les Champigny (que Dauzat avait bien rattachés à la même série) ? [voir ci-dessous "champignon"].
(Note : Cette différence d’analyse entre Champigny et Montigny montre bien que le DENLF a été rédigé par deux auteurs et que Rostaing n’a pas eu le temps d’analyser les étymologies que Dauzat avait développées jusqu’à la lettre L.)
Et il existe probablement encore d’autres couples, certes moins nombreux que l’exemple de base Montagny".
Gérard Taverdet ne propose pas d'explication phonétique à la forme en
apparence
Sanctŭm
Anĭānŭm > Sanch Anhan > Sant
Chinhan "Saint-Chignan" (
En français : *campaniolum
> a.fr. champignuel
> (
*Campaniacum > Champagny, Champagney, Champagneux (73) / Champigny, Champigné. En domaine d'oc : seulement Campanhac.
Au nord de la ligne Joret : Campigneulles, Campigny / Campagnolles.
?*Genilĭācŭ(m) > Junilhac (année 1169) / Genolhac (nom actuel) (30) : attraction par genolh "genou" ?
? Cavanniacum > Cavanhac / Cavinhac, Chevagny / Chevigny...
? Germaniacum > Germagny (71) / Germigny (8 communes).
? Romaniacum > Romanhat
(63) / Remigny (
Dragonianum
> Draguinhan "Draguignan" (
Phonétiquement, ce type d'évolution montre une fermeture de a
jusqu'à i, sans aucun doute
favorisée par -nh-
L'évolution Căbellĭōnĕm > Cavalhon "Cavaillon" n'est pas certaine, car dès l'Antiquité, les deux variantes Căballĭō et Căbellĭō existent. Donc si cette évolution a eu lieu, elle s'est réalisée dès l'Antiquité : Căbellĭō > Căballĭō. Pour le même type d'évolution vocalique, on peut citer pāpĭlĭōnĕm > parpalhon "papillon", AO pabalhọṉ "pavillon, tente".
Voici les sources pour les deux formes antiques de "Cavaillon" :
(pour les sources antiques, voir notamment wikisource-Cabellio) :
- (Strabon, Géographie, IV) Καβαλλίων (Kaballíōn) (Καβαλλίωνος, Καβαλλίωνα : Géographie, IV, 1, 3 et IV, 1, 11) ;
- (Pline l'Ancien, Naturalis Historia, III, 36) Cabellio ; (CIL, XII, p. 136) Cabellio, -onis , (Ptolémée (l., II, c. 10, § 8) (in ROPFNL:519, repris dans ETC:88) : "L'orthographe de ce nom, telle que nous la donnons ici, est attestée par plusieurs inscriptions romaines, comme l'a établi M. Hirschfeld (CIL, XII, p. 136) ; c'est l'orthographe de Pline (l., II, § 36) et de Ptolémée (l., II, c. 10, § 8, édit. Müller, t. I, p. 244, l. 2.)." (Ptol. II 10, 8 (Καβελλιὼν κολωνία).
Pour Henri d'Arbois de Jubainville (ROPFNL:519), la forme originelle est Cabellio, du gentilice Cabellio. "L'orthographe Caballio dans les manuscrits de Strabon est le résultat d'une assimilation de la première syllabe à la seconde ; cette assilimation se faisait déjà dialectalement dans les premiers temps de l'empire romain, comme l'atteste une inscription du musée de Mayence (Brambach, 1203)". Voir RISMSM:58, pierre tombale d'un soldat romain de Mayence : (développement des abréviations latines) Gaius Satrius, Gai filius, Voltinia (tribu), Cabalione, (...) "Gaius Satrius, des Gaius Sohn, aus der Voltinischen Tribus (Bürgerklasse) von Cabalio (Cavaillon in Frankreich) (...)".
Cependant, l'hypothèse d'une forme fondée sur un gentilice n'est pas du
tout assurée, selon DENLF:157 à l'article Cavaillon : (e.d.a.)
"peut-être d'un nom d'homme latin ou gaulois (Cabelius, Cabilus,
Caballio) ou mot
En admettant que Căbellĭō soit la forme originelle, on
peut constater que l'aboutissement actuel Cavalhon (avec
un schéma vocalique déjà réalisé à l'Antiquité : Căballĭō) va à
l'encontre de l'évolution Avēnĭōnĕm > Avinhon
ci-dessus. Donc paradoxalement on peut aussi avoir une ouverture de la
voyelle : Căbellĭōnĕm
> Cavalhon
"Cavaillon" (
Par ailleurs, fr "papillon", "pavillon" (< pāpĭlĭōnĕm) suivent le type Avinhon ci-dessus (Cavilhon reste à confirmer par d'autres occurrences).
Il faut noter les variantes Cavillo (année 587 in HRA:56, année 1008, in TGF1:646, Cavillo Cavarum in HGFLXIII:25), AO Cavilhon (année 1364, terrier du prévôt de la Cathédrale à Avignon in GTEUMA) : ce pourraient être des survivances de la variante non dissimilée Căbellĭō ayant suivi le type Avinhon ci-dessus, à moins qu'il ne s'agisse de confusions anciennes avec Chalon-sur-Saône (Cabillonum).
L'évolution nh > lh est
notée dans plusieurs mots longs, en position précédant la voyelle
tonique. Il s'agit peut-être d'une dissimilation
*Rŭscĭnĭōnĕm >
Rossilhon : Pour
*quădrĭnĭōnĕm > fr "carrillon". Pour *quădrĭnĭōnĕm "ensemble de quatre cloches" (FEW 2:1439b), comparer carrilhon, "carrillon" avec caireforc, "carrefour" (< quădrĭfŭrcŭm) où dans ce dernier cas, on n'a pas fermeture de é en i.
Avēnĭōnĕm > Avilhon, variante de Avinhon (84) ; Avilhon est attesté de nombreuses fois dans le terrier de Sainte-Catherine, deuxième moitié du XIVe siècle (GTEUMA).
*Rominiacum
ou *Romaniacum
> Remilly (
À l'étude des formes ci-dessous, je suis tenté de dire que dans les
- de l'effet fermant de lh, nh sur la voyelle antécédente ;
- de l'apophonie (néo-apophonie) ;
- des dissimilations vocaliques ;
- de la dilation
de la première syllabe en a
sur la deuxième.
|
latin LPC |
|
occitan
|
|
français
|
|
forme attendue en occitan
|
| l (ĭ, ĕ) en
|
-ilh- parfois -alh- |
-ill- |
||||
| Aurēlĭācŭ(m) | Aurilhac (15, 30) | (Aurillac 15, Aureillac 30) | ||||
| Căbellĭōnĕ(m) | Cavalhon (84), AO Cavilhon (1) | (Cavaillon
84) |
||||
| pāpĭlĭōnĕ(m) |
(AO)
papilh pabalhọn... "pavillon, tente" |
papillon
; pavillon |
||||
| -ulh- |
-olh- |
|||||
| x
manolh > carp manulhera |
("rangée
de
vigne") |
manolhera |
||||
| n (ĭ, ĕ) en
|
-inh- |
-ign- |
||||
| Avēnĭōnĕ(m) | Avinhon (84), AO Avilhon (2) | (Avignon
84) |
||||
| *lŭscĭnĭŏlŭ(m) |
rossinhòu |
rossignol |
||||
| nh > lh |
||||||
| n (ĭ, ĕ) en
|
-ilh- |
-ill- |
||||
| (carrilhon, |
a.fr. quaregnon,
carignon, carrillon |
|||||
| Rossilhon ( |
(Roussillon) |
|||||
Tableau ci-dessus. Évolution de la voyelle en prétonique interne dans des substantifs devant lh, nh (ou parfois ouverture : Cavalhon, parpalhon).
(1) Cavilhon pour Cavalhon : voir références ci-dessus.
(2) La forme Avilhon pour Avinhon est attestée de nombreuses fois dans le terrier de Sainte-Catherine, deuxième moitié du XIVe siècle, (GTEUMA).
En tonique, certains mots montrent une fermeture de /é/ ou /a/ tonique
devant lh ou nh.
(Je pourrais mettre ce paragraphe à l'étymologie de
Concernant le vocalisme, parmi les aboutissements dans les langues
romanes, oc cavilha
est conforme à fr
"cheville", it
caviglia, esp clavija. D'autre part, oc aurelha
est conforme à fr
"oreille", it orecchio, esp oreja.
Pourtant les deux étymons latins sont en
Le i du diminutif latin
Certains mots latins en
Par contre, le suffixe occitan -ilha est uniforme (dans eusilha, granilha, ravanilha...) ;
il ne semble pas exister sous la forme -elha.
De même le suffixe français
Pour expliquer
Pour clāvĭcŭlă (DFL) > oc cavilha, fr cheville..., FEW 2:759b donne clāvīcŭlă avec i long sans commentaire.
Pour lentĭcŭlăm (DFL) > "lentille", FEW 5:252a donne (trad.all.) : "Les formes romanes supposent
généralement
Pour ănătĭcŭlăm (DFL) : > AO anadilha, OM anedilha, andilha..., "pièce de fer fixée au centre d'une meule de moulin" ; > a.fr. et dial.oïl type aneille : la chute de t en français ne permet pas de conclure quant à la durée de i latin.
Pour cănīcŭlăm (DFL) > oc canilha, fr chenille, FEW 2:188 donne aussi un i long ; les descendants sont en cohérence avec cette quantité.
(à continuer).
(Allongement de la voyelle latine devant gn ?)
|
latin LPC |
|
occitan
|
|
français
|
|
forme attendue en occitan
|
| l (ĭ, ĕ) en
-c |
-ilh- |
-ill- |
||||
| clāvĭcŭlăm
> *cāvĭc'lăm |
cavilha |
cheville |
||||
| cĭlĭŭm |
(AO)
c |
cil,
sourcil |
celh, celha |
|||
| fămĭlĭăm |
familha (1) | famille |
||||
| Măssĭlĭăm |
Marselha, Marsilha | Marseille |
Marselha |
|||
| mĭlĭŭm |
(AO)
m |
mil |
melh |
|||
| strĭgĭlĕm
> *strĭg'lăm |
(AO)
estr |
étrille |
estrelha |
|||
| n (ĭ, ĕ) en
|
-inh- |
-ign- |
||||
| *lĭgnă(m) |
linha, lenha (2) |
lenha |
||||
| tĭnĕă(m) |
tinha, AO tenha | teigne |
tenha |
|||
| sĭgnŭ(m) |
voir
ci-dessus les dérivés de sĭgnŭm |
|||||
Tableau ci-dessus. Fermeture de la
voyelle /é/ en /i/ devant /
(1)Pour fămĭlĭăm, l'aboutissement oc familha est considéré comme mi-savant par J. Ronjat (GIPPM-1:), fr "famille" comme un emprunt (CNRTL).
(2) Pour *lĭgnăm : ne pas confondre avec līnĕăm > linha "ligne".
Dans plusieurs verbes ou dans plusieurs familles de mots, il y a
alternance de formes
(GIPPM-1:138) "[...] un seul et même parler a
assez souvent
Pour sĭgnŭm "signe", il faut distinguer la voie savante > signe "signe", et la voie populaire > senh (fr "seing") ; les deux voies sont bien séparées : en AO les sémantismes et les orthographes sont bien distincts. Par contre pour senhar, signar, il est difficile de faire la part de (1) la voie savante et (2) de la voie populaire avec fermeture é > i devant nh. De même pour entresigne / entresenha, entresignar / entresenhar. Les sémantismes sont les mêmes pour les variantes avec i et les variantes avec e, et les orthographes sont très variables en AO (signar, sinhar, seignar, segnar, senhar, senar, cenar...).
|
latin LPC |
|
occitan
|
|
formes attendues en occitan |
| bŭllīrĕ | bulhir, bulh (1) "bouillir, ébullition" |
bolhir, bolh (1) |
||
| grilhet, (dial.p.) grilhar,
regrilhar, regrilha... "grillon, germer, regermer, (il) regerme"... |
grelhet, grelhar, regrelhar,
regrelha... |
|||
| mŏllĭārĕ | mulhar ; (AO) muelhar,
muilar "mouiller" |
molhar |
||
| tĭlĭă(m) |
(AO)
t "tilleul, filandreux"... |
telha, telhós... |
||
| *scărăbaecŭlārĕ | escarrabilhar |
|||
| *sĭgnŭm | voir ci-dessus les
dérivés de sĭgnŭm |
|||
| tĭngĕrĕ | ténher / tínher |
ténher |
||
| vĭgĭlāre
> *vĭg |
(dial.p.) vilhar, revilhar, vilha... "veiller, réveiller, veille"... |
velhar, revelhar, velha... |
||
Tableau ci-dessus. Fermeture de la
voyelle /é/ en /i/ devant /
(1) Pour bolhir, bulhir, le lh provient d'une contamination par
des formes conjuguées latines (bullĭēbam...),
voir bolir.
Les linguistes ont développé la notion de "yod tardif" pour certains mots comme līnĕŭ(m) > linge "linge". Je propose une révision de cette notion ci-dessus à type līnĕŭm > linge.
De nombreux mots latins contiennent kĭ,
kĕ en
/k/
+
ĭ, ĕ en
Au cours du Ier siècle après J.-C., on obtient /k
Très rapidement (IIe siècle), il y a assibilation
avec
Pour /
L'évolution ultérieure montrera : à partir
de la fin du VIe siècle, une dépalatalisation
; vers l'an 1200, une "désaffrication"
(perte de la composante
En bilan, on aura (1) pour kĭ, kĕ en
cĭ,
cĕ /ké, ki/ > (Ier siècle)
/k
c. Évolutions dialectales particulières
(à faire).
Pour le moment, je n'ai trouvé que bĭsaccĭŭm > *bĭsaccĭăm > AO beasa, biasa > biaça "besace".
On a donc le même résultat que pour c simple.
La gémination de c
devant yod est proposée par X. Gouvert (in DÉROM2-PLRT:42, lui-même reprenant Lausberg). Il
ne développe pas cet aspect, explique simplement que fr bras, esp
brazo, port braço
proviennent de [brak-kyʋ]
et
rattache simplement ce phénomène au renforcement
consonantique
devant yod.
Cette hypothèse interfère avec la résistance
à la sonorisation de k +
ĭ, ĕ décrite ci-dessus.
Aujourd'hui, que ce soit pour le latin c + ĭ, ĕ en hiatus ou pour consonne + t + ĭ, ĕ en hiatus , l'aboutissement actuel /s/ se transcrit par c cédille (ç) en graphie "classique", même en fin de mot (braç) (PCLO: 41). La cédille représente l'ancien son /ts/. En graphie mistralienne, la cédille est employée
Voir la partie détaillée à part : Origine de la cédille.
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
AO > OA
|
|
cĭ
en hiatus
|
> |
/ts/ > ç
/s/ |
| cĕ en hiatus | > |
|
|
|
|
|
| -ācĕŭm, -ācĕăm | > |
-às, -assa (1) |
| Albūcĭōnĕm | > |
Aubuçon "Aubusson" (23) |
| bĭsaccĭŭm > *bĭsaccĭăm | > |
AO beasa, biasa > biaça "besace" |
| brāchĭŭm /braː-ki-ʋm/ | > |
braç "bras" |
| călcĕăm /kal-ké-am/ |
> |
>
cauça "chausse" |
| călcĕārĕ /kal-ké-aː-ré/ |
> |
cauçar "chausser" |
| Calvīcĭōnĕ(m) |
> |
Cauviçon "Calvisson" (30) |
| dŭlcĭăm /dʋl-ké-am/ |
> |
douça "douce" |
| erīcĭŭm /é-riː-ki-ʋm/ | > |
/érits/ (> eiriçon
"hérisson") |
| făcĭō /fa-ki-oː/ |
> |
AO
/fats/ ("je fais") |
| făcĭăm /fa-ki-am/
(2) |
> |
faça "face") (2) fàcia "face" |
| făcĭĕm /fa-ki-ém/ |
> |
/fats/
fatz AO "face" |
| Frăncĭăm /fran-ki-am/
(3) |
> |
França
"France" |
| glăcĭĕm /gla-ki-ém/ |
> |
/glats/
(>
glaç "glace") |
| Graecĭăm /graé̯-ki-am/ |
> |
Grèça
"Grèce" |
| lăncĕăm /lan-ké-am/ |
> |
lança "lance" |
| mĭnācĭăm /mi-naː-ki-am/ |
menaça "menace" |
|
| picĕăm |
> |
(fr-pr)
pèço |
| *pīncĭōnĕ(m) |
> |
pinçon, quinçon "pinson" |
| *Retĭcĭānŭ(m) |
> |
Redeçan "Redessan" (30) |
| *Scocĭă(s) ( |
Écuisses (71) (4) | |
| senecĭōnĕ(m) |
> |
seneçon (ou voie
savante ?) |
| *trŭncĕŭm
/trʋn-ké-ʋm/ |
> |
*tronç + -on (> AO tronçon
"tronçon") |
| ŭncĭăm
/ʋn-ki-am/ |
> |
onça
"once" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de cĭ, cĕ en hiatus (après voyelle ou après consonne autre que s). Les deux premières colonnes présentent les coupures syllabiques par des traits d'union. L'accent est marqué par le soulignage de la voyelle. En rouge : mots obtenus par la voie savante, contenant encore le i après la consonne.
(1) -aç, -aça serait
l'orthographe logique, mais -às,
-assa semble consacré par l'usage.
(2) Pour făcĭăm, la variante
(3) Frăncĭă est attesté dès Ausone, au IVe siècle après J.-C.
(4) Pour *Scocĭăs >
Écuisses, je ne m'explique pas la diphtongaison ui
; le latin *Scocĭăs aurait mené
en français à
Schéma général :
/sk/ + ĭ,
ĕ en
gascon : /sk/
+ ĭ, ĕ en
Le cas est similaire à celui de sce, sci (deuxièmes palatalisations).
Détails :
Pour le cas de sc + ĭ, ĕ en hiatus (pĭscĭōnĕm
> peisson "poisson"), la palatalisation a dû commencer comme
le cas général ci-dessus (consonne + c
+ ĭ, ĕ en hiatus), mais à l'obtention de l'
Le cas rejoint donc l'évolution de stĭ,
stĕ et l'évolution de ssĭ, ssĕ ci-dessous.
scĭ,
scĕ /ski, ské/ > (Ier siècle) /sk
Tableau d'exemples :
|
|
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
latin LPC (Ier après J.-C.) |
|
AO > OA
|
| scĭ, scĕ en hiatus | > |
/sky/ > /sk |
> |
iss /i̯s/ |
|
|
|
|
|
|
| ăscĭăm /fas-ki-am/ | > |
/as-kça/ | > |
/ai̯sa/
(>
aissa, aisseta
"herminette"...) |
| ăscĭătăm /fas-ki-am/ | > |
/as-kçata/ | > |
/ai̯sada/ (> aissada
"houe") |
| făscĭăm /fas-ki-am/ | > |
/fas-kça/ | > |
/fai̯sa/ (> faissa,
a.fr. "faisse") |
| pĭscĭōnĕm /pis-ki-oː-ném/ |
> |
/pis-kço-né/ |
> |
/péysóne/ (> peisson
"poisson") |
| > |
/ex-pós-kça:-ré/ |
> |
/espoysar/
(> espoissar
"éclabousser") (1) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de sc + ĭ, ĕ en hiatus. Les deux premières colonnes présentent les coupures syllabiques par des traits d'union. L'accent est marqué par le soulignage de la voyelle.
D'après ce qui précède, normalement rk
+ ĭ, ĕ en
C'est effectivement rç qu'on
obtient dans *arcĭōnĕm > arçon
"arçon" ; peut-être AO arzon
avait la même prononciation (
Mais dans ŭrcĕŏlŭm a donné AO
orj
Plusieurs mots latins contiennent rĭ,
rĕ en
Schéma général :
| r
+ ĭ, ĕ en |
> ir /i̯r/ |
| > -r en finale après les apocopes (-ador, cuer) | |
| > /rdj/ rarement (serọrge ci-dessous) | |
Au cours du Ier siècle après J.-C., on obtient /r
Selon IPHAF:63 : "le r
apical, en raison des battements de la pointe contre les alvéoles, ne
peut pas subir, sans faire disparaître ces battements, une élévation
considérable du dos de la langue : le r
ne se palatalise donc jamais complètement, du moins en domaine
français." On obtiendra donc un r
demi-palatal :
Le r palatalisé provoque
aussi une diphtongaison
conditionnée
(par r) de ĕ
et ŏ
Pour le fr. "huître", dans ŏstrĕăm > huistre, je pense qu'on a affaire à un cas remarquable de palalisation régressive, avec contamination de la palatalisation sur deux voyelles antécédentes s et t (cas irrésolu dans IPHAF:39). En occitan, le traitement est considéré comme savant : ústria.
Ce type d'évolution appartient à consonne + ĭ, ĕ en hiatus > consonne + /dj/ ci-dessus.
*bŭrrĭōnĕ(m) > "bourgeon"
cērĕŭ(m) > "cierge"
Fĕrrĕŏlŭ(m) > Saint-Fergeux (08), Saint-Ferjeux (70), Saint-Fargeau (77 : de S. Fergiolo, année 1184, 89), Saint-Forgeux (69), peut-être Saint-Fréjoux (19), (S. Freioll, année 1100) (DENLF:598)
fĕrrĕŭ(m) > a.fr. ferge, fierge "chaîne, lien fermant à clef"
*pŏrrĭōnĕ(m) > a.fr. et dial.oïl porjon, pourjon "poireau..."
sŏrōrĭŭ(m)
> a.fr. et dial.oïl serorge,
AO
ser
Prononciation avec yod épenthique ?
Une prononciation avec yod épenthique (cērĕŭm
*/kéːréyyʋ/ ) permettrait de résoudre le problème cērĕŭ(m)
a.fr. cirge
"cierge" soulevé par (IPHAF:86) : cirge
provient normalement de *cieirge
(voir iei
> i) ; cela pose un problème car *cieirge
requiert la diphtongaison française de /é/. Celle-ci ne peut pas se
réaliser si /é/ est
| français
: |
|
| cērĕŭ(m) */kéːréyyʋ/ | |
| > */ |
|
| > */ > (action fermante de la palatale sur é subséquent) */ |
|
| Voie
1 : syncope précoce |
|
| > (vers le VIIe s. : syncope, dépalatalisation, etc.) /tsi̯ érdjó/ | → fr "cierge" (hypothèse 1) |
| Voie
2 : syncope tardive |
|
| > (VIe s.
: diphtongaison
française) */ (ici, i̯r est donc obtenu d'une façon très différente de la palatalisation du r ci-dessus) |
|
| > (iéi > i)
*/ |
|
| > (vers le VIIe s. : syncope, dépalatalisation) /tsiːrdjó/ | |
| > (ó final > |
|
| > (XIIe s. : désaffrication)
/siːrj |
→ a.fr. cirge "cierge" |
| > (date ? effet
ouvrant de r ?) /si
è̯ rj |
|
| > (bascule
des diphtongues) /si̯ è
rj |
→ fr "cierge" (hypothèse 2) |
Au moment des apocopes, */-i̯ró/ > */-i̯r/ s'est simplifié en /-r/. Le i diphtongal a disparu ; peu d'attestations montrent son maintien en AO (variante mestieir pour mestier).
En effet -ātōrĭŭ > -ador, mais -ātōrĭă > -adoira (le i diphtongal est conservé si l'apocope ne peut pas se réaliser à cause du -a résistant).
Également :
Le cas se rapproche de la simplication ieir > ier.
Par contre en français, -ātōrĭŭ
> a.fr. -eoir
: le i diphtongal est bien
conservé. Je pense que son évolution rejoint celle de ē
(tēlăm
> toile) au stade /ói̯/
(*/tói̯l
À faire.
Voir notamment IPHAF:122-123, Fouché, AVO:5-9.
(AVO:8)
"j'admettrai donc une évolution uniforme de
|
latin LPC
|
|
occitan
|
| rĭ, rĕ en hiatus | > |
/i̯r/, -r en finale après les apocopes (-ador, cuer) |
| -ārĭŭ(m) | > |
-ier "-ier" |
| -ātōrĭă(m) | > |
-adoira, a.fr. -eoire,
"-oire" |
| -ātōrĭŭ(m) | > |
-ador a.fr. -eoir,
"-oir" |
| ārĕă(m) (1) | > |
ièra "aire" (1) |
| (ăriĕtĕm) | > |
(cas
particulier
: ărjĕtĕm
"bélier" ci-dessus) |
| > |
glaira (et clara
?) "glaire ; blanc d'œuf) |
|
| cŏrĭŭ(m) |
> |
cuèr "cuir" |
| Cŏrĭŭs |
> |
Cuèrs "Cuers" (83) |
| > |
esclairar "éclairer" |
|
| extĕrĭŭs |
> |
AO
estiers "autrement" |
| fērĭă(m)
(1) |
> |
AO
fieyra, f |
| fōrĭă(m) (2) | foira "foire, diarrhée" | |
| glārĕă(m) |
> |
glaira "gravier" |
| mĭnĭstĕrĭŭ(m)
> *mĭstĕrĭŭ(m) |
> |
mestier "métier" |
| mŏnastērĭŭ(m) |
> |
monastier, mostier
"monastère" |
| (păriĕtĕm) | > |
(cas
particulier
: părjĕtĕm
"mur" ci-dessus) |
| > |
AO qu |
|
| Quarĭātĕs |
> |
Cairàs "Queyras" (05) |
| > |
tieira > tiera "tire" | |
| vărĭārĕ |
> |
vairar "changer de couleur" |
| vărĭātŭ(m) |
> |
vairat "maquereau" |
| vărĭŭ(m) | > |
AO vair, vaire, var, vari "vair" |
| vărĭōlă(m) | > |
vairòla "vérole ; variole" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de rĭ, rĕ
en hiatus en LPC et
aboutissements en occitan. Pour le français, on peut citer
aussi : părĭăm > paire, *clārĭŭm (?) > clair ; pour le
portugais : cŏrĭŭm >
(portugais) coiro (FLTS:184).
(1) Pour ārĕăm, fērĭăm, la diphtongaison est difficile à expliquer, voir "diphtongaison devant r palatalisé". Pour ārĕăm, l'évolution semble la même que pour le délicat suffixe -ārĭŭm, -ārĭăm.
(2) Pour fōrĭăm, il semble
que le o latin soit long (et non
fŏrĭăm)
conformément aux formes des langues romanes actuelles (FEW 3:713a,b). En effet, un o
bref aurait conduit à oc
Selon
Certains mots latins contiennent sĭ,
sĕ en
Pour schématiser :
s + ĭ, ĕ en hiatus > is /i̯z/
ss + ĭ, ĕ en hiatus > iss /i̯s/
Au cours du Ier siècle après J.-C., on obtient /s
Il faut noter que dans les cas ci-dessous, le ̯
s
+ ĭ, ĕ en hiatus
> is /i̯z/
Pour les mots comme bāsĭārĕ
"baiser", ecclēsĭăm "église",
la demi-palatalisation de s se réalise ainsi : /sy/ > /i̯
Puis vers l'an 400, la demi-palatale
Donc : /
|
latin LPC |
|
occitan
|
| voyelle + sĭ, sĕ en hiatus | > |
is
/i̯z/ |
| Alĕsĭă(m) |
n.d.l. Alise (?) |
|
| artĕmīsĭă(m) / artĕmēsĭă(m) | > |
artemisa, lim armisa, dial.oïl armise / (*armeise >) armoise (FEW 25:360-365) |
| bāsĭārĕ | > |
baisar "baiser" |
| > |
cerièisa "cerise" (1) (2) |
|
| > |
clauz |
|
| ecclēsĭă(m) > eclĕsĭă(m) | > |
glièisa, glèisa "église" (2) |
| făsĕŏlu(m) | > |
faizǫl (AO), faiòu, faviòu, fajòu (Var), fasiòr, fasuel "haricot" |
| fūsĭōnĕ(m)
> *fŭsĭōnĕ(m) |
> |
foison "foison" |
| ma(n)sĭōnĕ(m) |
> |
maison "maison" |
| > |
AO naizar >
naisar ("rouir le chanvre") |
|
| nausĕă(m) |
> |
AO
n |
| occāsĭōnĕ(m) |
> |
AO
ocaiz |
| AO
ocaziọ |
||
| pĕrtūsŭs > *pĕrtūsĭārĕ | > |
a.fr.
pertuisier "percer" (3) |
| *pĕrtūsĭŭ(m) | > |
AO
pertuis "trou" (3) |
| phāsĭānŭ(m) | > |
AO
faizan, fazan, faian
"faisan" |
| prĕhĕnsĭōnĕm
> prēsĭōnĕ(m) |
> |
preison "prison" |
| > |
AO
putnais, punnais "punais,
puant" (voir "punaise") |
|
| tonsĭōnĕ(m) > *tōsĭōnĕ(m) |
> |
AO
toiz |
| Vasĭōnĕ(m) |
> |
Vaison "Vaison" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de sĭ, sĕ en hiatus. En rouge : mots obtenus par la voie savante, contenant encore i après s.
(1) Pour
(2) *cĕrĕsĭăm, eclĕsĭăm subissent une diphtongaison conditionnée devant s palatalisé (en occitan comme en français).
(3) Pour *pĕrtūsĭārĕ (voir FEW 8:290b), on n'a que le représentant AO pertuzar ; il semble donc que l'étymon
soit *pĕrtūsārĕ, mais on a les deux formes AO pertús < pĕrtūsŭm / pertuis <
*pĕrtūsĭŭm. Pour pertuisier / percer, voir les interactions
entre formes rhizotoniques et téléotoniques.
Voir aussi étude de -aus-.
Schéma général :
aus + ĭ, ĕ en hiatus > aus /aʋ̯z/
(parfois ois /ʋi̯z/, òis /òi̯z/)
|
latin LPC |
|
occitan
|
| au + sĭ, sĕ en hiatus | > |
aus
/aʋ̯z/ |
| > |
clauz |
|
| nausĕă(m) |
> |
AO nauza,
n |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de au + sĭ,
sĕ
en hiatus.
Pour l'occitan :
Comme pour le schéma général
ci-dessus,
Pour le français :
En français, les descendants ont toujours oi ("cloison", "noise", voir aussi "oiseau"), voir digramme oi.
Yves-Charles Morin donne : "La diphtongue proto-française [au̯], [est devenue] [ɔi̯] devant consonne palatalisée, comme dans noise < NAUSĔĂM." (HSPGF:6).
Si [au̯] s'est d'abord monophtonguée
en [ó], on doit se poser la question de la date de cette
monophtongaison. Les linguistes estiment que pour le français, il y a eu
: 1. palatalisation, 2. monophtongaison.
Cela implique l'évolution aui >
oi : (PHF-f2:285) nausea
> *náoi̯sya > *nǫi̯s(y)a > "noise".
F. de La Chaussée date la monophtongaison au > ó de la fin du Ve siècle (IPHAF:117,189). Si le i diphtongal est apparu vers le IIesiècle (voir les différents schémas détaillés ci-dessus), cela suppose un maintien de cette triphtongue pendant plusieurs siècles. Cela semble difficile à envisager, surtout au regard de l'occitan où il est quasi-certain qu'un i diphtongal soit apparu au contact de la diphtongue au, avec l'évolution fréquente : aui > au. Donc je pense que dans les cas "au + sĭ, sĕ + voyelle" et "-auce-", il a pu y avoir monophtongaison précoce en français, avant ou en même temps que les palatalisations (IIe siècle).
Schéma général :
ss + ĭ, ĕ en hiatus > iss /i̯s/
Détails :
Pour le cas de ssĭ, ssĕ (*bassĭārĕ "baisser", messĭōnĕm
"moisson"), le deuxième s
palatalise le premier (voir par exemple PHF-p:195). C'est une palatalisation
régressive.
Mais comme le s est double, on ne peut pas avoir sonorisation vers l'an 400, et on aboutit à /s/.
Il faut remarquer qu'on obtient le même résultat que pour sc + ĭ, ĕ et st + ĭ, ĕ (ci-dessus).
Exemples :
|
latin LPC |
|
occitan
|
| voyelle + ssĭ, ssĕ en hiatus | > |
iss /i̯s/ |
| > |
baissar "baisser" |
|
|
|
> |
graissa "graisse" |
| messĭōnĕ(m) | > |
meisson "moisson" |
| > |
pissar "pisser" |
|
| > |
AO
pues... (1) > d, a
poei, pois "(je) puis,
peux" |
|
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de ssĭ, ssĕ en hiatus.
Ci-dessous je distingue deux grandes situations :
À l'initiale, il doit être
possible de trouver des mots romans actuels montrant une palatalisation
de t à l'initiale (à
rechercher). Tĭāră "tiare", thĕātrŭm "théâtre" ne semblent
avoir que des issues savantes, cependant voir l'inscription ci-dessous ampitζatru
pour amphĭthĕātrŭm).
De nombreux mots latins contiennent voyelle + tĭ,
tĕ en
Schéma général :
voyelle +
t + ĭ, ĕ en
voyelle +
t + ĭ, ĕ en
Détails :
Au cours du Ier siècle après J.-C., on obtient /t
Très rapidement (IIe siècle), il y a assibilation
avec
Dans le
[...] Vincentζus Tζariζo in ampitζatru Cartang[in]is in ζie Merccuri in duobus cinque in tribus nove [Vi]ncentζo Tζaritζoni quen peperit Concordia ut urssos ligare non possit in omni ora in omnni momento in ζie Merccuri [...] (Audollent 253 in PRHMAC:136-137)
(trad. PRHMAC:136) "Vincentius Tzarizo, dans l'amphithéâtre de Carthage, le jour de Mercure, dans deux cinq, dans trois neuf. [Envoûtez] Vincentius Tzaritzo que Concordia a mis au monde, pour qu'il ne puisse enchaîner les ours à aucune heure, à aucun moment, le jour de Mercure [...]"
Commentaires sur ce dernier extrait :
- On voit que Vincentius
et amphitheatrum sont écrits
avec ζ à la place du yod
(pour le p de ampitζatru, voir φ > p) : ty
a abouti à une
- Le nom Tzaritzo, Tzaritzonis est sans doute d'origine carthaginoise (thèse Venationes africanae:174).
- in ζie pour in diem "le jour" montre sans doute aussi la palatalisation de d + ĭ, ĕ en hiatus.
- Dans Vincentius,
apparemment c dans
Crescentsianus pour Crescentianus (CIL XIV, 246) de l'année 140 après J.-C.
__________________
Dans Prob,46 "Theophilus non Izophilus" a donné lieu à plusieurs hypothèses, notamment axées sur une palatalisation ty > tz.
En effet, peut-être faut-il comprendre : "Theophilus non Tzophilus" comme l'ont dit certains auteurs (voir discussion à Prob,46).
__________________
(Pomp.Gr., GL5 286, j.m.c.g., v.c.d.e.<s>) Iotacismi
sunt, qui fiunt per i litteram, siqui ita dicat, Titius pro eo quod
est Tit<s>us, Aventius pro eo quod est Avent<s>us,
Amantius pro eo quod est Amant<s>us. quo modo ergo hoc fit
vitium? definiamus illud, et videbimus. postea, quo modo cavere
debemus. fit hoc vitium, quotiens post ti vel di syllabam sequitur
vocalis, si non sibilus
sit. quotienscumque enim post ti vel di syllabam sequitur vocalis,
illud ti vel di in sibilum
vertendum est. non debemus dicere ita, quem ad modum scribitur
Titius, sed Tit<s>us; media illa syllaba mutatur in sibilum.
1. Le manuscrit contient : Titius pro eo quod est Titius, Aventius pro eo quod est Aventius, Amantius pro eo quod est Amantius. Donc si on traduit : l'erreur serait de dire "Titius au lieu de Titius, Amantius au lieu de Amantius, etc." : cela ne veut rien dire. Les linguistes ont donc tenté de corriger cette apparente aberration, j'utilise ici <s>.
2. Certains linguistes estiment que l'auteur voulait écrire Titsius comme forme correcte. Or Pompeius écrit (trad.lat.) "ce ti ou ce di doit être changé en sifflante". Il voulait donc sans doute écrire Titsus (comme le fait remarquer J. N. Adams, GLA:99-100, et comme cela est conforme à l'évolution phonétique connue : rationem > *ratsone > *radzone > "raison").
3. Selon Adams (GLA:100), le plus probable est que Pompeius dictait à son scribe, que ce dernier aurait bien écrit Titsus, et qu'un copiste aurait plus tard "corrigé" en Titius, par mauvaise compréhension du manuscrit (GLA:100).
(prop.tradu.) "Les iotacismes sont ceux [les défauts] qui concernent la lettre i, par exemple lorsqu'on dit Titius au lieu de Titsus, Aventius au lieu de Aventsus, Amantius au lieu de Amantsus. En quoi cela est-il un défaut ? Décrivons cela, puis nous verrons comment l'éviter. Ce défaut consiste à ne pas prononcer de sifflante (sibilus) chaque fois qu'une voyelle suit la syllabe ti ou di. En effet, chaque fois qu'une voyelle suit la syllabe ti ou di, ce ti ou ce di doit être changé en sifflante. Nous ne devons pas dire Titius comme il est écrit, mais Titsus, avec la syllabe médiane changée en sifflante."
Commentaires sur ce dernier extrait :
- Pompeius prône une prononciation bien
différente de celle du latin classique : [ts] et [dz]. Selon LL:275, sa position semble s'inscrire dans le
cadre d'un renoncement aux règles de prononciation du latin classique
(mais ici Pompeius va plus loin en condamnant la prononciation du
latin classique, ou une prononciation apparentée : /titiʋs/
ou /tit
- Cet extrait illustre bien le style de
Pompeius : sens très clair, avec des phrases simples et avec des
répétitions. Ce style a conduit certains linguistes à estimer que
Pompeius était peu érudit, c'est possible mais à l'opposé, on peut
estimer que ce style était utilisé dans le but de faire passer le
message au plus grand nombre. On peut aussi se demander s'il
connaissait la prononciation classique de Titius
; ou bien il la connaissait très bien mais il se mettait à un certain
niveau pour enseigner la prononciation courante.
À la même époque, Consentius écrit (17.1-6 Niedermann = GL 5.395.2-7) :
sed et in aliis litteris sunt gentilia quaedam quorundam vitia;
ecce ut in t Itali ita pingue nescio quid sonant, ut cum dicunt
“etiam”, nihil de media syllaba infringant. Graeci contra, ubi non
debent infringere, de sono eius litterae infringunt, ut, cum dicunt
“optimus” mediam syllabam ita sonent, quasi post t z Graecum
admisceant.
(RDL:203)
(DcDLR:66-67, BMCELVL:735)
À l'intervocalique, vers l'an 400, la demi-palatale /
À partir de la fin du VIe siècle, plutôt au VIIe
siècle, une dépalatalisation
affecte
En bilan, on aura pour tĭ, tĕ en
tĭ,
tĕ > (Ier
siècle) /ty/ > (IIe
siècle) /(i̯)
Il faut noter que /
Jules Ronjat (GIPPM-2:389) propose une explication à (AO) rez
Pour les autres mots du même type (OM
oreson, rogueson, seson), il
s'agit soit de
Évolutions
dialectales
particulières
:
- Dauphinois (d) : on peut penser qu'il y a toujours i diphtongal (voir ci-dessous dans le tableau : raison, saison), mais il faudrait étudier plus de mots, si c'est possible. Cette évolution semble rejoindre la présence systématique du i diphtongal pour l'évolution dauphinoise de ke, ki en position faible.
Voir notamment Gratiapolitanum >
Graisivaudan (avec ai).
- Bordelais (sous-dialecte du gascon) (bord) : souvent tĭ, tĕ > d :
*ăcūtĭārĕ > agudar "aiguiser"
dīcĕrĕ > dider [didé] "dire"
făc(ĭ)ē(b)ăt > hadé "il faisait"
pōtĭōnĕm > podon "poison"
răcēmŭm >
Cette évolution est attestée dès le XIIIe siècle (GIPPM-2:121-122). Elle est conforme à l'évolution
bordelaise de ke, ki en
position faible, et elle rejoint l'évolution
aquitaine
de d intervocalique.
Certains mots n'ont jamais d'aboutissement d
: rătĭōnĕm, sătĭōnĕm (mots
très sujets à emprunt selon GIPPM-2:122). Il est possible que l'aboutissement
d soit une réduction du stade /
- Gascon (g) : finale parfois > -ch : ?
- Nord-occitan (n.-o.) : parfois > /dj/ ?
Tableau d'exemples :
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
AO
> OA
|
|
À l'intervocalique |
||
|
tĭ, tĕ
en
|
> |
/(i̯)dz/
> /(i̯)z/ -(i)s-
/(i̯)ts/ > /(i̯)s/ -(i)tz si position finale après l'apocope |
| -ātĭōnĕ(m)
|
> |
(AO)
-az |
| -acion |
||
| -ĭtĭă(m) |
> |
AO
- |
| *ăcūtĭārĕ |
> |
agusar "aiguiser" |
| Cŭrretĭă(m)
(ē ?) |
> |
Corresa "Corrèze" |
| Dĕcetĭă(m)
(ĕ ?) |
> |
fr Décize (58) (1) |
| *Grātĭăpŏlitānŭ(m) |
> |
(d) Graisivaudan
("Grésivaudan") (38) |
| jŭstĭtĭă(m) |
AO
justicia (et
formes mi-savantes) > justícia
"justice" |
|
| ōrātĭōnĕ(m)
|
> |
AO
oraz AO oraci |
| pălātĭŭ(m) |
> |
AO
palatz, palaitz, palais
> palais..."palais"
(2) |
| pōtĭōnĕ(m) |
> |
AO
poiz |
| prĕtĭŭ(m) |
> |
AO
pr |
| pŭtĕŭ(m) |
> |
AO
p |
| rătĭōnĕ(m) | > |
AO
raz racion "ration" |
| rŏgātĭōnĕ(m)
|
> |
AO
roaz a.fr. roüaison, ruvaisun "rogation" |
| sătĭōnĕ(m) |
> |
AO
saz |
| spatĭŭ(m) |
> |
AO
espa AO espaci > oc. espaci |
| stătĭōnĕ(m) |
> |
AO
estaz |
| tītĭōnĕ(m) |
> |
AO
tiz |
| Ūcĕtĭăs (acc.f.pl.) > Ūcĕtĭŭ(m) | *Uz |
|
| Vĕnĕtĭă(m) | AO
Venesa,
fr Venise (1) |
|
| vēnātĭōnĕ(m) | AO
venaiz |
|
| vĭtĭŭ(m) |
> |
AO
v |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de tĭ, tĕ
en hiatus après voyelle. Les différentes formes en AO et OA
données ici donnent un éclairage sur l'apparition du i
diphtongal. (En AO, le s
intervocalique se prononce /s/, consonne
(1) Pour Dĕcetĭăm, Vĕnĕtĭăm
> fr. Décize, Venise, le
traitement présente deux étapes typiquement françaises : il y a eu
diphtongaison spontanée de ĕ,
d'où la triphongue iei, puis iei se réduit à i.
Pour Ucĕtĭŭ(m) > Usètz, le
traitement est occitan. L'AO Venesa
est incertain (
(2) Pour pălātĭŭm, c'est peut-être un francisme très ancien, de par l'importance politique du "maire du palais" chez les mérovingiens (Ve-VIIIe siècle).
(3) Pour prĕtĭŭm > pretz
"prix", le DOM
donne AO
pr
(4) pour rătĭōnĕm, pour l'AO,
GIPPM-2:89 donne la forme alternante raiz
Palatalisation par régression :
Dans de nombreux cas, la première consonne est palatalisée par régression.
Absence de sonorisation : /s/ et non
/z/
La présence d'une consonne
Voici les différents cas selon la consonne
(Remarque : étudier l'aboutissement ich, voir A. Thomas (QNLFOG:6): Actia > Aicha des textes limousins, aujourd'hui Aixe-sur-Vienne, oc Aissa).
Pour le cas de ctĭ, ctĕ :
parfois un i apparaît, parfois
non : făctĭōnĕm
> faiçon / façon, lectĭōnĕm > leiçon, leçon.
Parfois il n'y a pas de i
: *extractiāre > estraçar
(mais AO
estraissa "trace").
Je pense que l'absence ou la présence de i
devant ç retrace deux
évolutions possibles :
- d'abord assimilation -ct > -tt- : cela ne produit pas de i diphtongal (voir ci-dessous -ttĭă) (comme en français : IPHAF:47) ;
- d'abord spirantisation -ct- >
-yt- (typique d'une prononciation gauloise) : cela produit /
Les deux évolutions -ct- > -tt-
et -ct- > -yt- se
produisent peut-être dans les mêmes périodes dans le sud de la Gaule,
vers les IVe et Ve siècles, ce qui a dû permettre
l'une où l'autre évolution selon les régions. Dans le nord de la Gaule,
apparemment on n'a eu que la première évolution -ct
> -tt- (pas de i
en français).
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
AO
> OA
|
| ctĭ, ctĕ en hiatus | > |
/yts/
> /(i̯)s/ (i)ç
|
| ăctĭōnĕ(m)
|
(AO)
acci |
|
|
|
> |
(pr) caiç, caice,
chaiç, chaice "barbe d'un épi de blé ; épillet d'orge des
rats ; ...) |
|
|
> |
(AO)
dreisar, dresar > dreiçar ; (g, lim,
rouerg) dreçar
; (a) drechar
; (auv, pr.ma., niç)
driçar "dresser" |
|
|
> |
(AO)
estrasar > estraçar
"déchirer" |
| făctĭōnĕ(m)
|
> |
(AO)
fais (lang, gasc, lim, auv) faiçon "façon" faccion "faction" |
| lectĭōnĕ(m)
|
> |
(AO)
leis |
|
|
> |
(AO) susar, susar > suçar ; (niç) siçar ; (auv) suchar "sucer" |
|
|
> |
(AO) estraçar "suivre à la trace" ; estraiça "trace" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de ctĭ, ctĕ
en hiatus. Les différentes formes en AO et OA
données ici donnent un éclairage sur l'apparition du i
diphtongal. (En AO, le s
intervocalique se prononce /s/, consonne
Pour le cas de stĭ, stĕ (ăngŭstĭăm > angoissa), le s subit une palatalisation
régressive. Au stade /s
Le cas rejoint donc l'évolution de scĭ, scĕ ci-dessus et l'évolution de ssĭ, ssĕ ci-dessous.
stĭ,
stĕ > /sty/ > /s
Dans ce cas, comme le son /ts/ n'est pas apparu (ou bien seulement de
façon fugace), on n'utilise pas ç
mais ss.
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
AO
> OA
|
|
|
||
| stĭ, stĕ en hiatus | > |
/i̯s/
iss |
| ăngŭstĭă(m) |
> |
(AO)
ang |
| bēstĭă(m) |
(AO)
b |
|
| bīstĭă(m) |
> |
? > (niç) bissa,
(Va) bicha
"couleuvre ; orvet" ; (e.f.?)
bicha "biche" (1) |
| pŏstĭŭs |
> |
(AO)
p |
| ōstĭŭ(m)
>
ūstĭŭ(m) |
> | (AO) uis, ueis, us > us, uis ; (a) uich "huis" |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de stĭ, stĕ
en hiatus. Les différentes formes en AO et OA
données ici donnent un éclairage sur l'apparition du i
diphtongal. (En AO, le s
intervocalique se prononce /s/, consonne
Pour le cas de ntĭ, ntĕ (căntĭōnĕm > cançon), la palalasation
régressive mène à /
Pour le français, le i diphtongal apparaît si /
Ainsi : ntĭ, ntĕ
> (Ier
siècle) /nty/ > (IIe
siècle) /
Tableau ci-dessus : évolution de ntĭ, ntĕ
en hiatus. (En AO, le s
intervocalique se prononce /s/, consonne
Si tĭ, tĕ est précédé de l, p, r, ou t
: je n'ai pas encore bien résolu le cas, qui ouvre sur des domaines
vastes et discutés, (mots difficiles à expliquer en français comme
"tiers",
Les mots concernés ne montrent ni i diphtongal, ni
diphtongaison conditionnée (pour ŏ, ĕ,
voir descendants de *bŏttĭă,
*plăttĕă, fŏrtĭă, scŏrtĕa, nĕptĭă, nŏptĭăs...). On
peut penser qu'il n'y a pas eu de palatalisation
régressive (sinon on aurait eu par exemple : *bŏttĭă
>
-ttĭă >
(IIe siècle) /-t
> (VIIe s. : dégémination et dépalatalisation)
/-tsa/
> (vers 1200 : désaffrication)
> /-sa/ -ça
(plaça, bòça)
-ptĭă >
(IIe siècle) /-p
> (assimilation pt >
tt) > /-t
> (VIIe s. : dégémination et dépalatalisation) > /-tsa/
> (vers 1200 : désaffrication)
/-sa/ -ça
(nèça)
-rtĭă >
(IIe siècle) /-r
> (VIIe s. : dépalatalisation) /-rtsa/
> (vers 1200 : désaffrication) /-rsa/ -rça (fòrça)
-ltĭă >
(IIe siècle) /-l
> (VIIe s. : dépalatalisation) /-ltsa/
> (vocalisation
du
l devant consonne, désaffrication)
/-
On doit aborder ici le problème de la
Il faut relier cette
Certains auteurs estiment que le type italien gi (pregio) est un gallicisme (LDIL:134, TK:142a : pregio
proviendrait de prĕtĭŭm à
travers un intermédiaire
Cette
|
|
|
|
|
latin LPC (latin classique ancien ou conservateur) |
|
AO
> OA
|
Après consonne autre que c, s, n |
||
| Ctĭ, Ctĕ en hiatus | > |
/(C)ts/ > (C)ç /(C)s/ |
| > |
AO
alsar, ausar > rouerg alsar
; auçar "hausser" |
|
|
|
> |
AO ? > beç, for bieç "bouleau" (1) |
|
|
> |
AO
b |
| > |
AO
casar > caçar
"chasser" |
|
| > |
AO
casa > caça
"poêlon pour prendre l'eau" |
|
| fŏrtĭăm (pl.n.a.>sing.f.s.) | > |
AO
f |
| > |
AO
masa > maça
"masse (outil ou arme)" |
|
| matĕŏlăm > |
> |
AO
mas |
| nĕptĭă(m) | > |
AO
n |
| nŭptĭă(m) > nŏptĭă(m) | > |
AO
n |
| > |
AO
p |
|
| plătĕă(m)
> |
> |
AO
plasa > plaça
; d placia
i.s.?
"place" |
| scŏrtĕa(m) | > |
AO
esc |
| tertĭŭ(m), -ĭă(m) | > |
AO
t |
|
|
|
|
Tableau ci-dessus : évolution de tĭ, tĕ
en hiatus après consonne autre que c,
s. (En AO, le s
intervocalique se prononce /s/, consonne
En français, l'apparition du i diphtongal est systématique
(rătĭōnĕm > "raison") (sauf
dans les cas complexes juste ci-dessus : biès,
nièce, nueces, pièce, tiers).
En occitan, la situation est variable. Jules Ronjat (GIPPM-2:88-89) réalise une brève étude de cet
aspect, et réunit dans le même destin les continuateurs de tĭ,
tĕ latins et de ce, ci latins en position faible.
Il conclut qu'à l'intérieur d'un mot, on obtient AO
Ailleurs, on aurait eu une alternance
en fonction de la place par rapport à l'accent tonique :
Mais le i diphtongal est
lui-même facultatif dans i̯ dz
´ puisqu'on a AO
Il faut corriger cette vision
puisque les continuateurs de tĭ, tĕ
latins et les continuateurs de ce, ci latins en position faible
ont des destins différents. Il n'y a jamais eu de i
diphtongal pour ces derniers (sauf en
Points à éclaircir :
- pourquoi le i diphtongal apparaît toujours en français et souvent n'apparaît pas en occitan ?
- quels sont les paramètres qui le font apparaître ou non en occitan ? (J. Ronjat parle d'une alternance : de type imprévisible ?). Je pense qu'il est quand même possible, contrairement à ce qu'affirme J. Ronjat, qu'un traitement dialectal fût à l'origine de ces différences. En nord-occitan, on aurait plutôt le i diphtongal ; en sud-occitan le i diphtongal ne serait pas apparu. (Voir les anciennes attestations qui semblent dominantes à Avignon : razon, sazon HLPA). Voir la tentative d'explication (vague et hypothétique).
sŏfĭă(m) > sòfia "vandoise"..., lyonnais suiffe, Côte d'Or seuffle, seuffre, Jura soife, soufe (FEW 12:23a).
*sŏfĭă(m) "sapin" > adauph suiffe "sapin", Briançon sufi "épicéa"... (FEW 12:22b-23a)
Schéma général :
c
+ ŏ, ŭ en
Donc c + ŏ, ŭ en
Détail :
Les auteurs estiment que très tôt, dans c
+ ŏ, ŭ en
c
+ ŏ, ŭ +
Dans Prob, les items 14 et 15 semblent bien blâmer la
Prob,14 vacua non vaqua "vacua ["vide"], pas vaqua"
Prob,15 vacui non vaqui "vacui ["vide"], pas vaqui"
Les cas ci-dessous entrent dans le cadre des délabialisations
tardives de QV (ci-dessus), puisque dans les mots "cacher",
"cailler", n-oc calhar,
*ădcŏactĭtārĕ > acatar
cŏactārĕ > cachar
*cŏactĭcārĕ > a.fr. cachier > "cacher"
cŏāgŭlārĕ /ko-a:-gʋ-la:-ré/ > /
ĭnchŏārĕ > AO encar "commencer"
Autres cas :
văcŭŭs "vide" > > AO vac
vŏcŭŭs "vide" > AO voc
Pour :
*pascŭātĭcŭm > pascatge
"pacage",
nascŭĭt
> nasquèt "(il) naquit",
François de La Chaussée fait entrer ces deux derniers cas dans l'amuïssement de ŭ après groupe consonantique (IPHAF:146). On pourrait tout aussi bien les faire entrer dans l'évolution de c + ŏ, ŭ + voyelle, mais il est vrai que le graffiti de Pomp (futebatur "elle se fait foutre") indique que le ŭ en hiatus s'était déjà amuï, à l'époque où les autres ŭ en hiatus étaient encore prononcés mais "consonifiés" (À mieux étudier).
Certains auteurs distinguent la situation où ŭ disparaît après groupe consonantique
(IPHAF:146), alors que d'autres préfèrent
distinguer la situation où ŭ
disparaît en posttonique devant u,
o (ILV:47). Ainsi Veikko Väänänen estime que battuo "je bats", carduus
"chardon", consuo "je couds",
fatuus "fade ; insensé", futuo "je fous", ingenuus
"indigène", mortuus "mort", quattuor "quatre", ont perdu le ŭ devant o,
u. Par ailleurs, le suffixe
Il faudrait mieux étudier ces aspects.
Dans battvere, battvalia, febrvarius..., le V représente la voyelle ŭ, qui disparaît par la suite (IPHAF:146).
Basculement d'accent dans les infinitifs :
Dans les infinitifs ci-dessous (battŭĕre, consŭĕre,*futtŭĕre), en latin classique ŭ porte normalement l'accent tonique. Mais dans de nombreuses formes conjuguées : battŭō "je bats", c'est la syllabe précédente qui le porte. Par analogie, l'infinitif s'est.
P. Fouché donne (PHF-f2:155) : "Ainsi d'après báttwo, báttwis, etc. (< báttŭo, báttŭis, etc.), l'infinitif battŭĕre est devenu báttwere. La chute de w antévocalique a ensuite déterminé *bátto, *báttis, etc. et *báttĕre."
aestŭārĭŭm > AO estier, ester "canal, ruisseau"
battŭĕrĕ > (IIe s.) battĕre > oc batre "battre"
battŭālĭă > (Ve s.) batalia > oc batalha "bataille"
fĕbrŭārĭŭs > fĕbrārĭus > oc febrier "février"
*fŭttŭĕrĕ > oc fotre
"foutre" (1)
lat.chr.
victuālĭă > a.fr. vitaille
"nourriture" (voir "ravitailler"), AO vitalha,
voir aussi ci-dessus vettovaglia.
Pour consuĕre "coudre", n s'est amuï précocément pour arriver à cosuere. On n'avait donc plus de groupe consonantique devant u. Voir ci-dessous consuere.
(1) Pour *fŭttŭĕre,
l'orthographe est fŭtŭĕre
: elle ne note pas la
(2) Pour consuĕre, je ne sais
pas quelle valeur avait u.
Par ailleurs je ne sais pas si l'amuïssement de ce u
a eu lieu en premier, ou bien l'amuïssement
de n devant s.
P. Fouché (PHF-f2:155) propose un traitement identique à battŭĕre.
Pour quattŭŏr : ce mot aurait d'abord subi une dissimilation ancienne pour aboutir à quattŏr (dissimilation kw/ttu̯ > kw/tt. La forme quattor est attestée dans CIL VI, 13302 dans ILV:47 [et non 48], ALL 7, 65 ds FEW t. 2, p. 1440b (CNRTL "quatre") (voir aussi IPHAF:146 qui signale aussi la dissimilation).
Pour annŭālĕm, ēlectŭārĭŭm, Mantŭăm,
certains descendants montrent une épenthèse de waw qui a demeuré sous
forme de v : voir ci-dessus descendance
des waws épenthiques dans les hiatus primaires. Le o
( < ŭ) a pu disparaître par
syncope, ou se maintenir selon les dialectes (voir aussi le paragraphe
ci-dessous).
L'évolution est disparate : ŏ, ŭ
(+ w épenthique) en hiatus peuvent suivre plusieurs voies :
(ci-dessous en rouge v, b représentent le v épenthique latin décrit ci-dessus)
Voir ci-dessus un
scénario négligé.
Par exemple pour jānŭārĭŭm
> "janvier" d'après les auteurs, ŭ
en hiatus se serait consonifié, c'est-à-dire que la voyelle ŭ
serait devenue la consonne
Cependant selon moi, les aboutissements v,
b dans jenŭārĭŭm
> AO
genvier,
gervier, gembei,
fr "janvier", même dans annŭālĕm
> a.fr.
anvel
"annuel", proviennent souvent (toujours ?) d'un w
épenthique latin qui est resté après
(TGnu:213) "(...) avec résolution en voyelle,
prov. janoier et genoier, d'où, après intercalation d'un
v entre deux voyelles en hiatus dont une
| jānŭārĭŭm | > AO janovier |
| jānŭārĭŭm > jenuarium | > AO genovier, gembei, gervier... a.fr. genever, jenovier, fr "janvier" |
| > AO genier, genoier | |
Il est sans doute hasardeux de ranger tous les cas ci-dessous dans le
cas "v provient d'un w
épenthique latin", mais les nombreux descendants de jānŭārĭŭm "janvier" me
semblent indiquer que ce type d'évolution a été important.
Voici les autres cas susceptibles d'entrer dans ce schéma :
annŭālĕm > a.fr. anvel "annuel"
jenŭārĭŭm > AO
genvier,
gervier, gembei,
fr "janvier"
malŭăm > AO malva, OM malva, mava, mala, maula, fr "mauve"
mănŭālem > AO manoal, manual, mambal "manuel"
tĕnŭĕm
> a.fr. teneve, tenve,
terve "ténu, maigre"
vĭdŭăm > *vedova > vedve > a.fr. "veuve"
Ci-dessus, pour rv (gervier, terve), voir nv > rv.
jenŭārĭŭm > AO genoier "janvier" (-ārĭŭm > -ier)
mănŭālĕm > AO manoal "à main"
Les voyelles ŏ, ŭ en hiatus
peuvent disparaître (∅).
Par exemple voir mănŭālĕm > a.fr. manel "manuel" (IPHAF:149 : "élision
ancienne du
(TGnu:211) : "Peut-être a-t-on de bonne heure fui
devant l'obstacle de l'articulation nu et a-t-on pas hésité à
substituer à la forme traditionnelle du latin une création analogique
plus aisée, manalis, manarius à manualis, manuarius, par
exemple, entraîné par l'existence à l'époque antique de annalis
à côté de annualis."
dŭŏdĕcim > insc.chrét. dodeci, dodece, it dodici, oc dotge/dotze, fr "douze", esp doce... (ILV:46 §79, SNEVLGS pour duodena).
jenŭārĭŭm > AO janier, genier, g gier "janvier" (TGnu:213)
malŭăm > oc mala "mauve, plante"
mănŭālĕm > AO manal "manuel"
consuĕrĕ > *cosuĕrĕ > *cosĕre > g, lim cóser "coudre", esp coser (2)
stătŭālĕm > AO estadal "sorte de cierge" (voir aussi estatuia)
Mesua, Mesoa (attesté plusieurs fois
depuis le Ier siècle) > Mesa [mézò], Mèze (34)
Dans l'aboutissement ov, le v provient du w épenthique, voir notamment la série de mots italiens à ce lien.
jenŭārĭŭm > AO
genovier,
ginovier, janovier,
a.fr. genever, jenovier
"janvier" (TGnu).
annŭālĕm > AO annual, anual, a.fr. annuel "annuel"
mănŭālĕm > AO manual "à main", a.fr. manuel "qui se fait à la main"
(TGnu)
On occitan, il me semble qu'on peut mettre en évidence un type de métathèse
ayant connu un certain succès : consonne + ŭ
en
vĭdŭăm
> veusa "veuve"
malŭăm
> maula "mauve" (ci-dessus LV
= lŭ(w)).
tĕnŭĕm
> tèune "ténu,
grêle" (ci-dessus : N +V + voyelle).
săpŭī
> AO
saup
(la conjugaison originelle de săpĕre
était : parf săpīvī / săpiī,
mais elle a été reconstruite sur le modèle de hăbēre, hăbŭī
> săpēre, săpŭī ; le
GAP:308-309 : "L'u
de la terminaison
săpŭī > AO saup "je sus"
săpŭĭstī > AO saubist "tu sus"
săpŭĭt > AO saup "il sut"
săpŭĭmŭs > AO saubem "nous sûmes"
săpŭĭstĭs > AO saubetz "vous sûtes"
săpŭērŭnt > AO saupron "ils surent"
cēpĭt > *căpŭĭt > caup "il fut contenu" (GAP:309)
ērĭpŭĭt > AO ereup "il délivra" (GAP:309)
rĕcĭpŭĭt > AO receup "il reçut" (GAP:309)
(aperceup,
conceup, deceup)
1. Avec consonne + ŭw
On peut faire intervenir le w dans vĭdŭăm
*[wiðʋwa] (voir ŭv
écrit ŭ), ou le w
épenthique latin ; la métathèse aurait lieu alors entre deux
consonnes (consonne + ŭ + w > w + ŭ + consonne), ce qui semble
phonétiquement plus acceptable qu'entre consonne et voyelle.
avec une métathèse très ancienne :
vĭdŭăm
*[wi
avec une métathèse plus tardive :
Il est aussi possible que l'épenthèse se réalisât plus tardivement, à
une époque où w latin était prononcé [v], donc :
*[vé
2. Avec consonne + ŭ
Un scénario sans w épenthique est possible :
vĭdŭăm
*[wi
La variante mav
(Concernant l'Italie du sud, j'ai vu à plusieurs reprise ce
