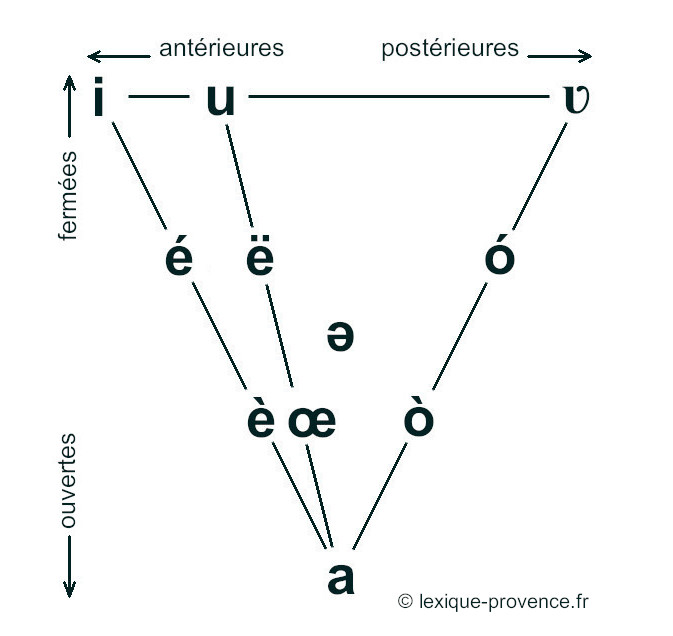Transcription
phonétique,
variations régionales de la prononciation, et quelques problèmes
d'orthographe
I. Transcription
phonétique
La transcription utilisée n'est pas celle de l'alphabet phonétique
international, peut-être difficile pour beaucoup de français. Mais c'est
à peu près celle utilisée par le CNRS pour l'atlas linguistique de la France (par
exemple l'ALEP), c'est-à-dire l'alphabet de
Rousselot-Gilliéron (ou de l'abbé Rousselot).
Cependant j'ai remplacé plusieurs symboles de ce dernier alphabet par
des symboles de l'API
; pour les cas peu intuitifs, je mets le plus souvent des infobulles
pour être clair.
Une syllabe soulignée porte l'accent
tonique :
Cantar [kãta]
(chanter), canta [kãto/a] (il chante)
Je souligne indifféremment la syllabe ou la voyelle tonique.
1. Durée (quantité vocalique)
La durée vocalique, ou quantité vocalique, est très généralement brève
en provençal (quantités
vocaliques en occitan). Il me semble que quand on entend des
voyelles longues, c'est seulement dans un discours emphatique.
Le français parlé avec l'accent méridional est d'ailleurs caractérisé
par l'absence des voyelles longues.
Le cas des voyelles nasales est particulier (ci-dessous).
Quand elle existe, une voyelle longue est notée suivie du symbole [ː] comme [aː].
Le triangle vocalique de l'occitan.
Ce type de schéma permet, dans toutes les langues, d'avoir une
représentation des voyelles utilisées dans un repère à deux axes.
- L'axe "antérieures-postérieures" représente la profondeur du point d'articulation, c'est-à-dire
la partie de la bouche employée pour prononcer les voyelles (avec la
langue à l'avant ou à l'arrière de la bouche).
- L'axe "ouvertes-fermées" représente le degré
d'ouverture (ou d'aperture), c'est-à-dire la position de la
langue plus ou moins rapprochée du palais quand on prononce ces
voyelles.
Pour le français, on doit distinguer deux a différents : [a] et [ɑ],
d'où une forme de trapèze du schéma (triangle ou
trapèze vocalique). La série ɑ-ò-ó-ʋ
est prononcée avec les lèvres formant un rond, d'où le nom de voyelles
arrondies. Il en est de même pour la série œ-ë-u. Les autres
sont non arrondies.
Ce schéma concerne l'occitan standard, et le provençal standard,
mais il existe d'autres voyelles selon les dialectes et les locuteurs,
voir ci-dessous [e], [o], voyelles
de timbre intermédiaire.
b. Liste des
voyelles simples
[a] = a
[ë] = e fermé (comme
dans "jeu", "feu")
[œ] = e
ouvert (comme dans "peur", "œuf")
[é] = é fermé (comme
dans "purée") - C'est la e estrecha.
(/é/ était parfois noté ẹ
en graphie médiévale ; voir "Du latin au provençal 2" e
point souscrit).
[è] = è (comme dans
"mère", "fer") - C'est la e larga.
La bonne prononciation [é] ou [è],
bien que fluctuante dans certains mots (soleu,
pebre) est en général très importante pour avoir le bon accent.
Voir aussi prononciation de en.
(/è/ était parfois noté ȩ
en graphie médiévale ; voir "Du latin au provençal 2" e caudata).
[e] = voyelle
intermédiaire entre é et è. Cette lettre est souvent employée pour
retranscrire un e prétonique,
mais on peut hésiter avec la suivante [ə].
[ə]
= "schwa", voyelle neutre, centrale, qui
existait par exemple en français en fin de mot féminin : "canne",
"voiture", et que certains prononcent encore surtout dans le midi.
[i] = i
[ó] = o fermé (comme
dans "flot", "peau") - C'est la o
estrecha.
(/ó/ était parfois noté ọ
e graphie médiévale, par analogie avec ẹ
ci-dessus).
[ò] = o ouvert (de
homme, sol) - C'est la o larga.
(/ò/ était parfois noté ǫ en graphie
médiévale, par analogie avec ȩ ci-dessus).
[o] = intermédiaire
entre ó et ò
[u] = u (comme dans
"sûr")
[ʋ] = ou (comme
dans "poule").
Dans cantar, lòng, anèm, les voyelles "nasales" sont prononcées
"avec un fort accent
méridional" (voir voyelles
"nasales" provençales). La voyelle est partiellement nasalisée, ce
qu'indique le tilde (~) (voire pas du tout nasalisée) ; et une consonne
nasale est sensible à sa suite, mais peu prononcée, donc écrite en
exposant : par exemple [ò̃ŋ] dans lòng "long".
Très souvent, les voyelles "nasales" sont mal prononcées par les
néo-provençalisants, qui réalisent par exemple en finale soit un -g
(lo pan [pãŋg],
soit un -n (lo pan [pan]).
La consonne nasale peu prononcée sera :
- m devant p, b (acampar, semblar) ;
- n devant t, d (sentir, candèla) ;
- ŋ
dans les autres cas : lònga lò̃ŋgò/a], encara [é̃ŋkarò/a]..., pan [pãŋ], fen [fé̃ŋ], prim [prĩŋ], codonh [kʋdʋ̃ŋ]...
Je n'ai pas placé ŋ, m, n pour le moment dans les articles
du dictionnaire (par simple négligence).
Pour la longueur (quantité) des voyelles
nasales, voir la longueur des voyelles
nasales toniques en pénultième.
[ã] = a
partiellement nasalisé : França
[frãŋso/a] "France".
[é̃] = é
partiellement nasalisé : lenga
[lé̃ŋgo/a] "langue". Voir ci-dessous prononciation
de en.
[è̃] = è
partiellement nasalisé : anèm
[anè̃ŋ] "(nous) allons" - la différence entre
[é̃] et [è̃] est parfois ténue, mais elle existe et elle est très
importante pour avoir le bon accent. Voir ci-dessous prononciation
de en.
[ẽ] = son
intermédiaire entre les deux sons précédents.
[ĩ] = i
partiellement nasalisé comme le i de "ping-pong" (sans entendre aucun g)
: vin [vĩŋ] "vin".
[ò̃] = o ouvert
partiellement nasalisé comme le o de "ping-pong" (sans entendre aucun g)
: tròn [trò̃ŋ] "tonnerre".
[ũ] = u
partiellement nasalisé : mesclum
[mesklũŋ] "mesclun, mélange de salades vertes".
Cette voyelle nasale est plus ou moins ouverte selon les régions et les
locuteurs, parfois proche de [œ̃].
[œ̃] = œ
partiellement nasalisé : luench,
une des prononciations : [lüœ̃ŋ].
[ʋ̃] = "ou"
partiellement nasalisé comme dans "kung-fu" (sans entendre aucun g):
Avinhon [aviñʋ̃ŋ]
4.
Éléments non accentués de diphtongues
À l'intérieur de diphtongues (ou de
triphtongues), il existe un (ou deux) éléments non accentués, ou
éléments faibles. Cependant la distinction entre élément faible de
diphtongue et semi-voyelle (appelée aussi semi-consonne ou glide : ci-dessus)
a été négligée pendant longtemps par les linguistes, et aujourd'hui la
situation n'est pas claire. Voir Diphtongues
: discussion.
Pour le moment dans les articles du dictionnaire, je n'ai utilisé que
les semi-voyelles pour la retranscription phonétique (y, w, ü). Dans de
nombreux cas, la bonne transcription devrait être : i̯,
ʋ̯, u̯ pour les trois éléments ci-dessous.
[y] = paire
[payré], familha
[famiyo/a]
[w] = soleu
[sʋléw]
[ü] = buòu
[büòw] (bœuf)
J'attends de disposer de nouvelles études pour être plus clair sur ce
point. En une première approche, il me semble que certains informateurs
au nord du mont Ventoux prononcent de vraies diphtongues.
5. Voyelles de
timbre intermédiaire
Dans plusieurs cas, l'emploi de voyelles de timbre intermédiaire a été
nécessaire, par exemple pour représenter le son intermédiaire entre o et
a. L'alphabet de Rousselot-Gilliéron a prévu pour cela un système de
voyelles superposées (ex : aͦ = son intermédiaire entre o et a). Mais je
me suis heurté à des problèmes techniques pour retranscrire la diversité
des situations. J'ai donc choisi de représenter par exemple par [(oa)]
un son intermédiaire entre o et a.
Une voyelle peu prononcée, qui peut être à peine perceptible, est
écrite en exposant (petite lettre en hauteur), par exemple a réduit : [a].
Les lettres ont les mêmes valeurs que les lettres françaises, avec les
précisions suivantes :
- [ʃ] prononcé "ch"
: chivau [tʃivaw]
"cheval" ;
- [s] prononcé "ss"
: caçar [kasa]
"chasser" ;
- [g] prononcé
comme dans "gare" : agantar
[agãta] "attraper" ;
- [ṙ] = r "roulé"
(dans certains terroirs ; voir ci-dessous dans les variantes régionales,
les deux types de r "roulé") ;
- [ñ] = gn : montanha [mũtaño/a]
"montagne" ;
- [λ]
= l "mouillé" (comme dans l'italien voglio
"je veux" ; jadis le lh
occitan était prononcé ainsi dans tout le domaine d'oc, mais à présent
le l "mouillé" n'existe que vers l'ouest (Gard...), l'extrême nord du domaine
étudié... Le lh est à
présent réalisé en général [y] dans les deux départements étudiés.
- [h]
(pour mémoire) : quelques données comparatives en gascon utilisent le
son [h], qui est un h aspiré (h fricatif). Il provient de
l'évolution du f. Parfois, à
l'écriture, on est obligé d'utiliser le point intérieur, qui permet de
distinguer nh et n·h,
ainsi que sh et s·h.
Exemples : des·har,
variante de desfaire
"défaire", in·hèrn, variante
de infèrn "enfer".
Semi-consonnes (ou
semi-voyelles, ou glides)
Les semi-consonnes sont y, w, ü ; elles ont un statut très fluctuant selon les
linguistes (consonnes, semi-consonnes, semi-voyelles, glides). Elles
sont difficiles à distinguer des éléments
faibles de diphtongues (ci-dessous). En latin, j et v
étaient des consonnes, voir yod
et waw en latin).
Pour l'occitan, par exemple dans filha "fille", la valeur
ancienne de lh [λ] (ci-dessus)
a en général évolué, comme pour le français, vers [y] : [fiyo/a]. En position intervocalique,
les autres semi-consonnes sont rares : w est limité presque uniquement au gascon, ü existe-t-il en position intervocalique ?
Une consonne peu prononcée, qui peut être à peine perceptible, est
écrite en exposant (petite lettre en hauteur), par exemple r
réduit : [r], ŋ réduit : [ŋ] (ci-dessous pour les voyelles
"nasales").

II. Variations régionales de la
prononciation
A. Voyelle finale
atone du féminin : [o/a]
La voyelle finale atone du féminin a
est prononcée selon les terroirs [o], [a], ou [ə].
La
prononciation [a] est la plus ancienne (voir latin, italien, espagnol),
et elle est conservée dans les zones hachurées sur la carte. J'ai choisi d'écrire [o/a] ; chacun peut la
prononcer avec le timbre de son choix. Par exemple, la
pèira = la pierre, est transcrit [pèyro/a]
; ce mot peut être prononcé [pèyro],
[pèyra], [pèyrə],
et les intermédiaires.
Le u se prononce [ë] (e
fermé comme dans jeu) dans certains terroirs assez nombreux. Par
exemple, susar = suer, est
transcrit [suza], mais
peut être prononcé [sëza].
Étudier l'ancienneté de ce phénomène (antériorisation
du
u
latin).
C.
Prononciation
de
e, é, è.
Merci à Bernard Moulin pour ses
informations.
Les e, é, è posent parfois
problème.
1.
Règle générale : respect de l'origine étymologique
Logiquement, le e ou é du provençal se prononce toujours
[é] ("e" estrecha) : la
carreta, la cresta, crénher, prenes
"tu prends". Le è se prononce
toujours [è] ("e" larga) : la tèsta, lèst,
tèrra. Dans ces mots, la valeur
du e ouvert ou fermé est
constante dans tout le domaine d'étude, et on se doit de bien le
prononcer. La prononciation et l'orthographe sont ainsi en conformité
avec l'étymologie : è
provient du ĕ
latin, /é/ provient du ē
ou du ĭ
latins (voir ici
dans : Du latin au provençal).
Les néo-provençalisants sont parfois approximatifs, notamment dans la
prononciation de mots comme carreta
(charette) : la prononciation est toujours [karéto/a],
alors
qu'avec l'influence du français, on a tendance à le prononcer [karèto/a].
(Bernard
Moulin, comm. pers.).
2.
Variations
autour de la règle générale
La prononciation de certains mots peut dépendre des locuteurs ou des
régions, et il est connu que les provençaux prononcent en général conseu, soleu, veire avec un e
ouvert /è/ (voir ci-dessous
un texte de Robert Lafont). L'idéal est de bien écouter la prononciation
des locuteurs ayant appris la langue "au berceau". Il faut souvent
raisonner au cas par cas. Le TDF note beaucoup de variantes, par exemple soulèu et souleu,
mais elles ne sont pas toutes répertoriées. L'ALEP est aussi une très bonne source. Nous
tentons d'approfondir la question dans ce site, pour chaque mot où cela
pose problème.
Cela dit, la connaissance des règles de l'évolution depuis le latin
jusqu'à l'occitan reste la base, comme expliqué ci-dessus.
Certaines grandes tendances sont expliquées dans les Préconizacions
dau CLO (source archivée ici, p. 138).
Concernant la graphie, les Préconizacions
dau
CLO (ici,
p. 139) précisent :
"Quand se sent lo besonh de notar
estrechament un parlar determinat, es admés de repartir "è" e "e/é"
per notar la pronóncia locala exacta. Aicí la forma referenciala es en
gras e la varianta en maigre: castèu
(varianta: casteu), parlèsse
(var. parlesse), prètz (var.
pretz), soleu (var. solèu),
temps
(var. tèmps), ven (var. vèn),
Provença (var. Provènça), sciéncia (var. sciència)…"
(pour temps, ven,
lexique-provence préconise au contraire la graphie tèmps,
vèn ; voir
les arguments ci-dessous : prononciation
de en, én, èn).
Par ailleurs devant r (ou
rarement l), e
se prononce [è]. Il s'agit de l'influence
ouvrante de r. Par
exemple vergueta se prononce
[vèrgéto/a].
Enfin il faut signaler que le e
prétonique se prononce souvent [e], c'est-à-dire avec une prononciation
intermédiaire entre [é] et [è]. Par exemple : petit
[peti].
Aurelha, aurilha
(oreille) : certains mots se prononcent avec un e fermé, qui devient
très fermé dans certaines régions (intermédiaire entre [é] et [i], et
qui est même parfois réalisé [i].
Exemples : Aurelha, botelha, abelha,
Marselha.
à continuer (le [i] est-il étymologique ou
secondaire à [é] ?).
Les mots en -ier,
ièr ?
Ce domaine touche aussi à l'alternance vocalique (e,è)
dans la conjugaison de nombreux verbes.
D. Prononciation de
en, én, èn
: la lenga corrènta [la lé̃go
kʋrè̃to] mou13
(Merci à Bernard Moulin pour ses informations)
(Comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème a été long.
Courant 2015, concernant la Provence, j'ai pris la décision de modifier
la norme de PCLO au sujet de l'accent écrit sur e
nasalisé, pour les raisons qui suivent. Le site contient encore
probablement quelques incohérences sur ce plan).
À l'écoute attentive des enregistrements, on se rend compte que les
locuteurs provençaux font bien la distinction articulée entre /é̃/ et
/è̃/. Le degré d'ouverture du e
est fluctuant et on se demande souvent si on entend plutôt /é̃/ ou plutôt
/è̃/, mais une différence nette apparaît régulièrement quand on entend
deux mots à proximité :
la lenga corrènta
[la lé̃go kʋrè̃to]
mou13 = la langue courante.
Le mot lenga est toujours
prononcé avec e fermé (e
estrecha), alors que corrènt
est prononcé avec un e plus
ouvert (e larga), comme tous les
participes présents. De façon générale, il semble que /é̃/ soit toujours
assez typique, alors que le degré d'ouverture de /è̃/ varie tout en étant
plus ouvert que /é̃/.
Cette prononciation des provençaux n'est pas une fantaisie : elle provient
de l'évolution des voyelles latines au cours des Ier et IIe
siècles après J.-C. : voir mutation
du
système vocalique. L'évolution historique est la même que pour le
paragraphe ci-dessus (Prononciation de e, é, è). On peut en déduire
que les autres dialectes ont aboli la distinction entre /é̃/ et /è̃/, à
des dates probablement variables.
Dans la langue d'oc, les dialectes autres que le provençal et le
vivaro-alpin ne font pas cette distinction entre /é̃/ et /è̃/. L'évolution
phonétique à l'ouest du Rhône a mené à la fermeture
de è devant nasale implosive.
L'IEO (PCLO) avait supprimé les accents : ben,
ren, temps, corrent. La distinction entre /é̃/ et /è̃/ ne se
faisant plus dans presque tous les dialectes autres que le provençal et le
vivaro-alpin, on comprend la gêne qu'imposerait le maintien des accents.
Mais comme développé dans la partie "Du latin au provençal 2" ici
(pour l'évolution du e latin), on peut estimer que la
suppression des accents est une perte de la richesse du provençal (et du
vivaro-alpin), et il a été décidé de les maintenir dans ce site.
Les mots ci-dessus s'écriront donc : bèn,
rèn,
tèmps, corrènt. Mais on écrira lenga,
Provença, sembla (qui proviennent des mots latins lĭnguam,
Prōvĭncĭam, sĭmĭlat), et qui sont effectivement prononcés avec
/é̃/ (cependant Provença est
souvent prononcé avec /è̃/). Cet aspect est particulièrement difficile
pour un non-provençalisant car le français contient moins de voyelles
nasales que le provençal (voir la raison historique dans la partie "Du
latin au provençal 1" ici).
Comme il est précisé ici,
Frédéric Mistral avait tenu à respecter la distinction à l'écrit entre en et èn,
mais il serait intéressant de savoir s'il s'est aidé de l'étymologie, ou
bien de la prononciation effective (quelques cas sont cependant
discutables : il donne sèmbles
au lieu de sembles "tu sembles",
que j'ai enregistré fréquemment).
Redonnons ici la règle énoncée dans la partie ici
:
Que ce soit pour e ou pour en : si le mot français est en /yè/,
/yè̃/, alors le mot provençal est en /è/, /è̃/ : il porte l'accent grave.
Cette règle ne peut pas aider quand e
est entravé (suivi de deux consonnes), puisque le français n'a alors pas
pu subir la diphtongaison romane en iè
(èrba, vèntre...)... mais le castillan l'a subie ! (Celui qui
connaît le castillan peut s'aider de la règle : si le mot castillan est en
/yè/, alors l'occitan est en /è/ et réciproquement : ierba
<=> èrba ; corriente <=> corrènt ; vientre <=> vèntre
; tiempo <=> tèmps ; aprende <=> aprend - il y a
cependant eu des réfections analogiques
en castillan : siembra, hiende
alors qu'en occitan souvent : sembla,
fende).
Voici une source fournie (et traduite) par Benard Moulin (encore
merci à lui) :
Robert Lafont (L'ortografia
occitana, lo provençau, 1972) :
"le provençal, et surtout le
rhodanien, a tendance à réaliser comme des "è" [ouverts] de nombreux "é"
[fermés] romans [c'est-à-dire de l'ancien occitan] : [...] consèu,
solèu, [...] vèire (=
verre ou voir), rèm (= rame),
Provènça.... Parallèlement, le
rhodanien a maintenu "è" [ouvert] devant une consonne nasale alors que
l'occitan commun le fermait : rèn,
cènt, sèmpre, dènt, disènt. Mais "e" restait fermé dans le
suffixe -ment : autrament,
bastiment. Comme l'ouverture de "é" en "è" n'a pas une valeur
phonologique claire, qu'elle distingue graphiquement le provençal de
l'ensemble occitan, qu'elle se justifie surtout en rhodanien, et qu'elle
surcharge l'écrit d'accents, nous pensons qu'on pourrait se dispenser de
la noter: [...] conseu, soleu, [...] veire, rem, Provença, [...], ren,
cent, dent, disent." [fin de citation]
Les Préconizacions dau CLO
(ici,
p. 138) précisent :
"E mai se la distincion entre
"è" larga e "e/é" estrecha es encara ben viva en occitan orientau,
l’usatge pòt esitar subre lo gra d’apertura dins tota una sèria de
mots. En generau, dins lei mots que fluctuan ansin, la distincion
fonologica es pas clara entre "è" e "e/é" (Lafont 1972).
Aquò es sovent lo cas per "e"
seminasala, plaçada davant "n, m" en fin de sillaba (ex. Provença,
setembre, ren, temps): per de rasons fisicas d’articulacion, lei
vocalas seminasalas fan una distincion mens neta entre vocalas largas
e estrechas (Martinet 1996: 44).
Redonnons les conseils des Préconizacions
dau
CLO cités plus haut (source archivée ici) :
"Quand se sent lo besonh de
notar estrechament un parlar determinat, es admés de repartir "è" e
"e/é" per notar la pronóncia locala exacta. Aicí la forma referenciala
es en gras e la varianta en maigre: castèu
(varianta: casteu), parlèsse
(var. parlesse), prètz (var.
pretz), soleu (var. solèu),
temps
(var. tèmps), ven (var. vèn),
Provença (var. Provènça), sciéncia (var. sciència)…"
Ce sujet touche aussi à l'alternance vocalique (e,è) dans la conjugaison de
nombreux verbes. Voir par exemple une discussion à semblar.
E. Influence
ouvrante du
r et problèmes
connexes
Voir "Linguistique historique" à "Actions
ouvrantes sur le timbre vocalique".
1.
Influence ouvrante du
r et du
l
Voir "Linguistique historique" à "Devant
r et l (influence ouvrante)".
Pour des raisons articulatoires, une voyelle suivie de r
a tendance à s'ouvrir, notamment si le r
est suivi d'une consonne ("r implosif") (IPHAF:105, GIPPM-1:135).
Cela est aussi le cas pour l
(IPHAF p. 121, GIPPM-1 p. 135).
Estela >
(estèla) (mais la graphie ne note pas cet accent grave) ;
peut-être aussi : gèla
> jala "il gèle".
En français, pour l'influence ouvrante du r,
on peut donner : "vierge" (< virge)
; "cierge" (< cirge) ;
"beurre" (< bure) ;
"marché" (< mercatum) ;
"dartre" (< derbitum) (IPHAF p. 105). Pour l'évolution er
> ar, les grammairiens ont combattu les prononciations
populaires en [a] au profit d'un retour à la forme étymologique en [è].
Ils ont réussi par exemple pour "mercredi", qui a éliminé l'ancien marcredi. Mais la tendance
populaire a triomphé dans "marché", "dartre".
En occitan, on peut donner : Cièrgue
(< Cirĭcus, nom propre), estiela (l) (< stellam).
En français, pour l'influence ouvrante du l,
on peut donner : "chaleur", "chalumeau", "chalonge" (passé en anglais à
challenge), qui auraient dû
être *cheleur, *chelumeau, *chelonge
en vertu de la loi de
Bartsch.
Dans une
grande partie de la Provence, on trouve une influence ouvrante du r très marquée pour /é/ prétonique
devant (rr) ou (r
+ consonne), qui devient /a/ :
en prétonique (syllabe avant l'accent
tonique) :
/é/ + r
+ consonne > /a/ + r + consonne
Les dictionnaires récents (DPF p. 16, DBFP, DOGMO) proposent de ne pas le noter à l'écrit.
Donc on peut avoir : enterrar
[ẽtara], ermàs
[armas], ferrat
[fara], mercat
[marka], merluça
[marluso/a], terralha
[tarayo/a].
Dans les conjugaisons, enterrar
[ẽtara] conserve le [a]
même en tonique : entèrra
[ẽtar(o/a)] "il
enterre". Dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, même tèrra
se prononce [taro] (par
ouverture de /è/ tonique devant r,
ou bien par analogie avec enterrar
[ẽtara]).
Par ailleurs, per [pèr] étant proclitique,
il peut parfaitement évoluer en [par], conformément à la règle
ci-dessus. La prononciation [par] a souvent été enregistrée.
Il faut remarquer que même
un /é/ étymologique (explication ici)
a subi l'influence ouvrante du r
(ou bien une analogie avec les autres mots en èr)
:
vĭrĭde(m) > /vérdé/
> /vèr/
Accent
graphique sur e devant r + consonne (et devant l)
:
On doit mettre l'accent grave sur e
devant r + consonne en graphie
classique, en fonction de l'étymologie (cas de "la
è larga tradicionala" dans l'extrait ci-dessous) :
"L’ortografia classica nòta sensa
esitacion la è larga tradicionala davant rr o davant r + consonanta: tèrra, guèrra, pèrdre,
èrba (mai classicament: verd).
L’ortografia mistralenca suprimís l’accent grèu dins aquela posicion e
mai se la pronóncia referenciala mistralenca es [è]: “terro, guerro,
perdre, erbo”" (PCLO,
source archivée ici,
p. 139).
(Pour la graphie mistralienne en effet, l'accent grave n'est jamais mis
mais on le prononce toujours [è] : "on le prononce ouvert s'il est suivi
de deux l ou de deux r
ou bien d'un r et d'une autre
consonne" GP-F ; notons que cette règle
n'est pas respectée dans "cèrvi,
cèrbi" du TDF).
Il faut donc en fait distinguer deux cas :
- cas où /è/ provient de la mutation
vocalique des premiers siècles de notre ère : l'étymologie impose
è pour tous les e
devant r ;
- cas où /è/ provient de l'influence ouvrante de r
ou l subséquent : verd
qui provient du latin vĭrĭde(m)
devrait se prononcer [vér] du fait de la mutation vocalique ; mais il
est toujours prononcé [vèr] au
moins dans les enquêtes réalisées. Le PCLO cité ci-dessus préconise d'écrire quand même
verd. On
peut citer, dans le même cas que verd, clerc, ferma
(fermar), verga ; estela.
Pour le mot hérité du grec nerta,
la prononciation enregistrée est /nérto/ ; ce cas doit être
étudié.
Remarque : cette influence ouvrante s'est réalisée naturellement à
plusieurs époques, par exemple en latin archaïque : voir facteurs
tempérant l'apophonie.
2.
Transformation de
e prétonique
en
a
Ce phénomène semble indépendant de l'influence ouvrante de r
ou de l, et il est bien mal
connu. Il affecte des mots français en
re- et un grand nombre de
mots occitans. Son étude semble très négligée pour le français,
et absente (?) pour l'occitan.
Pour les verbes français avec un
préfixe ra- :
Le CNRTL donne (on
développe ici les abréviations) : "Variante ra-
du préfixe re- : Elle a son
origine dans un fait de prononciation ancien. On trouve encore vivante
au XIXe siècle une alternance re-/ra-
pour rabouiller, raconter, rafraîchir, ragaillardir".
Comme verbes français avec ra- (considéré comme une variante de re-),
citons (GEMNC) :
rabibocher, rabrouer, radoter, raffut(er), rambiner, rapapilloter,
rapetasser, ratatiner, et une série de verbes en -ouiller :
rabouiller, rafouiller, ragouiller, ratouiller, rassouiller.
Pour de nombreux verbes français à base adjectivale ou nominale
(rafraîchir, rajeunir...), on hésite entre une variante ra- du préfixe
re-, et "le résultat d'une double préfixation en a- puis re- dont le
stade intermédiaire (*ajeunir) n'est pas attesté" (GEMNC).
Pour les mots provençaux, je me
borne pour le moment à citer quelques exemples, qui montrent une étendue
du phénomène bien plus large qu'en français. Il s'agit de phénomènes d'assimilations
et de dissimilations
à distance.
Rementar > ramentar
Repassa > rapassa
Ressar > rassar.
Revassejar > ravassejar.
Redòrta > radòrta.
Creserèu > cresarèu.
Remarque : samèla (semèla) (Avignon) : voir CNRTL.
Bertàs > bartàs ? (Bertàs : Stes-Maries)
On peut se demander s'il n'existe pas un schéma de transformation des
verbes en
e-e-a > a-e-a :
Cresinar > crasinar
Rementar > ramentar
Semenar > samenar
Trepejar / trapejar
Escabeçar > escabaçar
Repassar > rapassar
Ternassar > tarnassar
Tremontana < tramontana
F.
Prononciation de
j et de
ch
Les sons [dj] (jaune) et [tʃ]
(chin) sont prononcés [dz] et
[ts] dans les zones hachurées de la carte. Par exemple, jaune
"jaune", est transcrit [djawné],
mais
peut être prononcé [dzawné]
;
chin = chien, est prononcé
[tsĩ] dans les mêmes zones, et non [tʃĩ]. Les locuteurs qui prononcent
ainsi réalisent parfois tout de même un léger chuintement. On obtient
alors un son intermédiaire : [d(jz)], [t(ʃs)].
Voir réflexion
sur les aboutissements actuels de ce,
ci, ge, gi en position forte et diversité
géographique des palatalisations.
1. Prononciation de
r
en Provence
TDF ("R")
: "à Avignon et Saint-Rémy de Provence, on grasseye cette lettre ; à
Toulon, Aix, Marseille et Arles, on la roule quand elle est seule, et on
la grasseye quand elle est double".
Dans la majeure partie de la Provence (zone [r] de la carte), les locuteurs distinguent
traditionnellement deux r
(deux phonèmes).
Par contre dans la région d'Avignon et de Saint-Rémy, comme le signale
F. Mistral ci-dessus, r est
toujours prononcé comme en français standard.
Voici les deux r du provençal
:
Le
r
simple intervocalique
C'est un [ṙ]
r alvéolaire "battu" (plutôt que "roulé"), bref,
liquide, proche du l ; dans le
site il est transcrit [ṙ], voir API : [ɾ] (lien Wikipédia). Je pense qu'il est souvent
plus bref et plus liquide que dans l'espagnol pero
ou l'italien mare. Il est
parfois réalisé complètement [l] : pereu
[pélew] rou84 sttr84, amarum
[amalũ]
rou84,
mei parènts [mi palè̃] gou84 ont été enregistrés. Il est souvent
amuï devant yé : parier
[payé] "pareil", amorier [amʋyé]
"mûrier" ; il est aussi amuï dans certains autres cas dans certains
territoires (tiassar [tyasa] pour tirassar).
Le
r
dans toute autre position
Le r dans toute autre position (rr,
r pré- ou postconsonantique, r initial ou final) : c'est le r français standard, c'est-à-dire
le r fricatif uvulaire aussi appelé "r
grasseyé", voir API
[ʁ] (lien Wikipédia) ; dans le site il est
transcrit [r].
Les locuteurs font ainsi nettement la distinction entre -r-
et -rr- intervocaliques. Si on
prononce un r à la place d'un
autre, ils nous reprennent. Ce sont deux phonèmes (et non deux allophones). Ainsi amarra
"amarre" se distingue de amara
"amère" à l'oral.
2. Prononciation de
r en domaine vivaro-alpin
TDF ("R")
: "les Dauphinois", les "Provençaux des Alpes roulent l'r,
rampellon".
Les enquêtes montrent en effet que tout au nord du domaine d'étude
(vallée du Toulourenc : nord-Vaucluse, sud-Drôme), certains locuteurs
roulent tous les r, comme dans
de nombreuses campagnes françaises au XXe siècle : r
battu ou r roulé, voir API
(liens Wikipédia [ɾ], [r]).
Je ne sais pas si la prononciation distingue r
et rr à l'intervocalique, à
étudier.
Pour le moment, j'ai confondu ce son avec [ṙ] précédent dans les
quelques cas où j'en ai eu besoin.
3. Prononciation de
r
à l'ouest du Rhône
TDF ("R")
: "les Languedociens, [...], Gascons, Catalans [...] roulent l'r,
rampellon".
Ainsi plusieurs régions du domaine d'oc et de la Catalogne roulent (ou
roulaient) l'r, comme dans le
vivaro-alpin ci-dessus.
TDF ("R")
: "À Lodève, Montpellier, et dans quelques pays du Rouergue, r médian
se prononce comme d : paire,
paide, gaire, gaide, cagaraulo, cagadaulo, vèire, bèide".
Le r simple intervocalique
prononcé d est ainsi distingué
de r en toute autre position,
dans quelques régions assez restreintres. Mais j'ignore si dans d'autres
régions, r intervocalique
simple est distingué de rr
intervocalique (par exemple en étant roulé moins longtemps, ou bien r serait simplement "battu", et rr serait "roulé").
Le d à la place de r
est attesté précisément dans l'ALF :
aira
"aire" [ayda]
Pau34, [aydó]
Agd34 ;
beure
"boire" [béwdé]
Agd34, Pau34 ;
cagaraula
"escargot" [kagadawló]
Agd34 ;
farina
"farine" [fadinó] Agd34,
[faina] Pau34 ;
gaire
"guère" [gaydé] Agd34, Pau34 ;
paire
"père" [paydé] Agd34, Pau34 ;
pèiras
"pierres" [pèydas]
Pau34, [pèydòs]
Agd34 ;
ressaire
"scieur de long" [résaydé]
Agd34, Pau34 ;
sautarèla
"sauterelle" [sawtadèló] Agd34 ;
veire
"voir" [bèydé]
Agd34, Pau34 ;
vipera
"vipère" [bipédó] Agd34 ;
etc.
mais plòure
"pleuvoir" [plòwré] Agd34, Pau34.
TDF ("R")
: "En Languedoc, r se change
souvent en n, par une erreur
populaire sur les dérivés des mots en ou
: acaloura, acalouna, moucadourat,
moucadounat, meiouro, melhouno."
(Apparemment l'ALF ne contient aucun des mots acaloura,
moucadourat, meiouro).
H.
Transformation du [s] intervocalique en [ks]
Vers l'ouest des Bouches-du-Rhône, Avignon, au moins une partie
orientale du Gard, le [s] intervocalique est souvent prononcé [ks]. Si
une diphtongue précède, elle disparaît.
Exemples :
caucida "chardon Cirsium
arvense" est prononcé [kʋksido]
et non [kówsido] ;
taisson "blaireau"
est prononcé [tiksʋ̃]
et non [téysʋ̃] ;
eissame "essaim" est prononcé
[eksamé] et non [éysamé]
;
diccionari "dictionnaire" est
prononcé [diksyʋnari]
et non [disyʋnari]
comme le voudrait la règle des groupes consonnantiques ;
aucèu "oiseau" est prononcé
[ʋksèw] et non [ówsèw].
Il faut expliquer l'origine de ce phénomène articulatoire.
(à continuer)