Schéma général de la mutation
vocalique pour les voyelles
Pour les voyelles
ā, ă > /a/ (ci-dessous)
ĕ > /è/ (ci-dessous)
ĭ, ē > /é/ (ci-dessous)
ī > /i/ (ci-dessous)
ŏ > /ò/ (ci-dessous)
ō, ŭ > /ó/ (ci-dessous)
ū > /
La quantité vocalique est la longueur des voyelles : elles sont prononcées avec une durée longue, ou courte.
- Le système vocalique latin était très différent du nôtre, car
la
(TMLC:2-3) "La succession régulière d’une longue
et d’une brève, — ᴗ — ᴗ..., d’une brève et d’une longue, ᴗ — ᴗ —...,
d’une longue et de deux brèves, — ᴗ ᴗ— ᴗ ᴗ..., ou toute autre
combinaison, constituait un rythme auquel l'oreille des anciens était
extrêmement sensible. S'il arrivait, nous dit Cicéron (De or.
III, 196), qu'un acteur fît une faute de
- On peut considérer qu'il y a dix voyelles latines :
- cinq longues : ā ē ī ō ū (prononcées avec une longue durée)
- cinq brèves : ă ĕ ĭ ŏ ŭ (prononcées avec une courte durée)
- on peut rajouter le son [
- Les quantités vocaliques d'un mot déterminaient "l'accent" selon les règles ci-dessous. Par exemple : ănĭmăl, ănĭmālĭs (l'accent tonique est souligné).
- Au niveau du timbre, toutes les voyelles étaient prononcées "assez fermées", ou selon d'autres auteurs (ex. : IPHAF:94) elles étaient "de timbre moyen (ni ouvertes, ni fermées)", aussi IPHAF:175. Mais au moins dès le Ier siècle après J.-C., le latin populaire conférait une certaine ouverture aux brèves, et une certaine fermeture aux longues (ci-dessous : étude diachronique des timbres vocaliques).
- Par ailleurs quatre
- Les voyelles latines, avec
leurs
PHF-f2:177 : "La quantité du latin classique est essentiellement "étymologique" : on a une voyelle longue là où en indo-européen on avait soit une voyelle longue, soit une diphtongue. Dans le cas contraire, la voyelle latine est brève."
L'auteur donne des exemples, parmi lesquels :
Exemples pour les voyelles longues :
ā :
ī :
Exemples pour les voyelles brèves :
ĕ :
ŏ :
En pr-i-e, la voyelle *ě, ou parfois *ă,
est le "degré plein", la voyelle *ǒ est le "degré fléchi",
l'absence de voyelle est le "degré zéro". Il existe aussi le "degré
plein allongé" (*ē) et le "degré fléchi allongé" (*ō) (
- Cependant dans l'histoire du latin, de nombreux réarrangements ont eu lieu (apophonies, allongement compensatoire, etc.).
- De même les diphtongues latines sont issues de l'indo-européen, voir diphtongues latines (et grecques).
Du premier au cinquième siècle après J.-C., le système vocalique latin
avec ses voyelles longues et brèves, évolue vers un système où le trait
dominant est l'accent d'intensité,
l'accent tonique. Ce phénomène s'accompagne d'un changement
du timbre des voyelles.
La mutation du système vocalique latin revêt ainsi deux aspects (IPHF:42-43) :
- une mutation de la quantité
vocalique : la quantité étymologique (voyelles brèves et
longues, issues de l'indo-européen) disparaît, au profit de la quantité
liée à l'accent tonique : la voyelle qui porte l'accent devient
ou reste longue, si elle n'est pas
- une mutation de la qualité vocalique, c'est-à-dire du timbre des voyelles : des voyelles plus ouvertes ou plus fermées (ci-dessous mutation du timbre).
Ces aspects sont développés ci-dessous.
Les romains n'utilisaient pas de procédé pour noter les
voyelles longues et brèves, sauf dans certaines rares inscriptions,
où les scribes ont noté les longues, notamment au moyen de l'
Remarque : le fait de noter seulement les longues a été repris dans certains ouvrages contemporains, au moyen du macron ◌̄ (ci-dessous).
L'extrait de
Je cite ci-dessous Max Niedermann.
(PHL4:7-8, Remarque II) :
« La quantité longue des voyelles n'est jamais marquée dans les textes manuscrits. Dans les inscriptions, on la trouve indiquée de façon tout à fait sporadique et capricieuse par divers procédés, à savoir :
1.
au 2e et 1er siècle av. J.-C., à l'imitation d'un
usage pratiqué par les
2. dès la fin du 2e siècle av. J.-C., avec une fréquence particulière sous l'Empire, par l'apex, espèce d'accent, placé au-dessus des voyelles (sauf i, voir plus loin), par exemple múrum I2, 679 (de l'an 104 av. J.-C.), probáta, diés, fécit, órnatum, júdicium etc. CIL I2, 1570 (1er siècle av. J.-C.), beaucoup d'exemples dans le Res gestae Divi Augusti, le monument d'Ancyre (ainsi appelé parce que la meilleure copie, par laquelle cette inscription nous est parvenue, a été trouvée à Ancyre, l'actuel Ankara), I. 1 annós undéviginti, I, 1/2 privatá impensá comparávi, I, 27 senátús etc., et dans un discours, prononcé par l'Empereur Claude devant le sénat en 48 et conservé par une plaque de bronze, trouvée à Lyon, CIL XIII, 1668, 1. 8 réges, 1.10 veniéns, 1.11. Ancó Márcio, 1. 21 Etrúriá ;
3. ī soit par ei, après que l'ancienne diphtongue ei eut passé à ī (voir ei > ī), depuis le 2e siècle av. J.-C. jusque sous l'Empire, soit par l'i longa, c'est-à-dire un i dépassant par en haut le niveau des autres lettres [voir aussi i longa utilisée comme yod] ;
- par exemple fecei, meila, fugiteivos, CIL I2, 638 (de l'an 132 av. J.-C.), audeire CIL I2, 583, 71 (de 123/122 av. J.-C.), inveisa, veiginti, veitae CIL I2, 1570, ceivitates CIL V, 7231 (de l'an 17 av. J.-C.), dans les inscriptions pariétaires de Pompéi [Pomp], par exemple eidus CIL IV, 2437, 3882, veivant CIL IV, 2457,
- d'autre part (Sullae)
FELICI
CIL I2,
721 (de 82/79 av. J.-C.), CIVES
ROMANI CIL I2, 836 (de la fin de la
République), souvent dans le monument d'Ancyre, par exemple I, 10 EXPVLI, I, 14 CIVIBVS
PEPERCI, I, 15 EXCIDERE,
et dans le discours de l'Empereur Claude de 48, CIL XIII, 1668, l. 2/3 PRIMAM,
l. 10 SABINIS, VICINVS, etc. ; LIBERIS CIL XIV,
3608 (1er siècle ap.
Pour certains mots, les grammairiens de l'Antiquité ont décrit la
quantité vocalique. Voir par exemple l'extrait de
Ce sont aussi les quantités controversées de voyelles devant groupes consonantiques qui sont étudiées par les grammairiens latin. Notamment Aulu-Gelle. Voir l'étude de HHLLVAG:375 ; l'auteur pense voir dans les propos d'Aulu-Gelle "les symptômes qui annoncent un changement des plus importants en latin, je veux dire la perte de la valeur distinctive de la quantité vocalique". Cependant les exemples étudiés par Aulu-Gelle ne montrent pas, selon moi, de tels symptômes, mais plutôt des hésitations légitimes de latinisants liées à l'opposition entre la règle 3 de l'accent classique,
quĭescō "je me repose"
(PAAG:546, archive.org) :
- En faveur de e long : le premier ami érudit "dit qu'il fallait prononcer quiescit ["il se repose"], comme on prononce calescit ["il s'échauffe"], nitescit ["il devient luisant"], stupescit ["il s'étonne"], et d'autres mots semblables. Il ajouta que l'e de quies ["repos"] était long et non bref."
- En faveur de e bref : pour le second ami érudit, prononcer quiesco avec e long est "étrange et bizarre", "ce verbe n'est pas semblable aux verbes précédemment cités", et "quies, au lieu d'en être la racine, n'en est que le dérivé." Et cet érudit décrit une origine grecque (ἔσχον).
Commentaires : Ainsi au IIe siècle après J.-C., selon le
témoignage d'Aulu-Gelle, une hésitation existe sur la quantité de e
dans quiesco. Le verbe quĭescĕrĕ "se reposer"
fait partie des verbes
en
actĭtō "je plaide souvent ; je joue souvent (au théâtre)"
(PAAG:575b, archive.org) :
L'étude de la
Cependant, pour les voyelles en syllabe
Juret:12, Benett...
À partir de la bonne connaissance des
pĭrăm > oc pera "poire" : ĭ > é ;
rīpăm > oc riba "rive" : ī > i.
En retour, l'étude des aboutissements dans les langues romanes a permis
d'approfondir la connaissance des
- en utilisant les règles de mutation
vocalique énoncées dans cette partie ;
- en utilisant le fait qu'au cours des siècles, l'accent du latin a perduré dans les mots jusqu'à nos jours (ci-dessous) (ăsĭnŭm > ase "âne" => i était bien bref : ĭ, voir règle 3 ci-dessous).
Les transcriptions grecques de noms latins permettent de reconnaître
certaines
De très nombreuses quantités vocaliques sont accessibles dans le Gaffiot (DFL, aussi Gaffiot 2016).
Certains sites précisent des quantités vocaliques non données dans le
Gaffiot (DÉRom, DHELL) ; ils sont en cours de construction. Le
Wiktionary anglais donne aussi parfois un état des connaissances sur un
mot latin.
Le Gaffiot (DFL) permet (dans tous les cas ?) de trouver
l'emplacement de l'accent : il permet de déduire le poids syllabique de
la
Cas général
Devant un groupe consonantique, les
(Mais la syllabe sera variable pour les muta cum liquida, ci-dessous).
Par exemple, DFL donne : fōrma (avec fōrmo, fōrmŭla,
mais il donne formābĭlis, formātŏr : F. Gaffiot supprime
les longues en position
Par ailleurs, DFL donne : argentum,
quĭesco, quinquĕ, fructŭs, fustis, nullus, olla, pelvis, perfectus,
post, purgo, stella, or on peut apporter les précisions
suivantes : argĕntŭm, quĭēscō, quīnquĕ, frūctŭs, fūstĭs, nūllŭs,
ōllă, pēlvĭs (anciennement trisyllabe pēlŭĭs, DUHLIL:60), pĕrfĕctŭs, pŏst, pūrgō (de pūrŭs),
stēllă. Pour les dérivés de līnŭm "lin", DFL donne linteŭm, lintĕŏlum, FEW donne lĭnteum, lĭnteŏlum, GIPPM-1:118 discute utilement des abrègements de
longues devant groupes consonantiques en latin, avec des analogies
possibles de quīnquĕ sur quīnī, de līnteŏlum
(> linçòu) sur līnu, de
Il faut remarquer que la quantité du a devant groupe consonantique est souvent inconnue : ă et ā aboutissent au même résultat a dans les langues romanes.
Devant x
Le DFL ne précise pas non plus les
Devant muta cum liquida
Devant muta cum liquida, la
Devant ns et nf
Devant ns et nf, la
Le DFL donne la quantité vocalique dans ăb,
dē, ĭn,
nĕ, nē, ŏb, pĕr, prō, sĕd, sī, sŭb..., mais pas dans ad,
cum, ex, post... Cependant il donne ădĭgo,
de ad et ago
(voir apophonies),
ce qui permet de comprendre que a
est bref dans la préposition ad.
(Mais ădĭgo, n'avait pas
forcément l'accent sur ă, voir
ci-dessous les mots composés).
Dans les entrées lexicales, le DFL ne donne pas la
Or ces quantités sont connues :
Pour les noms propres avec voyelle initiale,
le DFL
ne donne jamais de signe diacritique sur la majuscule. Par exemple DFL
Afer "africain" et ses dérivés Afrĭca, Afrĭcus, ont en
réalité un a long : Āfĕr, Āfrĭcă, Āfrĭcŭs (
Il peut s'agir de cas très discutés et
complexes, comme e dans ăres (pour ărĭēs
: voir ărĭēs), voir aussi le
problème de la valeur
vocalique
ou consonantique de i, u
latins, etc.
Remarque : un projet très louable existe sur internet une "nouvelle version revue et augmentée, dite Gaffiot 2016, version V.M. Komarov", élaborée sous la direction de Gérard Gréco, comportant des précisions sur les quantités vocaliques (frūctŭs, quīnquĕ, absēns...), mais il en manque encore (argentum, perfectus, căthedra...), et certaines sont toujours erronées (Gĕnāvă au lieu de Gĕnăvă, vītex au lieu de vĭtex). Ce n'est pas une critique ; l'auteur demande qu'on lui envoie des remarques et corrections.
L'œuvre de Felix Gaffiot (DFL) est particulièrement fiable, mais parfois l'auteur reprend lui-même certaines anciennes erreurs, issues de raisonnements faux. En voici quelques unes ; il serait bon d'établir la liste complète des erreurs et des cas variables ou douteux (entreprise de Gaffiot 2016).
- fŏrĭă "dévoiement, diarrhée" est en fait plus probablement fōrĭă, au regard des descendants actuels (oc foira, fr foire...) (FEW 3:713a,b), voir fōrĭăm > foira.
- Gĕnāvă
"Genève" est en fait Gĕnăvă
(c'était probablement un
- pējŏr
"pire" est en fait pĕjŏr
(FEW 8:156b) : en prosodie, la première syllabe est
lourde, mais c'est en raison du découpage : pej-jor
(le yod est redoublé à l'oral). Les descendants montrent qu'il
s'agissait un ĕ : AO pi
C'est sans doute le même cas pour mājŏr "plus grand", en fait măjŏr (< *măgĭŏr), en cohérence avec măgĭs.
- pĭŭs
"pieux" est en fait pījŭs
(pour ī : FEW 8:620a qui ne met pas ī
en titre d'article mais pīus dans l'étymologie, sans développer
: W. von Wartburg semble hésiter ; PHF-f2:314, IPHAF:85 ; pour j
: IPHAF:85), comme pĭĕtās
"pitié" est en fait pījĕtās
(IPHAF:85 estime que c'était une prononciation
- vītex
"gattilier (arbuste)" est en fait vĭtex,
d'après ses descendants actuels, voir pr
vetge (FEW 14:551b).
Dans de nombreux ouvrages, l'absence d'un signe diacritique sur la voyelle peut avoir trois significations :
- la voyelle est brève (certains ouvrages n'indiquent que les longues, reprenant dans une certaine mesure la tradition romaine ci-dessus) ;
- la
- la
Cela mène à des ambiguïtés. Le Gaffiot (DFL) procède des trois cas ci-dessus.
Enfin dans de nombreux ouvrages, seules les quantités des
Conclusion : il vaut toujours mieux préciser les
En étudiant certains
le schéma
(exemple : *spòndĭtṓrĕm
> sponsṓrĕm " garant") (ALLRL:1,4,5)
Cette évolution a agi par analogie sur le nominatif : *spondĭtŏr > sponsŏr.
le schéma
(exemple : *fulgŭmĭnӑ > fulmĭnă
"foudre", ALLRL:8)
Proposition personnelle : il me semble que le schéma
(voir clāvīcŭlă, vītīcŭlă)
Au sein du même paradigme (à continuer).
Dans l'histoire du latin, certaines quantités vocaliques ont changé (avant la mutation vocalique), apparemment pour des raisons phonétiques.
Voir la notion d'allongement compensatoire.
L'allongement compensatoire existe aussi, certes de façon assez marginale, en occitan (ci-dessous : allongement compensatoire en occitan).
(PHL4:68)
(PHL4:68-69)
Voir amuïssement
de n devant f
ou s.
(PHL4:69-71)
Voir gt > ct à "Évolution des groupes consonantiques", actĭtō ci-dessus.
Certains philologues signalent des mots latins dont la voyelle longue est devenue brève. Ainsi Pierre Fouché (PHF-f2:177-189) décrit des abrègement de voyelles latines longues, qu'il déduit des descendants dans les langues romanes.
Mais François de La Chaussée est réticent à considérer des abrègements
comme une tendance phonétique, et propose des scénarios au cas par cas (IPHAF:126) :
"On a souvent cru constater, dans le latin
parlé, une tendance à l'abrègement de certaines longues, en se fondant
sur certains aboutissements romans. Cette tendance se serait manifestée
avant la disparition de la quantité vocalique et aurait frappé les
La prudence est de mise, car de nombreux cas de voyelle brève en latin vulgaire, là où le latin classique présente une longue, s'expliquent tout autrement que par une évolution phonétique".
Je propose ci-dessous un début d'étude systématique des mots concernés.
Par exemple, Jean-Marie Pierret (PHF-p:142) écrit :
"sous l'influence d'une voyelle brève les
suivant, des voyelles se sont abrégées." (Cela n'est pas toujours vrai
dans les exemples qu'il donne, puisque parfois c'est une voyelle longue
qui suit). Il distingue :
• l'abrègement des voyelles longues
- en position
- en position
• l'abrègement des voyelles longues
Cette position est à peu près la même que celle de Pierre Fouché (PHF-f2:177 et sq.).
Voir intolérance à certains schémas rythmiques ci-dessus.
Comme dit ci-dessus, certains
auteurs, notamment Pierre Fouché (PHF-f2:177-184), estiment que les
(PHF-f2:178)
La forme française
En occitan, on a AO vint
(PHF-f2:178) Les formes a.fr. endieble, norm. dieble (REW 3, 2491), tosc. diebile, montrent que le ē est devenu ĕ dans ces cas (diphtongaison spontanée de è en français).
(Remarque : voir aussi FEW secāle > "seigle", etc.)
La forme attestée fīcātŭm (Apicius) aurait dû conduire à it
Concernant la forme reconstruite
(Cependant d'autres auteurs proposent une autre explication, liée à un flottement dans les quantités vocaliques et dans l'accentuation (IPHAF:126). Ce flottement serait dû au fait que fīcātŭm (DFL) est un calque latin sur le grec συκωτόν (sukotón) (CNRTL "foie") : "Le modèle grec probablement accentué et prononcé de différentes manières par les latins est sans doute pour beaucoup dans les altérations subies par ficátum qui est ainsi à l'origine de formes variées dans les langues romanes".)
Pour expliquer i → e, Gaston Paris (FER) propose un autre scénario utilisant l'influence du grec, repris par Walter von Wartburg (FEW 3:491b-493a). La forme fīcātŭm (IIIe siècle) donnée dans DFL, est un calque sur le grec συκωτόν (sukotón) "foie gras (d'animal nourri de figues)" (FEW 3:492a-b, CNRTL "foie"). L'habitude des grecs de gaver certains animaux de figues pour obtenir un foie pathologique gras, très apprécié en gastronomie, était passée aux romains (FEW 3:491b). Le foie en latin classique se disait jĕcŭr. L'adaptation latine fīcātŭm à partir du grec, aurait causé des hésitations pour les locuteurs latins, sur la prononciation du mot. Le mot grec était scandé sūkōtón. La variante sycotum apparaît dans un poème culinaire datant vraisemblablement du IIIe siècle, et scandé sȳcōtum (FEW 3:492a-b). W. von Warturg estime que ce mot a probablement existé sous la forme *sécotum en latin populaire (y grec > é). Cette dernière forme aurait pu exercer une influence progressive sur fīcātŭm, avec :
1. L'évolution de l'accentuation de fīcātŭm vers *fīcătum ;
2. La mutation i > e
en
3. La mutation (certes géographiquement très limitée) a
> o en
Il faut remarquer qu'on peut très bien proposer une première étape fīcātum
> (abrègement de longue
prétonique ci-dessous)
Proposition de scénario à partir de la forme latine fīcātŭm (d'après FEW 3:491b-493a) (la plupart des variantes provient de FEW 3:490-493).
| f
ī c ā t ŭ m |
> |
roum
ficat
(1), aroum hicat, végl
feguat,
Muggia
figiá, vén figá, Comel figal, Ferr figä́, frioul fiāt,
h.engad. fiṓ, Val.Gard. f |
||
| > (influence
de l'accent de *sécotum
?) |
* f ī c ă t ŭ m | > | esp hígado, port fígado ; apul cal sic log. fíkat a.pic. fie, pic.n. fī, angl-norm firie (Roland) (2). |
|
| >
(influence de *sécotum
?) (ou abrègement de la tonique ?) |
* f ē
c ă t ŭ m * f ĭ c ă t ŭ m |
> |
it fegato | |
| > (néo-apophonie
ou substitution de suffixe) |
* f
ĭ c ĭ t ŭ m |
> |
figido
(Cassel) |
|
| > (métathèse) |
*
f ĭ t ĭ c ŭ m |
> |
*fĭdĭgŭ > a.fr. feie, fr "foie", oc fetge, cat fetge | |
|
> (rhotacisme
d > r) a.fr. firie
(Roland) |
La forme angl-norm fieble
(Roland , Rois, Becket, etc.), ainsi que les formes dialectales
modernes de Normandie, de type fiéble,
fièble, supposent une forme
latine *flĕbĭlĕm
(avec e bref) (PHF-f2:178, FEW 3:617b) (diphtongaison
spontanée de è en français).
Les formes occitanes montrent une conservation du timbre /é/ : type feble /féblé/. La forme française
actuelle "faible" a remplacé le type
(PHF-f2:178)
Voir frīgĭdŭm à "Évolution des proparoxytons".
(PHF-f2:178) (FEW:74b)
La forme a.fr. joindre "premier garçon d'un
boulanger" provient du nominatif jūnĭŏr, et montre
une évolution ū > ŭ.
L'autre forme a.fr.
juindre (> jindre)
montre une conservation de ū.
(Pour le groupe
Les formes françaises dialectales de type jogneu(r), jegneu(r) (types de récipients de cuisine), proviennent de l'accusatif jūnĭōrĕm, et montre une évolution ū > ŭ.
Les formes dialectales de type jegneu(r) montrent une dissimilation o-o > e-o : */djóñóré/ > */djéñóré/.
Pour expliquer ū > ŭ, W. von Wartburg propose une influence de jŭvĕnĭs "jeune" (FEW:74b).
lūrĭdŭm
> fr "lourd", oc lord,
et non fr
- Pierre Fouché range cette évolution dans les abrègements de longues accentuées de proparoxytons.
- Le FEW (5:470b), suivi par F. de La Chaussée, propose un système sōrdidum, sŭrdum, tŭrdum, qui aurait agi par analogie sur lūrĭdŭm > *lŭrĭdŭm. Je pense que c'est une explication satisfaisante.
(PHF-f2:178)
Les formes fr "meuble", oc mòble,
a.esp.
mueble, AO, port.
m
- FEW 2:1344b, NDSAF:68, IPHAF:126, CNRTL
(meuble2) donnent une évolution mōbilis
> *mŏbilis probablement sous
l'influence de mŏvēre
"mouvoir".
- J.-M. Pierret (PHF-p:142) fait entrer ce cas dans l'abrègement
de
voyelles longues de proparoxytons.
- L'influence de mŏvēre
paraît logique, mais aucun de ces ouvrages ne mentionne une évolution
phonétique
sous l'influence de β. Pourtant, si ōvum > ŏvum
"œuf" par influence de v
prononcé /
(PHF-f2:178) mūcĭdŭm > *mŭcĭdŭm > a.fr. moide.
En fait toute la famille du mot suit le même modèle : AO mozir (< *mŭcērĕ). En français, le i diphtongal apparaît pour donner "moisir". Les aboutissements montrent donc que ū > ŭ.
D'après CNRTL, on peut trouver une explication individuelle : "moisir" "Du lat. mūcēre «être moisi» (Caton, en parlant du vin; d'où le type a.fr. muisir), devenu *mŭcēre, prob. sous l'infl. du lat. mŭsteus «doux comme le moût, riche en jus» (dér. du lat. mŭstum, v. moût...)".
fūsĭōnĕm
> fr foison, oc foison
(et non
Selon IPHAF:126, il y aurait eu "dissimilation de
durée" : longue-longue > courte-longue. Donc : fūsĭōnĕm
> *fŭsĭōnĕm.
Je me demande s'il n'y a pas eu analogie tardive sur toison
< *tōsĭōnĕm < tonsĭōnĕm, et sur poison
< pōtĭōnĕm.
frūmentŭm
> fr "froment", oc froment,
forment, et non frument,
furment (mais furment
attesté en a.fr.)
- F. de La Chaussée (IPHAF:126) estime qu'il y a eu "dissimilation de durée" longue-longue > brève-longue (mais il donne ē : frūmēntum : source ?) ;
- J.-M. Pierret (PHF-p:142) fait entrer ce cas dans l'abrègement des voyelles longues prétoniques ;
- J. Ronjat (GIPPM-1:293) invoque un croisement frūmentum
X frŭŏr, frŭĭtus, repris par FEW (3:829a). Mais pour frŭŏr,
le ŭ est peut-être un "faux u bref", voir le système
dēstrŭō, frŭŏr, flŭō, dūcō.
- Je me demande si on ne peut pas faire intervenir une influence analogique
de *fōrmaticus, *frōmaticus (>
fromatge) : le début du mot est identique, avec des métathèses
du même type.
| frūmentŭm
|
> | it
frumento, a.fr. furment,
rom fʋrmaint,
ast furmento, Berg. fʋrm |
||
| > |
frŭmentŭ(m) | > |
fr "froment", oc fromènt, formènt, cat forment, a.esp. hormiento, a.lomb. formento, Sie.,Bor. formént. |
Voir CNRTL "-eur" : "suff. de noms d'action lat., -or, -ōrem, issu d'anciens types de noms au thème en -s-. En latin, par rhotacisme, le s, en position intervocalique aux cas obliques, s'est changé en r, d'où l'alternance -ōs/-ōris, que l'on trouve dans quelques monosyllabes (cf. Ern. Morphol. 1953, pp. 25-29) : flōs, glōs, mōs, rōs et dans les masc. : clāmōs, colōs, honōs, labōs, lepōs, odōs, timōs et vapōs. Mais, sous l'influence des autres cas, un r s'est le plus souvent introduit au nominatif, et a entraîné l'abrègement de l'ō : arbōs, arbor/-ō."
Dans l'histoire du latin, certains timbres vocaliques ont évolué (avant la mutation vocalique).
Par exemple, des "formes rustiques" ont été signalées : tundere pour tondere, abscundere pour abscondere (Ernout in GIPPM-1:187).
Convention : la voyelle (ou la syllabe) soulignée dans le site est celle qui porte l'accent.
Il faut distinguer :
- un accent de hauteur (ou accent musical, ou accent mélodique) : une syllabe d'un mot est prononcée sur une note de musique plus aiguë ;
- un accent
d'intensité,
ou accent tonique : une syllabe est prononcée avec plus de
force.
(fr) "nous sommes
venus", (oc) siam venguts, (it)
siamo venuti, (esp)
hemos venido.
Selon F. de La Chaussée (IPHAF:94) : "l'accent du latin classique, au moins dans la langue cultivée, était musical (accent de hauteur) ; dans le latin populaire, cet accent musical devait s'accompagner d'un élément dynamique (= d'intensité) plus ou moins marqué" .
Trois périodes peuvent être distinguées concernant l'accent latin
(selon ACAL, reprenant d'autres auteurs) :
- période archaïque (jusqu'à -200 ou -100) : l'accent est essentiellement tonique et porté par la première syllabe des mots (cette caractéristique est démontrée par les apophonies) ; les mots longs possèdent un accent secondaire, moins marqué, déterminé à partir de la fin du mot selon les règles énoncées ci-dessous ;
- période classique (vers -200 à +200) :
- registre
cultivé (latin classique) : influencés par le modèle grec, les
locuteurs dépouillent le latin de l'accent tonique, considéré comme
"campagnard" et "étranger" par Cicéron, pour ne conserver que l'accent
mélodique.
- registre
populaire (latin vulgaire) : l'accent est identique à celui de
la période archaïque, mais avec une inversion "accent primaire" : c'est
désormais celui déterminé à partir de la fin du mot / "accent
secondaire", moins marqué : c'est celui toujours porté par la première
syllabe du mot.
-
période tardive (à partir de +100, +200) : l'accent est
identique au registre populaire de la période classique, avec perte
progressive des quantités vocaliques (ce sont les voyelles fortement
accentuées qui deviennent longues si elle sont
Louis Deroy (ACAL:234) insiste sur le fait que l'accent
secondaire était toujours maintenu sur l'initiale, ce qui
permettrait d'expliquer certaines formes italiennes à consonnes géminées
: pellegrino, tollerare, seppellire.
"C'est aussi le cas en roumain, mais non en espagnol ni en gallo-roman,
où peut-être l'influence du latin scolaire a davantage influencé l'usage
populaire." (Voir un autre type de gémination à : type
*prĕttĭŭm).
Max Niedermann (PHL4:113) développe tout un aspect de
redoublement d'
"Ce qui rend ce phénomène déconcertant, c'est d'abord qu'il semble
avoir été absolument sporadique et ensuite que, le plus souvent, la
forme primitive avec consonne simple et voyelle longue est restée en
usage à côté de la forme postérieure avec consonne double et voyelle
brève. Il y a là un problème très complexe qui attend encore sa
solution". Je pense qu'il pourrait y avoir un lien avec l'
Exemples :
Jūpĭtĕr > Jŭppĭtĕr ;
lītĕră
> lĭttĕră "lettre" ;
bācă > băccă "baie".
Je rappelle ici les règles permettant de trouver la syllabe portant
l'accent (plutôt "accent musical" en latin classique, plutôt "accent
tonique" en latin vulgaire), à partir de la fin du mot (exemple : ÉGCOL). Mais il ne faut pas oublier que pour les
mots longs, un accent porté par la syllabe initiale a probablement
toujours existé en latin populaire (voir juste ci-dessus).
Règle
1. Les mots monosyllabiques portent l'accent, sauf
s'ils sont proclitiques.
Ex : ĭt
"il va" : ĭ porte l'accent (on
distingue cet accent dans une phrase, par comparaison à d'autres
syllabes voisines
Règle
2. Les mots de deux syllabes portent toujours l'accent
sur la première syllabe (ce sont tous des
Exception :
apocopes
latines : ex.
Règle
3. Dans les mots de plus de deux syllabes : l'accent
dépend de la quantité syllabique,
ou poids syllabique de la
=> Comment connaît-on la quantité
syllabique de la
- Si la structure montre une voyelle
Remarque : si une voyelle brève est suivie d'une consonne dans la même syllabe, alors on qualifie la syllabe de "longue par position" (longa positione ci-dessous).
- Si la structure montre une voyelle
=> Comment sait-on
si la voyelle est
=> Comment sait-on si une consonne appartient à telle ou telle syllabe ?
(Voir groupes consonantiques et structure des syllabes).
En
général pour deux consonnes situées entre deux voyelles, chacune
appartient à une syllabe différente, même probablement pour les
groupes "
Donc la limite entre les deux syllabes se trouve entre les deux consonnes : adfĕrrĕ = ad-fĕr-rĕ "apporter", argĕntŭm = ar-gĕn-tŭm "argent", fĕrrŭm = fĕr-rŭm "fer", pĕrfĕctŭm = pĕr-fĕc-tŭm "parfait". Voir ILLL:12, IPHAF:37.
Il existe un certain nombre de cas
complexes (ci-dessous).
Remarque :
compter les syllabes (
Concernant la
- les
- les successions de deux voyelles ne sont
pas des diphtongues, mais sont bien des successions de deux
syllabes avec
=> Comment connaît-on la
Accent dans les mots de plus de deux syllabes
Quintilien, Institutio Oratoria, 1, 5, 28; 45
(traduction
"Syllabe longue par position"
Velius Longus, De orthographia, (de litteris)
Nam 'jam vitu' dactylus est, quoniam prima syllaba longa est positione.
(prop.tradu.) Jăm vĭtŭlōs hortārĕ vĭămquĕ insistĕ dŏmandī. "Déjà lorsqu'ils sont veaux stimule-les et efforce-toi de dompter leur destin" [vers des Georgiques, de Virgile].
De fait jăm vĭtŭ est un
Le nom de commune de Levanto
(Ligurie, Italie) présente la particularité d'être accentué sur la
première syllabe : Levanto,
avec une variante dialectale locale diphonguée Lievanto (voir diphtongaison
romane spontanée) ; je suis témoin de la prononciation Levanto
des locuteurs sur place. En suivant les règles énoncées ci-dessus, on
devrait prononcer Levanto
(< *Levantus ?). Raymond
Sindou indique : (OTE13-14) "Curieux aussi le nom de Levanto
au nord de la Spezzia : ital. Levánto, mais génois Lévantu,
peut-être dû à la lingua franca des marins." L'explication est
courte ; je n'arrive pas à trouver d'anciennes formes de Levanto
(formes médiévales) ni son origine (pas de rapport avec l'appellation Riviera
di Levante ?). Dand l'accentuation de Levanto, j'y
verrais volontiers l'influence de noms comme Taranto
"Tarente" du grec Τάραντα (Taranta) ; le lat. a connu aussi la forme apophonique Tărĕntŭm
(voir Tărĕntŭm
aux Apophonies, OTE:13 indique que lat. Taranta était utilisé en poésie; Tarentum
en prose). Il existe aussi Otranto
"Otrante"(Pouilles) < Ύδρόεντα (Hydróenta), et Solanto
(castello di Solanto en Sicile, différent mais proche de Solunto
"Solonte") < Σολόεντα (Solóenta) (OTE:13). Il existe apparemment un nivellement
d'accent pour ces toponymes,
Concernant l'accent dans les mots
composés, notamment les verbes
préfixés, dans de nombreux cas, les locuteurs devaient
reconnaître la composition, et considéraient l'accent seulement du
Les
(ÉGCOL:300) "En cas d'
Il faut signaler que certaines de ces particules (
Pour les mots avec muta cum liquida de type căthĕdră(m), cŏlŭbrĕ(m), ĭntĕgrŭ(m),
palpĕbră(m), tŏnĭtrŭ(m), on pensait jusqu'à récemment que leur
accent avait basculé depuis le latin jusqu'aux langues romanes : d'abord
Mais Michaela Russo estime (ÉGCOL:317) que la place de l'accent n'a jamais dû
changer en latin parlé : ces mots ont toujours été
Les emprunts aux autres langues me paraissent montrer une action forte
pour adapter les mots étrangers au système d'accentuation latin (à
développer). Voici quelques remarques ci-dessous.
Voir les emprunts au grec ("Apophonies") : les emprunts latins très anciens au grec montrent une action forte pour adapter les mots étrangers au système d'accentuation latin.
Ci-dessous, je donne quelques exemples avec hésitation sur la
conservation de l'accent grec :
Étude de ἔγκαυστον (énkauston)
"encre" (CNRTL
"encre") :
ἔγκαυστον (énkauston) > fr "encre", AO encaust "encre", it inchiostro "encre" :
- l'accent grec sur l'initiale est conservé en Gaule du nord (> fr "encre") ;
- l'accent selon les règles latines (sur la deuxième syllabe) est
conservé en Gaule du sud et en Italie (au
est longue, et est
Étude de βούτῡρον (boútūron) "beurre" (GIPPM-2:330, CNRTL "beurre") :
βούτῡρον (boútūron) > AO buire, boder "beurre", a.fr. bure, fr.o.dial. "beurre", it burro (empr.a.fr.), it.dial. butirro, butiro "beurre". (GIPPM-2:330) "βούτῡρον pouvait devenir būtȳ́rum ou bū́tȳrum suivant que l'attention était portée principalement sur la quantité ou sur le ton".
- l'accent grec (sur la première syllabe) est conservé en français et en AO > fr "beurre", AO buire ;
- l'accent selon les règles latines (sur la deuxième syllabe) est
conservé en italien traditionnel : butirro,
et en béarnais : bodèr [b
Je cite Antoine Thomas (EPF:123) :
"C'est un fait universellement admis que
l'accentuation du celtique n'avait pas les mêmes lois que celle du
latin, que notamment l'accent tonique pouvait porter sur l'
Pierre Fouché (PHF-f2.:142-148) fait un long développement sur l'accent des "mots celtiques ou préceltiques" et leur évolution, grâce aux toponymes.
"Dans un certain nombre de composés ou de
dérivés toponymiques, la
Ainsi les composés
celtiques dont le second élément est
Biturīges > Bourges (Cher) ;
Caturīges > Chorges (Hautes-Alpes) [ci-dessous ŭ > ó] ;
Eburovīces > Évreux (Eure) ;
Lemovīces > Limoges (Haute-Vienne) ;
Bodiocasses > Bayeux (Calvados) ;
Durocasses > Dreux (Eure-et-Loir) ;
Tricasses > Troyes (Aube) ;
Vadicasses > Vez (Oise) ;
Viducasses > Vieux (Calvados).
gaul Condāte "confluent" (LNL:12, 44) :
- accentué à la gauloise sur la première syllabe > Candes (37), Condes (39, 52), Cosne (58), Kontze (57) ;
- accentué selon la loi latine sur la pénultième > Condat (15, 24, 63), Candé (41, 49) Condé (nombreuses communes en domaine d'oïl).
gaul Nemausus "lieu consacré ?" (LNL;12, 14) :
- accentué à la gauloise sur la première syllabe > oc Nime(s) "Nîmes", AO Nemse "Nîmes" (voir ci-dessous Nîmes) ;
- accentué selon la loi latine sur la pénultième > Nemours (77).
Nemausu(m) > Nemosu (Nemosus, année 950) ou *Nemasu (PHL4:67).
Puis selon TGF1:159, deux variantes auraient évolué en
parallèle, menant à AO Nemse
par
(Rechercher LNVN).
Pour expliquer la fermeture e > i, je me demande si on ne peut pas invoquer la fermeture entre nasale et nasale implosive)
En règle générale, les syllabes
accentuées en latin classique sont celles accentuées en latin tardif,
puis dans les langues romanes. (EWRS1: page?, RALLF toutes pages, etc.) Elles ne disparaissent
pas lors de l'évolution ultérieure, alors que les syllabes non
accentuées (
PH-2020:217 : "Le calcul de l'accent qui prenait en compte la structure syllabique et la quantité vocalique est nécessairement caduc lorsqu'il n'y a plus d'opposition phonologique de quantité. Ce calcul étant tombé en ruine, l'accent s'est figé sur la voyelle où il se trouvait : il est désormais lexicalisé, i.e. non prédictible et donc appris par les locuteurs comme toutes les autres propriétés de la voyelle tonique.
La conséquence de cette situation est le fait, très remarquable et remarqué, qu'il n'existe dans les langues romanes aucune modification de la place de l'accent : on retrouve l'accent latin sur la même voyelle dans toutes les langues romanes."
(nombreuses références bibliographiques à PH-2020:218, qui commencent à RALLF:7, mais G. Paris cite lui-même EWRS1).
Remarque : on peut se demander jusqu'à quel point l'accent était "calculé" par les locuteurs ; l'accent était peut-être aussi lexicalisé, reproduit par les locuteurs tels qu'ils l'avaient entendu, surtout les locuteurs qui n'étaient pas habitués à la prosodie latine (gaulois...). Sur ce sujet, voir notamment ci-dessus les emprunts au grec et au gaulois.
Les exceptions :
Les auteurs ci-dessus (PH-2020:218) mentionnent deux exceptions à cette règle :
- type colubram (avec muta cum liquida) ;
- type mulierem (voir ăbiĕtĕm etc.).
Cependant il me semble que ces deux exceptions montrent surtout une divergence entre latin classique et latin vulgaire (voir aux liens mentionnés).
- Je rajoute une exception au moins pour le français et l'occitan : basculement de l'accent dans certains hiatus et diphtongues (ci-dessous).
- Et concernant l'occitan, il faut rajouter le basculement
de l'accent pour certains proparoxytons en
Ces deux dernières exceptions sont présentées ci-dessous : perturbations de l'évolution de l'accent.
Il est remarquable que dans les langues germaniques, les emprunts
anciens au latin effacent l'accent, pour adapter le mot au système
d'accent germanique (RALLF:10). L'accent est reporté sur la première
syllable, voir accent
allemand (apophonies), et les voyelles des syllabes suivantes sont
neutralisées en [
Ce processus a perduré longtemps, au cours des emprunts durant l'Antiquité ou durant le Moyen Âge, au latin classique ou au latin médiéval.
Remarque : pour all Krone "couronne" < cŏrōnă, le mot était, je pense, déjà syncopé en latin dialectal lorsqu'il a pénétré en Allemagne.
| latin | occitan, AO | français | allemand |
| (ăd)vŏcātŭ(m) |
(avocat) |
avoué |
Vogt "Bailli, préfet" |
| bōlētŭ(m) | bolet | bolet | Pilz (anc. Bülz) "champignon" |
| ăcētŭ(m) | AO az |
a.fr. aisil | *atecu > Essig "vinaigre" |
| cae-, cepŭllă(m) | cebola
/ cibola |
ciboule | Zwiebel "oignon" (1) |
| calcātōrĭŭ(m) | AO calcad |
a.lorr. chaucheur | Kelter "pressoir" |
| catena(m) | cadena | chaîne | Kette "chaîne" |
| cancellārĭŭ(m) | AO cancelier | chancelier | Kanzler "chancelier" |
| cĕllārĭŭ(m) | celier | cellier | Keller "cave" (1) |
| cĕrĕsĭă(m) | cerieisa | cerise | Kirsche "cerise" (1) |
| Cŏlōnĭă(m) |
Cologne |
Köln |
|
| Co(n)flŭĕntes |
Coblence |
Koblenz |
|
| cŏqu- > cŏcīnă(m) | cosina | cuisine | Küche "cuisine" |
| cŭmīnŭ(m) | AO co-, cumin (cumin) |
a.fr.
co-, cumin (cumin) |
Kümmel "cumin" |
| fĕnĕstră(m) | fenèstra | fenêtre | Fenster |
| hŏspĭtālĕ(m) | ostau | hôtel | Spittel (2) |
| mantĕllŭ(m) | mantèu | manteau | Mantel "manteau" |
| mĕrcātŭ(m) | mercat, marcat | marché | Markt "marché" |
| Mōgontĭăm >
Magontia |
Mayence |
Mainz |
|
| mŏlīnă(m) | molina
(molin) |
(moulin) | Mühle "moulin" |
| mŏnasteriu(m) | AO monastier, mostier | a.fr. mostier (monastère) | Münster "monastère" |
| mŏnētă(m) | moneda | monnaie | Münze "monnaie" |
| părăvĕrēdŭ(m) | AO palafr |
palefroi | Pferd "cheval" (3) |
| pentēcostē | Pandecosta... | Pentecôte | Pfingsten "Pentecôte" (3) |
| *pīlārĕm | pilar | pilier | Pfeiler "pilier" (3) |
| prōpŏsĭtŭ(m) | AO prob |
a.fr.
provost
(4) |
Probst
"prévôt" |
| scŭtĕllă(m)
> *scū- |
escudèla |
écuelle |
Schüssel "plat,
écuelle" |
| tĕ-, tŏlōnārĭŭ(m)... | Zöllner "douanier" (3) | ||
| tĕ-, tŏlōnēŭ(m)... | AO touneu... | a.fr.
tolneu, tonleu, tonlieu... |
Zoll "douane" (3) |
Tableau ci-dessus : Conservation de l'accent latin dans les langues romanes, adaptation de l'accent latin en allemand. (Étymologies vérifiables sur FEW et Wiktionary.) On voit que l'accent du mot latin (souligné) reste le même dans les langues romanes, alors qu'en allemand, il est déplacé sur la première syllabe.
Plusieurs exemples sont tirés de RALLF:10 (repris par HLLF:85) (Vogt, Köln, Fenster, Spittel, Mainz,
Probst) duquel j'ai supprimé Angst
"peur" < angŭstĭăm, car Angst proviendrait plus
probablement du proto-germanique *angustiz,
voir Angst.
J'ai rajouté les autres exemples. Pour Genf "Genève", Gĕnăvă
était sans doute un
(1) Pour cĕllārĭŭm > Keller, cĕrĕsĭă(m) > Kirsche,
la palatalisation de c
devant e, i en latin n'avait en apparence pas commencé (ou
bien en était au stade /
(2) Spittel, nom de divers lieux. Pour hŏspĭtālĕm > Spittel, le (h)ŏ- latin a dû disparaître avant l'emprunt, par confusion avec e prosthétique puis hypercorrection.
(3) Pour bōlētŭ(m) → Pilz, mŏnētă(m)
→ Münze, părăvĕrēdŭ(m) → Pferd "cheval", *pīlārĕm →
Pfeiler, tŏlōnĭŭm → Zoll..., l'évolution [p] > [pf],
[t] > [ts] entre dans la
(4) Pour prōpŏsĭtŭ(m),
une autre variante latine præpŏsĭtŭ(m)
explique AO preb
(Remarque : pour les
Pour la notion d'ouverture des voyelles, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique".
Je cite V. Väänänen (OATLR:2) ; je nomme la loi qu'il propose "loi de l'accent sur la voyelle la plus ouverte".
(Je pense que cette loi est exacte dans un très grand nombre de cas,
mais il faut trouver davantage de sources ; pour le latin un autre
facteur a pu intervenir, comme l'intolérance à certains schémas
rythmiques. Par ailleurs j'étends cette loi aux diphtongues).
(OATLR:2, j.m.c.g., j.s.v.a.)
"Une "loi" ou disposition phonétique du roman commun veut que de deux voyelles contiguës la plus ouverte attire l'accent tonique. C'est ainsi que s'expliquent nombre de déplacements d'accent : non seulement les cas bien connus des mots populaires paríete > par(i)éte, mulíere > muliére, filíolu > filiólu [l'auteur cite LDR:325 et suivantes (1)], formes attestées dès les premiers poètes chrétiens et confirmées par les langues romanes, ainsi que esp. reina, vaina de reína, vaína, fr. reine, gaine, de reïne, roïne et guaïne, gaïne (lat. rēgīna, vāgīna), et esp. veinte, treinta < *veínte, *treínta (lat. vīgintī, trīgintā) (...)."
(1) V. Väänänen renvoie à LDR, mais les termes exacts de ce dernier sont : "le déplacement d'accent est la conséquence inéluctable de la consonification de la voyelle accentuée." (LDR:328) ; cela signifierait qu'il envisage la suite logique : consonification de i => déplacement d'accent. Il est vrai qu'on se demande comment une voyelle accentuée peut devenir une consonne ; on ne peut qu'envisager les deux solutions : (1) déplacement d'accent puis consonification ; (2) simultanément déplacement d'accent et consonification.
En fait ces domaines sont encore mal connus, voir par exemple părĭēs.
(LDR:324 et suiv.)
Pierre Fouché développe cet aspect (PHF-f2:338) (à continuer).
(Remarque : pour les
(Voir aussi ci-dessous : contact entre deux voyelles : différenciation d'aperture).
J'étudie ici ce basculement d'accent qui s'est réalisé à des époques
diverses dans l'histoire du latin et de l'occitan. Pour Povl Skårup (FDAOS), il y a d'abord
(FDAOS:109, pour fīlĭŏlŭm) : "Il y
a
Ci-dessus en effet, l'auteur précise que la syllabe o dans fīlĭŏlŭm s'allonge alors. En effet, le latin impose qu'un voyelle libre pénultième qui porte l'accent soit longue (mais une diphtongue n'est pas une voyelle longue ? Comme la diphtongue au ? À étudier).
Ce type de hiatus concerne souvent les féminins et certaines formes conjuguées.
En occitan, le basculement d'accent ia > ia
s'est manifesté dans les noms féminins en
Cet ordre chronologique est défendu par G. Millardet, qui présente les
deux théories :
(1) /ia/
> /ié/ > /yé/,
(2) /ia/
> /ya/ > /yé/
Il soutient donc la seconde théorie (
Substantifs en
τήγανον (téganon) > *teganem
/ teganum > *tean > *tean
ou *tian
> tian
"plat de cuisine"
Région d'amuïssement de d, t intervocaliques (parties du domaine nord-occitan) :
(voir d intervocalique, t intervocalique)
fœtă(m) > feda > fea > fia ou fea > fia > fiá /fyé/ "brebis"
Les terminaisons féminines -oa, -oas,
ont souvent évolué avec un basculement d'accent (qu'on peut noter -oà, -oàs mais que la norme préfère
ne pas noter). Selon la forme aboutie du -a
du féminin (/a/, /o/, /œ/, donc selon l'époque et la région, l'accent
s'est porté sur cette forme du -a
(GIPPM-1:339,343). J. Ronjat aurait dû mentionner
une interaction avec les analogies sur la diphtongaisons
de
ò.
caudăm > cōda > coa > coa (coà) "queue" (aussi réf.an. cò
/kwò/, /kwé/, /kò/)
dŭās > doas > doas (doàs) "deux fém" (aussi réf.an. dòs /dwòs/, /dwés/, /dòs/)
Région d'amuïssement de d, t intervocaliques (ci-dessus)
rūtă(m) > ruda > rua > rua > ruá /rüé/ "rue (plante)"
caprĕŏlŭ(m) > */kapréòlʋ/ > oc cabròu "chevreuil"
fīlĭŏlŭ(m) > */filyòlʋ/ > oc filhòu "filleul" (FDAOS).
dĕŭs > (avec ou sans diphtongaison romane ĕ > iè ?) esp. dios (FDAOS:109 note 8, qui donne simplement " 'de-us > 'di̯os" : "synérèse, qui aboutit à une nouvelle syllabe dont le sommet se trouve sur la voyelle la plus ouverte".)
mŭlĭĕrĕ(m) > */mʋlyéré/ > oc molhèr, molher "épouse"
Type *vieure > vieure ci-dessous.
Après le basculement d'accent, ao
évolue généralement en au [a
păvōrĕ(m)
> (amuïssement
de v) AO pa
*căvōnĕm > *căvōnăm > *caona > cauna
Cădŭrcī
> *[kadórtsi]
> (d > ∅ en n-oc) Caors
"Cahors" (
-ātōrĕm (t > ∅ en v-a) > -aor [aó] > [aó]
> [a
rēgīna(m) > */réina/
> (basculement d'accent) */réina/
> */ré
Pierre Fouché (PHF-f2:340) donne une liste d'exemples de mots où
l'accent de i a basculé vers a au Moyen Âge : "On avait
primitivement faïne < fagīna,
gaïne < vagīna, haïne < gallo-rom.
*hatīna (frc. *hatjan), maïstre < magĭstru, traïne <
tragīnat, traïtre < tradĭtor. Au début du XVIe
siècle il y avait déjà longtemps qu'on prononçait comme aujourd'hui faîne, gaîne, haîne, maître, traîne,
traître. Ici encore l'accent s'est reporté de i
sur a : d'où une diphtongue a
- dans
- dans maïstre et traïtre,
le
*fāgīnă(m) > */faina/ > AO faïna, OM faïna, faina, fèina, foina... "fouine" (aussi fr "faine, fruit du hêtre")
*tahīnat (gotique taheins) > AO taïna, tayna "il tarde ; il retarde" (FEW:17:291b)
*trāgīnăt > */traina/
> traïna, traina, trèina
"(il) traîne"
vāgīnă(m) > */vaina/ > AO gaïna, gazina, gayna > OM gaina, guèina "gaine"
Je parle ici des diphtongues issues de la diphtongaison
romane. Il faut étudier les autres diphtongaisons.
La bascule des diphtongues a lieu vers l'an 1200, voir bascule des diphtongues (diphtongaison romane).
/è/ > /iè̯/
> /ié̯/ > (bascule)
/i̯é/
exemple : lĕctŭm > liech
/ò/ > /ʋò̯/
> /ué̯/ > (bascule)
/u̯é/
exemple : nŏctĕm > nuech
Cas particulier (français) : ci-dessous eu > eau : */èa
Un phénomène particulier concerne l'occitan et le franco-provençal : le
déplacement
d'accent de nombreux proparoxytons en
Exemples :
ăsĭnă(m) > asena "ânesse"
pĭpŭlă(m) > pibola "peuplier"
mastĭcă(t)
> mastega "(il) mâche"
La quantité vocalique (voyelles longues et brèves) avait une origine
historique, étymologique ; elle était héritée
de l'indo-européen (ci-dessus). On parle de quantité
étymologique. Elle disparaît à partir du premier siècle de
notre ère. C'est la syllabe accentuée,
portant un accent d'intensité de plus en plus marqué, qui voit sa
voyelle s'allonger (si elle est
La mutation vocalique du premier siècle après J.-C. est marquée par le passage :
trait dominant = accent musical > trait dominant = accent tonique
Ce passage s'accompagne d'une évolution du système de quantité vocalique :
| la
quantité vocalique est d'origine étymologique |
> |
la
quantité vocalique suit la règle : voyelle voyelle |
Certains témoignages antiques montrent une perte des quantités vocaliques.
(d'après RDL:261-262)
(Saint Augustin De Doct. Christ. 4.10.24, à propos de ŏs "os" et ōs "oreille") :
Cur pietatis doctorem pigeat imperitis loquentem "ossum" potius quam "os" dicere, ne ista syllaba non ab eo, quod sunt "ossa", sed ab eo, quod sunt "ora", intellegatur, ubi Afrae aures de correptione vocalium vel productione non judicant.
(prop.tradu.) "Pourquoi un enseignant en piété devrait-il culpabiliser en parlant à des ignorants lorsqu'il emploie ossum plutôt que os, pour éviter que ce mot monosyllabe [ŏs "os"] soit compris comme le mot dont le pluriel est ora [c'est-à-dire ōs "bouche"], au lieu du mot dont le pluriel est ossa [c'est-à-dire ŏs "os"], vu que les oreilles de l'Africain ne font pas la distinction entre voyelle raccourcie et voyelle allongée ?"
Explication : les Africains incultes (impĕrītī) ne font pas la distinction entre ŏs et ōs car ils ne distinguent pas les quantités vocaliques ; donc afin d'éviter la confusion entre ces deux mots, on ne doit pas avoir de scrupule à employer ŏssŭm, bien que ce soit un mot incorrect car c'est une réfection sur ŏs ; mais il est ainsi bien distingué de ōs "la bouche".
Ci-dessous je dégage pour le
sud-occitan contemporain une perte quasi-généralisée des voyelles
longues. Il me semble que la quasi-absence des voyelles longues
en sud-occitan se répercute nettement sur le français prononcé avec l'accent
méridional : les voyelles sont à peu près toutes uniformément
brèves, alors que le français standard prononce encore des voyelles
longues ("jaune" [j
Convention : Je rappelle que dans le
langage phonétique du site, une voyelle soulignée signifie qu'elle est
Avertissement
: Pour l'occitan contemporain, je pense qu'on a une mauvaise
connaissance des
Ancien
béarnais : il faut noter qu'en ancien béarnais
(Pyrénées-Atlantiques), la
Au moins un autre
auteur béarnais a utilisé plus tard le même procédé : Jean-Henri
Fondeville (1633-1705) a par exemple écrit La
Pastourale deu paysaa, qui cèrque mestièè à son hil, chéns në trouba à
son grat [...] (1767). Le titre contient paysaa
(< paysan), mestièè (<
mestièr). Je pense qu'il y a eu une continuité de la
Deux causes peuvent engendrer une voyelle longue : l'accent tonique
porté sur une voyelle
Historiquement, les voyelles
Pour l'occitan contemporain, Jules Ronjat accorde à ces voyelles longues un rôle marginal pour l'ensemble du domaine d'oc, du moins en sud-occitan ("plus rarement longues"). Cependant il reconnaît un allongement ("de durée généralement moyenne") :
(GIPPM-1:90) (r.g.f.d.a.) "Pour autant qu'il est licite de
réduire à une formule générale un ensemble de faits assez compliqués, on
peut dire que dans la plupart de nos parlers la
(puis Jules Ronjat aborde le
Concernant le provençal contemporain, avec ma propre expérience, je
dirais que des voyelles longues peuvent exister en position
Voir aussi les cartes ALF 18 "aile" (ala),
41 "âne" (ase), 441 "école" (escòla), etc. : ces cartes montrent
un allongement fréquent de la consonne tonique libre dans tout le
domaine d'oc.
(GIPPM-1:90) (r.g.f.d.e.a.) "
[1] J. Ronjat utilise une analyse curieuse : lorque les linguistes
étudient les rimes, c'est dans le but de déceler la prononciation des
variétés disparues de la langue
; alors que dans ce cas, l'auteur traite de variétés contemporaines de
la langue ; là il veut dire que ces deux valeurs de [a] sont brèves en
dialecte provençal actuel.
En français, les voyelles nasales
Pour les linguistes, la position ouverte de la syllabe est unanimement
reconnue comme nécessaire pour avoir une voyelle longue. Pourtant dans ALF 111 "barbe" (barba),
les retranscripteurs ont donné un a
long dans une multitude d'endroits des domaines d'oc et d'oïl. Ce a long n'apparaît
quasiment pas dans les départements suivants : Hérault, Gard,
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Var,
Alpes-Maritimes. Je ne sais pas quel crédit accorder à la qualité de la
retranscription, mais il me semble en effet qu'en Vaucluse et dans les
Bouches-du-Rhône, cela correspond bien à la réalité : barba
possède un a tonique bref,
même en discours
Pour ALF 299 "clarté" (clartat),
à l'ouest du Rhône où
Voir ci-dessous Des voyelles longues atones ?.
L'allongement
compensatoire suite à la perte d'une consonne
En nord-occitan, le s préconsonantique a disparu, et dans
tout le domaine, certains s finaux ont disparu. Selon Jules
Ronjat, concernant le nord-occitan, cette disparition a causé
l'allongement de la voyelle
(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "Les parlers du
Remarque : en
- pour la deuxième personnes du présent dans les régions où il tombe,
dans ALF 1340 "tu me trouves", je n'ai pas trouvé
d'allongement de a dans -a < -as : [mé tr
- pour les féminins pluriel, dans les nombreuses régions où il tombe, ALF 302 "les cloches" ne montre jamais d'allongement compensatoire pour lei campanas, lei clòchas.
Dans les dialectes centraux ainsi qu'en dialecte béarnais, n
final est caduc (voir -n instable). L'allongement
compensatoire suite de la perte de -n
(ou n devant
GIPPM-2:288 : (r.g.f.d.a.) "La voyelle devenue finale par
amuïssement de
Jules Ronjat cite ensuite le nom de commune Morlaàs (64), dont la graphie exprime encore aujourd'hui
l'allongement compensatoire (< *Morlans
< Morlanis).
Je donne ci-dessous d'autres occurrences dans HistSainte, données dans CUCM:49, (que j'ai éclaircies avec le texte dans HistSainteLR, et j'en ai rajouté) :
auguus (auguns) "quelques uns"
baroos "hommes" < *barōnēs
bee "bien" < bĕnĕ
besii "voisin" < *vecīnŭm
bii, vii "vin" < vīnŭm
boo, bon "bon" < bŏnŭm, boos < bŏnōs (mais bona, bone < bŏnăm)
caperaas (capelans) "prêtres"
doos "dons < *dōnōs (dōna)
fii "fin" < fīnĕm
gees (particule qui accompagne la négation, voir gens, ges, gis) < genus
generatioo "generation" < gĕnĕrātĭōnĕm (emprunt)
layroo "larron" < lātrōnĕm
maa "main", maas "mains" < mănŭm, mănūs (pl.)
maysoo/mayzoo "maison" < mansĭōnĕm
maytii "matin" < mātūtīnŭm
paa "pain" < pānĕm
plaa "bien" < plānē
plaa, plaas "plaine, plaines" < plānŭm, plānōs
plee "plein" < plēnŭm (mais plena < plēnăm)
razoo "raison" < rătĭōnĕm
ree "rien" < rĕm
vee "vient" < vĕnĭt
Mais : Benyamin, mesquin, camin (ou surtout cami), peregri (CUCM:195).
Ce type d'allongement compensatoire est noté en ancien
béarnais (voir ci-dessus ancien béarnais).
Je donne ci-dessous des occurrences tirées HistSainte, relevées dans CUCM:49, (que j'ai éclaircies avec le texte
dans HistSainteLR) :
amoo "amitié (amour)" < ămōrĕm
coos "corps" < cŏrpŭs (acc.)
interpretatoos "interprète" < interprĕtātōrĕm (emprunt)
mayoo "aîné" < mājōrĕm
mesadgees "messagers"
oos "ours" < ŭrsŭm
Voir ci-dessus Jules Ronjat :
(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "[...] de même en général pour
les résultats de contractions, exemple prag. [b
Certaines références donnent des voyelles longues en position atone.
Voir ci-dessus Jules Ronjat :
(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "[...] de même en général pour
les résultats de contractions, exemple prag. [b
Du Ier au Ve siècle après J.-C., le système latin
se transforme :
- pour les
- pour les
Cette évolution mène vers un système à sept voyelles toniques et cinq
voyelles atones, selon les deux tableaux ci-dessous. Ce système
vocalique est celui de la
|
LPC
|
|
LPT1
|
| ī |
> |
/i/ |
| ĭ, ē | > |
/é/ |
| ĕ | > |
/è/ |
| ā, ă | > |
/a/ |
| ŏ | > |
/ò/ |
| ō, ŭ | > |
/ó/ |
| ū | > |
/ʋ/ |
Tableau ci-dessus. Mutation du système
vocalique des voyelles toniques dans une grande partie de la
Concernant la perpétuation des voyelles atones jusqu'à l'occitan, cette partie est surtout personnelle ; elle a été construite essentiellement en 2022.
Par rapport à l'évolution des
ĕ
/è?/(1)
ŏ /ò?/(1)
j'appelle cette évolution la règle de la
fermeture des
Cette évolution phonétique peut être incluse dans les apophonies au sens large.
(1) ↑ Peut-être les étapes /è/ et /ò/ n'ont-elles pas existé, c'est-à-dire que ĕ et ŏ latins ne se sont jamais ouverts en position atone ; à mieux étudier.
Ainsi on peut représenter la mutation des voyelles atones dans le tableau suivant :
|
LPC
|
|
LPT1
|
| ī |
> |
/i/ |
| ĭ, ē, ĕ | > |
/é/ |
| ā, ă | > |
/a/ |
| ŏ, ō, ŭ | > |
/ó/ |
| ū | > |
/ʋ/ |
Tableau ci-dessus. Mutation du système
vocalique des voyelles atones dans la
Quelques jalons sont donnés ci-dessous au 2.
(La fermeture ĕ > /é/ et ŏ > /ó/ pour les voyelles
Je pense qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que la règle de
fermeture de [è] et [ò]
Par contre en français actuel, elle ne s'applique plus (références?).
En occitan :
La fermeture des voyelles
Par exemple : portar [p
- La voyelle fermée [
- La très bonne conservation de cette règle latine permet l'emploi de l'accent (grave) seulement pour les voyelles toniques : vènon [vènʋ̃] "ils viennent", venir [véni], bòn [bò̃], bontat [bʋ̃ta] "bonté".
- Il existe
quelques exceptions à la règle : cercar
"chercher", mercat "marché", gelar "geler" subissent l'influence
ouvrante de r ou l
et peuvent être prononcés selon les régions avec [è] et même [a] (pour
aboutir à marcat, sarcar, jalar).
Concernant [é], il est fréquent dans [géla],
mais devant un r implosif, [é]
ne semble jamais réalisé : [mérka],
[sérka] n'existent pas
(pour cercar : ALF:22 "aller chercher" e.e.p., pour mercat
: ALF:812 "marché" e.e.p.), on n'a que les types [mèrka]/[marka] et [sèrka].
Pour o, par exemple ortiga
[
- Notamment en Provence,
les diphtongues atones sont affectées par une loi phonétique
pouvant s'apparenter à la fermeture des atones, voir ci-dessous diphtongues
atones. Il s'agit davantage d'assimilation du premier élément
de diphtongue au second. Par exemple [aw] > [ów] dans caucida
: [kówsido/a] voire [k
Parmi les évolutions de diphtongues atones, l'évolution [éw] > [ów] n'est pas donnée dans l'œuvre de Jules Ronjat, qui explique la prononciation de leugier [lówdjié] par une dissimilation é-é > a-é, donc menant à laugier, prononcé en général [lówdjié] en Provence :
(GIPPM-1:323) : "Cet e a dissimilé un e précédent dans prov. lóugié < *laugier < *leviâriu" [...]"
Même si cette différenciation é-é > a-é a
pu exister dans leugier (voir ALF "léger", prononcé [lawdjyé] dans le
Gard [1]), elle n'a pas pu se produire pour teulissa
"toit", cieutat "cité", eusilha "chêne kermès", peutirar
"tirer par les cheveux", mots qui ne contiennent pas é-é, et
généralement prononcés avec [ów] ou [
[1] ↑ : Il est
ausi possible que l'évolution gardoise leugier > laugier
[lawdjyé] suive une règle d'analogie de eu sur au
en position prétonique (à étudier). Voir aussi diphtongue
grecque eu.
- Cette règle se prolonge partiellement dans l'accent méridional : "bonnet", "chocolat", "téléphoner", "noter" sont réalisés nettement avec [ó] en position atone ; "fêter", "souhaiter"... sont réalisés nettement avec [é] en position atone.
En français :
Certes le lexique français conserve la trace de l'ancienne alternance
vocalique du latin tardif : "venir, nous venons / je viens", "tenir,
nous tenons / je tiens", "asseoir / je m'assieds". Mais la notion
d'alternance vocalique est perdue dans ces
Pour d'autres
La grammaire de l'occitan décrit une alternance vocalique pour les conjugaisons ; cette alternance suit rigoureusement la fermeture des atones décrite juste ci-dessus. Voir dans la partie grammaire : Alternance vocalique pour les conjugaisons : assetar / assèta.
L'alternance vocalique est
l'alternance des timbres ouverts ou fermés de e
et o selon que ces voyelles
sont en position
Compléments de définition :
- Il y a aussi l'alternance
ue/u (vujar
[v
- Dans de nombreuses régions comme la Provence, l'alternance vocalique s'est étendue aux diphtongues (voir Prononciation des diphtongues atones). Par exemple : se taisar [sé téyza] "se taire" / taisa-te [tayzo/a té]. Fréquemment, des nivellements analogiques se sont produits : [tèyzo/a té] ; l'alternance peut prendre alors la forme [éy/èy]. Une évolution de même type est notée pour nàisser/naissèm : [naysé] ou [nèysé] / [néysè̃].
L'expression "alternance vocalique" est souvent employée pour l'alternance dans les conjugaisons ; elle concerne aussi les dérivations.
- Conjugaisons (exemples) :
costar
[k
portar
[p
rotar
[r
telefonar
[téléf
assetar
[aséta] / s'assèta
"il s'assoit"
restar [résta]
ou [rèsta] / rèsta
"il reste"
Deuxième conjugaison :
morir
[m
tenir [téni]
/ tèn "il tient"
venir [véni]
/ vèn "il vient"
Troisième conjugaison :
conèisser [kʋnèysé]
/coneissèm [kʋnéysè̃]
"nous connaissons"
nàisser [naysé]
/ naissem [néysè̃]
"nous naissons"
rèndre
[rè̃dré] / rendèm
[ré̃dè̃] "nous rendons"
voler [v
- Dérivations (exemples) :
bèn "bien" / benet [béné] "petit bien ; truite de belle taille"
bèu
[bèw] "beau" / beutat [béwta], [bówta] "beauté"
bòn "bon" / bontat
[bʋ̃ta]
"bonté"
pè "pied" / AO pezada
> (disparition
de z) OA piada
(peada, peiada, pea...) "empreinte de patte, de pied"
pòrc
"porc" / porcieu [p
Ròse "Rhône" / rosau
[r
- Je rappelle que ce phénomène s'inscrit dans le prolongement du latin tardif, où les voyelles étaient toutes fermées en position atone.
- Par contre, le système français
échappe à ce phénomène : en français standard, on dit "porter"
[ò], "roter" [ò], "téléfoner" [ò] (CNRTL).
Il faut noter que l'accent
méridional dit bien "porter" [ò] (action ouvrante de r,
souvent [p
Pour le français, l'alternance vocalique semble marginale : "mener",
"jeter", "lever", "peler", "appeler", "acheter"... montrent une
alternance vocalique
Mais ce n'est pas un reste de l'ancienne règle latine de la fermeture des atones ci-dessus ; en effet en français d'autres influences exercent leur action :
- l'influence
analogique du mot simple : frais [frè] => fraîcheur [frè
- l'harmonisation vocalique (ci-dessous) : cette transformation peut prendre la forme d'une alternance vocalique, par exemple "fêter" peut être prononcé [fété] par harmonisation vocalique.
Voir aussi CNRTL : "pêcher" (verbe ou nom), "quêter" sont prononcés avec [è] ou [é], coter [ò] / je cote [ò], téléphoner [ò] / je téléphone [ò].
La véritable règle latine de la fermeture des atones demeure en français dans les formes comme "venir" / "je viens"
Il y a ouverture de ĕ
et ŏ latins
Attestations antiques : voir Servius ou Sergius (in de Poerck, 1953, in Probert, 2019)
ĕ > /è/
ŏ > /ò/
ĭ >
/
ŭ
> /
ē > /é/
ō > /ó/
ī
> /i/
ū
> /
ă, ā > /a/
Ci-dessus : Évolution du timbre des
voyelles toniques au premier siècle après J.-C. dans le centre de
l'Italie, qui va s'étendre à
la
(synthèse à partir de IPHAF:176, RLHI:9)
L'ouverture de ĭ
/
(IPHAF:181)
ĭ
L'ouverture de ŭ
/
Voir ci-dessous le devenir de ŭ tonique.
Il y a ouverture de ŭ en
position
ŭ
Voir ci-dessous le devenir
de ŭ prétonique.
Il y a ouverture de ŭ en
position finale (date pour le domaine d'oïl : IPHAF:190)
ŭ
Voir ci-dessous le devenir de ŭ final.
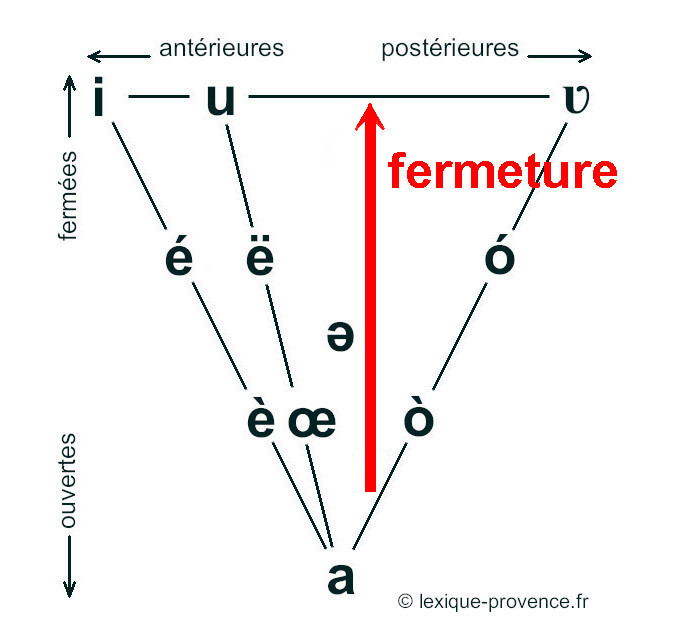
Direction de la fermeture d'une voyelle dans le triangle vocalique (voir triangle vocalique à "Transcription phonétique").
Voir fermeture du timbre devant nh, lh (premières palatalisations)
Voir ci-dessous è devant nasale implosive, ò devant nasale implosive.
Voir GIPPM-1:117 : "Presque tous nos parlers ferment [
Voir ci-dessous : type ment, type mont, type mengar "manger".
Max Pfister signale cette évolution (BAG:316-317, repris depuis ÉGPACL) : "fermeture de e prétonique en i en contexte palatal". Ainsi en position prétonique, avant ou après palatale, on n'obtient pas e attendu mais i. L'auteur donne six exemples, mais on peut en trouver beaucoup d'autres.
Legir > ligir (elegir > eligir)
Regir > rigir (TDF : Var)
Voici une série de mots dont le i prétonique semble s'expliquer aisément par une fermeture de e après palatale (anciens [͜ts] et [͜dj]). Les linguistes les plus réputés (Pierre Fouché, Walter von Wartburg, Jules Ronjat...) ont cherché d'autres explications, au cas par cas. Cette évolution semble toucher particulièrement le domaine occitan, avec des mots qui sont parfois passés au français.
Cependant Gerhard Rohlfs (AStNSpr. 177 [1940]) repris par Max Pfister (BAG:316...) développe l'idée de la transformation e > i au contact d'une palatale, en occitan.
Voici la position de Jules Ronjat, qui évoque des francismes pour cisèu,
ciment, des traitements savants de i dans civada,
cigala... mais bien une évolution populaire e > i dans
penchinar "peigner" :
(GIPPM-1:295, § 169 fin) "Ciment
(lim. ce-), cisèu ∼ -èl ∼ -è ∼ -é
doivent être fr. ciment,
ciseau empruntés, puisqu'on a p. ex. cementèri, etc...
(v. § 425 2°) "cimetière". Le mot voyageur cĭbāta > civado,
etc... (v. § 268) n'offre pas un traitement populaire de la prétonique,
et cigalo < cĭcāla suppose une influence savante ou un
croisement (cf. § 231).
Mais la fermeture de -e- par -ch- est indigène dans prov. penchina "peigner" (l. plutôt -ena).
Pour dina "dîner" v. § 175 in fine ;
dialectal -iol- < -ial-< -el- §165."
J'étudie ci-dessous les mots concernés un à un.
caemĕntŭ(m) > oc ciment (GirRouss), fr
"ciment". Pierre Fouché classe "ciment" dans un petit groupe de
mots montrant, selon lui, des dissimilations
e-e > i-e : caemĕntŭ > *cementu > ciment (PHF-f2:455).
Ce point de vue est repris dans CNRTL
"ciment", PH-2020:332,
§281.4 (voir aussi CNRTL
"cément",
cĭbātă(m) > oc civada "avoine". W. von Wartburg (FEW 2:660b-661a) estime qu'il y a eu traitement en partie savant, pour expliquer le i occitan (alors qu'on attendait e) ; il n'a pas repéré l'influence fermante de la palatale c/g en prétonique. Cette position de W. von Wartburg était déjà invalidée par Gerhard Rohlfs (AStNSpr. 177 [1940], p. 63) in BAG:316-317.
cĭcādăm > oc cigala (avec changement de
suffixe). Le français "cigale" est un
cĭcōnĭă(m) > AO cegọnha, cigọnha, oc cigonha, cigònha... Il existe
des formes héritées en a.fr.
: soigne (XIIIe s.), a.bourg. cyoingne, etc. (FEW 2:666b). La forme "cigogne" est un
(trad.all.)
"En occitan, ciconia évolua en cegonha (en l'occurrence
seulement attesté avec la signification "perche à bascule pour puiser
l'eau d'un puits". Cette forme a diffusé vers le nord de la France, et
la forme latine a affecté la forme indigène au sud comme au nord. Ainsi
s'expliquent le
Il est sans doute plus cohérent de considérer les formes oc cigonha, cigònha comme régulières, avec fermeture de e (< ĭ) en i après palatale, et les formes m.fr. et plus tardives cicogne (y compris dans La Fontaine), comme des latinismes.
cĭcūtă(m) > oc ciguda "ciguë". Les formes a.fr. de type cëue, dial. siü, seû sont régulières en français (FEW 2:668a). W. von Wartburg considère les formes de type a.fr. cegue (XIIe siècle), fr "ciguë" (depuis 1611) comme des adaptations des anciennes formes françaises au latin ("seit afr. zeit dem lt. wort wieder teilweise angenähert"). En occitan, ciguda est régulière, ainsi que sa forme n.oc. cigua. Il est plus logique de considérer cegue, ciguë comme des emprunts anciens à l'occitan, la forme avec i étant issue de la fermeture de e (< ĭ) après palatale. Les formes de type cicue sont des latinismes, comme ci-dessus cicogne pour "cigogne".
Gĕmĕrĕ
→ *gĕmĭcŭlārĕ > gingolar
"geindre". FEW 4:93a donne simplement gingolar à
Genesta(m) > ginesta
Genniacu(m) > Ginhac (aussi fermeture devant nh)
Genuculu(m) > ginolh
Gibbosu(m) > gĭbbă(m) > giba (malgré la position de J. Ronjat qui
postule un latin gībbă, GIPPM-1:140).
Gingiva > gengiva > pr.ma. gingiva
Januarius > jenuarius > ginovier "janvier"
Juniperus > (gloses) ziniperus, giniperus > (différenciation i-i) *jeniperus > ginèbre "genièvre" (CNRTL "genièvre")
jectare > jetar > jitar "jeter"
lēgĭtĭmŭm > legisme, voir discussion à "évolution des proparoxytons" T-M (2. t'm > sm).
Voir néo-apophonies (dans le chapitre Apophonies).
Par exemple il y a fermeture a >
u dans : ămygdălă
> amiddula
(Prob)
"amande" (voir ămĭddŭlă).
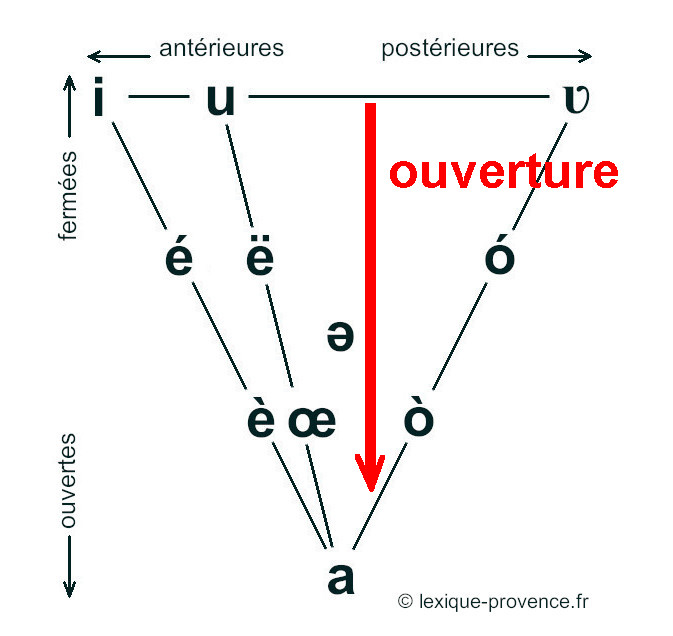
Direction de l'ouverture d'une voyelle dans le triangle vocalique (voir triangle vocalique à "Transcription phonétique").
Voir ci-dessus : allongement de certaines voyelles longues (le phénomène n'est pas clair).
(en chantier)
Voir influence ouvrante de r et l à "Transcription phonétique".
Je groupe ci-dessous un ensemble de faits que je me propose de mieux
étudier, qu'on peut constater en français ou en occitan. Dans les
langues voisines (catalan, espagnol, italien...), ce fait n'apparaît pas
(à vérifier complètement). Selon les auteurs ces faits sont envisagés
différemment. Il s'agit d'une ouverture de é en a, mais
aussi de é en è, ou de
Voyelles prétonique (type marcat)
Pour le français, Édouard et Jean Bourciez donnent :
(PFÉH:108, § 94) "Dans la syllabe initiale, un
En prétonique devant r et l, on observe une tendance à l'évolution e > a : mercātum > marcat "marché". Le provençal connaît marcat ou mercat, selon les régions. Cette tendance est marquée en syllabe fermée, mais on l'observe aussi en syllabe ouverte (gelar > jalar "geler") ; elle est décrite devant r et l, mais ci-dessous CDVSF semble la donner devant n'importe quelle consonne (tripaliu > travail).
Voir CDVSF:125 : les auteurs signalent que l'évolution de type "mercātu > marché" circonvient à la règle de conservation du timbre des voyelles en syllabe fermée (en initiale atone, prétonique atone, tonique). Ils signalent que "cette évolution particulière n’est pas constante : servīre > servir, virtūte > vertu, etc." (ils faut remarquer qu'en occitan, le TDF donne bien pr.ma. " sarvi, vartu"). De plus, cette évolution "se rencontre certes en syllabe initiale fermée mais tout aussi bien en syllabe ouverte : *hirunda > aronde, pelōrida > palourde, tripaliu > travail."
(GIPPM-1:295, § 169 fin) "L'ouverture jusqu'à a devant rr et r + consonne (cf. § 66, in fine) est très généralement répandue en forc. alp. vel. gév. auv. march. aur., ex. vaud. du XVe s. arror < errōre, argolh,-Ihos « orgueil,-lleux ») < erg- < org-, vaud. mod. arvengu « revenu < erv- < rev-, etc... (v. § 447), forc. tarrible, libarta "terrible, liberté" ; ces a sont devenus dialectalement o comme les a anciens, ex. aur. torrible et les proclitiques stir. vors "vers", por "par, pour". Pour les cas spéciaux de sarcello et sarra v. §§ 176 et 179 ad finem."
Je rajoute :
zēlōsŭ(m) > gelós / jalós, "jaloux" (CNRTL à "balance"). Le mot français pourrait être d'origine occitane (CNRTL "jaloux").
Voyelles toniques (type verd, estela?)
(GIPPM-1:119, § 66 fin, avec références à NPGA:88-90) Jules Ronjat explique l'effet ouvrant de r et l, et distingue deux types de r (je n'ouvre pas les guillemets car je clarifie la présentation de l'auteur, mais c'est presque une citation) :
- Pour articuler r
- Pour articuler r
(GIPPM-1:135-136) (r.g.d.a.g.c.c.g.) "Le provençal conserve bien [é] en syllabe ouverte [...]. En syllabe fermée [é] reste devant s et s + consonne : mē(n)se et missu > mes, spissu > espés, crista > cresta, arista > aresta, ēsca > esca, piscat > pesca. Mais il y a ouverture :
(α) devant r
ou l
[...]
[l'auteur étudie ensuite l'ouverture :
(β) de é devant -u : nèu < nive ;
(γ) de é devant i implosif : lèi < lēge : ci-dessous éi > èi ;
(δ) parfois de é devant nasale implosive : rèm "rame" < rēmu]"
(GIPPM-1:295).
Voir jŭvĕnĕm > jŏvĕnĕm est lié à w > β.
Voir la définition de labialisation.
Hugo Schuchardt mettait déjà en évidence une labialisation très
fréquente dans les langues romanes (DVDV2:238 et suiv., archive.org, DVDV3:242 en bas "Der Einfluss der Labialen
auf vorausgehende helle Vokale..." (trad.all.) "L'influence des
Jules Ronjat (GIPPM-1:139, GIPPM-2:211) donne un processus d'évolution /é/
> /
Par exemple (GIPPM-2:211) : " u labialisation de e ou de i " :
enfle
"enflé" se dit ufle
(Foix, lim. ag. et souvent brianç.. queir. vel. gév. rrgt.), big. pur.
souvent uhle
; AO
uflar ;
enfant
"enfant" se dit ufant
(Paulhaguet) ;
enfèrn
"enfer" se dit unfèrn
(alp. dial.), aussi : ufèrn
(lang. in TDF et AO)
(GIPPM-1:294) : (à propos de é roman prétonique) "L'entourage labial produit ici des effets analogues à ceux qui ont été notés pour la tonique (§ 82), ex. prag. fumèle, buvènt < fēmella, bibente, rhod. pop. méd. cabudèu, fumello < capitellu, fēmella [...]".
Jules Ronjat (GIPPM-1:313 en bas) donne pour prīmārĭŭs > "premier" : promier < labialisation de premier, prumier < labialisation de primier. Cette assertion est peu convaincante puisque ci-dessous, de nombreux /é/ evoluent en /u/.
Et premier pourrait provenir d'une dissimilation i-y > e-i comme pour vicinu > vecinu (i-i > e-i).
Pierre Guiraud (DEO:12) écrit : "Certaines règles doivent être
entièrement reconsidérées. Ainsi l'inventaire de tous les cas attestés
de l'évolution de
affibulare > "affubler" "l'i s'étant labialisé en u entre les 2 labiales f, b" (CNRTL "affubler"), AO afiblar / afublar, voir ci-dessous fībĕlla.
aperire > *operire > obrir, ubrir, "ouvrir"
beve, beviá > buve, buviá (TDF), et français "buvais" (< beuvais : CNRTL)
b.lat. calamellus > fr "chalumeau"
cannapem > canebe > canube "chanvre"
cebenchon > subenchon "furoncle"
cime > sumia "punaise"
cooperire > cobrir > cubrir > curbir "couvrir"
cremascle > crumascle "crémaillère" ;
cribellum > crivèu, cruvèu "crible"
dē mānĕ > deman / (l) (g) (bord) doman, it domani ;
demandare > demandar, AO domandar, it domandare ;
ebrium > ebre, ubri "ivre"
episcopum > obispo
excŏmmŭnĭcāre > AO escumergar ;
femina > fuma, fruma "femme"
fībĕlla (forme de fībŭla) > AO fivèla / fuvèla (voir ci-dessus affibulare > "affubler")
fĭmŭm > fĕmŭm (IVe s.) (> a.fr. fiens "fumier") → fr "fumer", "fumier" ("-e- > -ü- prob. par attraction des 2 consonnes labiales environnantes, v. Fouché, p. 451, 5°a", CNRTL "fumer2")
fromental > frumental
gemellos > jumeaux
grepia > grupia (< krepja)
hībernum > AO ivęrn, uvęrn
intaminare > entamenar / d entomenar ;
līmacem (m. ou f.) > limaça, viv. lumaça
lupia > lupia (et non lopia, peut-être influence savante mais voir grupia < krepja ci-dessus) (< lopp- ou francique, voir rhénan luppe "morceau")
ofrir > AO ufrir "offrir"
ŏpācŭm > ubac
prīmarius > primier, premier, prumier, permier... "premier"
ribeiròu > rubeiròu
riban > ruban (fr. ruban < ringband)
rīmārī "fissurer"> rimar "brûler sans flammes, se consummer", lang rumar, gasc arrumar, tosc rumare "remuer (un liquide)"
ruminare > ruminare > romiar, alp rumiar, Var ruminar (évolution probable)
Simiana > Sumiana "Simiane"
*Siminanus > patron. Sumian, Sumien
semenar > (bord) somar, somiar (et influence contraire > samenar, comme crebar > crabar, cremar > cramar)
sepia > supia "seiche" (et supilhon)
siblar > sublar "siffler"
*sŭbmŏnērĕ > somọndre, semọndre > pr.ma. sumondre "proposer" (ci-dessous ò > ó).
vindēmĭăm > vendemia / vendumia "vendange"
Italien : somigliar, domani, domandare, dovere, rovesciare
(lat.vulg.) līmāca > it lumaca "escargot" (FEW 5:343a note 19 : i > u non pas sous l'influence de lumen, l'escargot fuyant la lumière, mais simplement sous l'influence du m subséquent).
Il y a aussi :
Dans les
On peut d'abord distinguer deux tendances opposées : α. Augmentation de
la différence entre les deux timbres, et β. Diminution de la différence
entre les deux timbres.
L'augmentation de la différence entre les deux timbres témoigne a priori, dans la psychologie des locuteurs, de la volonté de maintenir la présence des deux timbres contigus, voir par exemple éi̯ > ói̯ ci-dessous.
Pour la notion d'aperture, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique".
Voir aussi "transformations phonétiques" : différenciation d'aperture.
Dans ce paragraphe, les nombreux exemples concernent deux timbres
vocaliques en contact, éloignés sur le plan de l'aperture. Les auteurs
semblent réserver la notion de différenciation
d'aperture à des phénomènes conduisant plus ou moins
volontairement les locuteurs à différencier deux timbres contigus
semblables, pour éviter la disparition
de l'un des deux. J'appelle cette situation différenciation
d'aperture au sens strict. Je traite ci-dessous de la
différenciation d'aperture au sens large (les deux timbres ne sont pas
forcément semblables). Cela peut mener à la consonification d'une
voyelle : AO
beaça
> AO biaça
> biaça /byaso/
(
Les exemples ci-dessous montrent une fermeture du timbre le plus fermé dans un contact entre deux voyelles ; ils illustrent la tendance à augmenter la différence entre les deux timbres, avec pour effet la conservation de ces deux timbres.
En général, il s'agit du timbre non accentué, par exemple AO beaça > AO biaça.
Mais pour certains cas, la fermeture du timbre le plus fermé semble affecter la voyelle accentuée :
- type hăbē(b)ās > AO avias "tu avais" ;
- le type magistrem > maestre > maïstre "maître" ;
- type pa(v)ore > AO pagur, paür "peur".
Souvent s'il y a hiatus au départ, le groupe vocalique évolue en
diphtongue (
- lat -ĕă > *-ĭă (puis ĭ > y : voir yodisations) (Prob : vinea non vinia, cavea non cavia, etc.)
- gaul bedale > oc besal, besau > (ébranlement de /z/) oc beau > biau "bief"
- *Benarnum (peuple des Benarni) > (n-n > ∅-n) Bearn > Biarn ("Béarn", région des Pyrénées-Atlantiques).
- lat bĭsaccĭŭm > *bĭsaccĭăm > *besatsa > (ébranlement de /z/) AO beaça > AO biaça > biaça "besace contenant le casse-croûte ; casse-croûte".
- lat crĕārĕ > oc criar "créer"
- lat ĕt a...
(en position
La forme i "et" peut compter comme syllabe à part entière :
(vers à 13 syllabes) Que plus que .xv. melia n'issiren pels porteus / Bon i adreit per armas e ben correns e beus (a.v. leus) CroisAlb-1228 = Il en sort par les portes plus de quinze mille / Braves, experts en armes, beaux (a.v. rapides) et bien courants (HCHA:319).
Ou bien cette forme i "et" peut compter comme élément faible de diphtongue, associé à a suivant :
(vers octosyllabes) So diss en G[uilhem] de la Barra / A sos cavaliers y a sa gent. / "Be sabetz tug cominalment / Que per lialtat e per amor / M'apelec lo rey mosenhor (...)" GuilhBarra = (prop.tradu.) Ainsi dit le seigneur Guillaume de la Barre / À ses chevaliers et à sa troupe. / "Vous savez parfaitement / Que par loyauté et par amour / Le roi m'appela Monseigneur (?) (...)"
- type cante > canti "je chante".
- lēgālĕm > leal > var AO lial "loyal", lealtat > var AO lialtat "loyauté"
- lat pĕdis + -ata > AO pezada > (ébranlement de /z/) *peada > piada "empreinte de pied"
- lat
pĕdōnem
> (ébranlement
de /z/) a.fr.
peon "fantassin" >
"pion" (voir AO pez
- rēgālĕm > real > var AO rial "loyal"
- gr τήγανον (tēganon) > *teane > *tiane (avec basculement d'accent sur a à une certaine étape) > oc tian "plat en terre cuite"
- lat
vĭăm
> *vea
> oc via
(
- lat thĕātrŭm > (pr.ma., pr.rh.) tiatre [tyatré], voir aussi auv teiatre.
Dans l'hypothèse (privilégiée) où la terminaison de l'imparfait latin
en
lat hăbēbās > (dissimilation
b-b) *habeas
> *habias (
Voir la suite ci-dessus : basculement d'accent >... aviás "(tu) avais".
Voir ci-dessous eo > io.
āĕrĕ(m) > oc aire "air"
ăsĭnŭm > ase > (perte de /z/) *ae > ai "âne"
(vae "hélas ; malheur à" > it guai n'entrerait pas dans ce cadre, à mieux étudier)
măgĭstrĕ(m) > AO maestre > ? maestre > maistre "maître". À mieux étudier. On a AO et a.fr. maïstre (avec accent tonique sur ï ? alors pourquoi i et non é ?, je ne trouve pas l'explication ni dans Fouché, ni dans FEW). Si l'accent tonique était déjà sur a, le i s'explique logiquement par la différenciation ae > ai. Si l'accent tonique était encore sur le i, il pourrait quand même y avoir une différenciation ae > ai, mais plus difficilement (introduction ci-dessus).
Fouché PHF-f2:340 range maïstre
avec faïne, gaïne, vaïne, haïne,
traïne, traïtre, comme exemples médiévaux de basculement
d'accent de i vers a.
Dans cette liste, seuls maïstre
et traïtre ne proviennent pas
d'un latin avec ī, mais d'un
latin avec ĭ.
Pour le français : -ācŭm > *-/aé̯ó/
> *-/a
cŏāgŭlăt > */kwa
vādō >
Le groupe ao peut provenir
de ao,
qui fournit davantage d'exemples (ci-dessus ao > ao).
Selon les mots et les régions, [a
Voir aussi le problème de la datation g > ∅ / -ŭ > -ó.
păvōrĕm > *păōrĕ > *păūrĕ > AO paür, pagur "peur". Dans ce scénario, c'est le timbre accentué qui est affecté (cela semble bien s'être réalisé dans certains cas, voir ci-dessus l'introduction).
Ce type est proche du type italien pa(v)ore > it paura.
Pour ce dernier, les linguistes invoquent généralement la réfection avec
le suffixe
Pour la variante courante en occitan actuel paur "peur", on peut invoquer :
- le même phénomène de différenciation o > u plus tard, après basculement d'accent ao > ao (ci-dessus) ;
- ou bien la conservation d'un
ĕgō
>
lĕo > AO l
pæŏnĭă
> (
mĕdŭllă(m) "moelle" > *medolla > (nord-occitan, franco-prov, franç. : d > 0) > *meola [méola], puis :
- dans les régions sans transformation [
- dans les régions à transformation [
- l'hiatus peut être conservé : *[méola]
> meola [mé
- en nord-Aveyron, et en d'autres points : [meola] > *[myóla] > [myʋlo].
- en plusieurs points dans le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Creuse : même résultat qu'en fr.pr. ci-dessus : la miola [myólo] ou miòla [myòlo]. L'évolution [éó] > [yo] pourrait s'être réalisée avant l'évolution [ó] > [ʋ], et [yo] aurait résisté à l'évolution vers [yʋ] ?
- Lot, Dordogne... : l'accent tonique n'est pas clair dans ALF:862 : [méʋlo] ou [méwlo] :
- en domaine d'oïl : l'hiatus a été résolu par une métathèse : meole > moele (moelle, dont la prononciation a dû suivre wé > wa, voir type "toile") ; la métathèse rappelle tiule > "tuile".
pæŏnĭă
> (
prŏfŭndŭ(m) > *prĕfŭndŭ(m)
>... (amuïssement de f)...
AO
pre
Sedūnŭ(m) > Siun (Sion, ville du Valais suisse, voir ci-dessous Sion)
eau > iau (en domaine d'oïl) :
Il est difficile de savoir si eau
s'est transformé (populairement) au stade [i̯a
ăquă(m) > */èó/ > iau /yó/ "eau" (variante très répandue des régions du domaine d'oïl), voir ăquăm.
bĕllŭ(m) > */bèó/ > biau /byó/ "beau" (variante très répandue des régions du domaine d'oïl).
Cette tendance naturelle
à fermer e en i
a dû être contrecarrée par la norme sociale en Île-de-France : (HSPGF:9) "l’apparition d’une différentiation
sociale entre les deux variantes [i̯a
En position tonique :
lĕgūmĭnĕ(m) > *leume > OA liume, lium, toulousain lium (FEW 5:246a) (voir leguminem à g interovalique)
Sedūnŭ(m) > *Seunu > Siun ("Sion", ville du Valais suisse, évolution ū > ó à expliquer ; Siun est attesté dans les anciens textes : RNPCG II,3:836)
En position post-tonique :
Prob :
calceus non calcius, linteum non lintium, etc.
voir yodisations.
pŭtĕŭm
>
etc.
(voir yodisations).
Ce type d'évolution n'est pas certain dans *joene > joine "jeune" (possibilité óʋ̯ > ói̯ ci-dessous), et dans dēstrŭĕre > destruire "détruire" (voir étymologie de destruire). En effet pour ces cas, d'autres évolutions sont possibles.
Dans le cas ci-dessous, [éi] évolue en [èi] : deux timbres semblables (é et i) s'éloignent : on est dans le cas de la différenciation d'aperture au sens strict (ci-dessus).
crēdĕrĕ
> *crédre > creire >
(ouverture de é)
crèire "croire"
(GIPPM-1:122, à propos du dialecte de Pragelas. : "[...] par différenciation le
continuateur de
Rodumna (Ptolémée, vers 150)
> Rodona (Xe
siècle) > *Róóna
> (effet
ouvrant de la nasalisation) */róõna/ > (ouverture
plus forte par différenciation) */ró
Certaines évolutions phonétiques s'expliquent par une différenciation
du point d'articulation, voir triangle
vocalique. Les exemples ci-dessous concernent des diphtongues
évoluant en d'autres diphtongues. C'est toujours l'élément faible de
diphtongue qui est changé.
Voir aussi "transformations phonétiques" : différenciation
de point d'articulation.
La diphtongue
Cette évolution affecte notamment les descendants de la diphtongaison romane : fuòc > fiòc ; buòu > biòu. Voir Effet de l'antériorisation du /ʋ/ sur la diphtongue /ʋò/ (< /ò/).
Pour le français, pour le type tēlam > toile, l'étape /téi̯la/ > /tói̯l
Il faut remarquer que des conditions similaires, le provençal a choisi la voie éi > èi (ci-dessus). L'évolution française éi̯ > ói̯ contient (? phrase à finir).
Remarque : L'évolution probable óʋ̯
> ói̯, réalisée en occitan, rappelle ci-dessous móuser, soupre où dans ce cas
ów se maintient (bien plus tardivement), mais est menacé d'évoluer vers
Concernant les vocalisations de consonnes ci-dessous (p, b, v),
il est logique de penser que s'agissant de consonnes
Dans les exemples ci-dessous, seul Κύπρος > *cŭbrŭm > coire "cuivre" semble n'avoir que cette voie possible ; en effet les autres exemples peuvent aussi provenir d'une évolution latine précoce, comme jŭvĕnĕm > jŭĕnĕm > joine. Et encore, l'évolution phonétique menant à coire "cuivre" n'est pas claire (forme de l'étymon mal connue, voir CNRTL "cuivre"). Cependant, ci-dessous pour captīvŭm > caitiu, l'évolution au > ai semble assurée.
cŭbĭtŭ(m)
> */kó
(Ou bien : amuïssement de v, β au contact de u : cŭbĭtŭm > *cóido).
Κύπρος "Chypre" > (sonorisation des
emprunts au grec) *cŭbrŭ(m)
> AO c
jŭvĕnĕ(m) > *jŭvnĕ > *jóune > joine
"jeune" (l'aboutissement est le même que rŭvĭnă ci-dessous).
(Ou bien : jŭĕnĕm
> *jóéne > joine : amuïssement
de v au contact de u, ci-dessus oe
> oi, jŭvĕnĕm).
*rŭvĭnăm (rŭĭnăm : ŭv écrit V) > *rŭvnă > *róuna > roina "ruine" (l'aboutissement est le même que jŭvĕnĭs ci-dessus).
(Ou bien : *rŭvĭnăm > rŭĭnăm > roina : amuïssement de v au contact de u, ci-dessus oe > oi).
Pour l'occitan, selon certains scénarios, on eu : au > ai :
captīvŭ(m) > AO cautiu > AO caitiu, voir fr "chétif" (mais attention, voir GIPPM-2:165 §109, caitiu < *cactīvum)
On pourrait aussi expliquer aussi aiga "eau" par : ăquă(m) > AO auga > AO aiga, voir ăquă (bien que la différenciation u-u > i-u au stade *augua soit préférée par Jules Ronjat).
Certaines évolutions vocaliques s'expliquent par un rapprochement du timbre le plus ouvert vers celui qui est le plus fermé (pour les notions d'ouverture et de fermeture des voyelles, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique").
Voir les évolutions de diphtongues qui passent en position atone : ai > éi, au > óu, ei > i, eu > óu (surtout en provençal, beaucoup moins en languedocien) : aiga [aygo/a] / aiguier [eygyé].
Ci-dessous pour le cas de l'imparfait occitan (et ancien espagnol : Cid avie,
partien, sabien, fazien in LDR:328-329), et les substantifs féminins en -iá, l'influence de /y/ est
considérée comme une assimilation
progressive (LDR:332).
lat hăbēbās > (ci-dessus) /avias/ > /avyas/ > /avyés/
De même :
fustaria */fustaria/ > */fustaria/ > */fustarya/ > /fustaryé/ (fustariá "charpenterie,...").
Pour le français, on a par
exemple (assimilation
régressive) : XIIe siècle : /a
(Pour la notion de voyelle arrondie, voir le triangle vocalique et sa légende à "Transcription phonétique").
Voir par exemple le type
"cœur" (évolution en ancien français vers le XIe -
début du XIIe siècle :
En position atone prétonique, juste devant l'accent (paurilha "l'ensemble des pauvres") ou bien à l'initiale (pauretat "pauvreté"), les diphtongues ont tendance à faire évoluer leur premier élément vocalique vers le deuxième, par exemple : aw > ów. Voir ci-dessus diphtongues atones (fermeture des atones).
Voir GIPPM-1:300-302 :
"§ 173. — Dans le Nord et dans l'Est de notre domaine ai
Voir aussi amuïssement d'une voyelle dans la résolution de l'hiatus.
Je place ici les réductions de diphtongues et de triphtongues, qui peuvent se monophtonguer (se réduire) selon plusieurs modes.
Par exemple, pour une diphtongue, la réduction peut se faire :
- par la perte de l'élément faible (exemple : a.fr. avuec > "avec" ci-dessous) ;
- par aboutissement à un timbre
intermédiaire entre les deux éléments (par exemple : */la
Voir : diphtongues mieux conservées en occitan ; triphtongues mieux conservées en occitan.
Ainsi par exemple, l'élément faible d'une diphtongue peut disparaître
(c'est une forme de
Les exemples sont très nombreux, surtout en français, où les diphtongues ont souvent disparu.
- *ăpŭd-hŏquĕ > a.fr. avuec > "avec" (voir *ăpŭd-hŏquĕ)
jŭvĕnĕm > *jŏvĕnĕm >... juene > "jeune", voir jŭvĕnĕm à "Diphtongaison romane".
fluvium > flueve > "fleuve"
- a.esp. fruente > frente "front", LDR:333, ò devant nasale implosive.
- pour le français "fier" (< fĕrŭm), "pied" (< pĕdĕm) (type "fier"), variantes dialectales en domaine d'oïl :
*/fié̯ːr
Domaine occitan :
- en position atone :
(prétonique) : bas latin măgĭstrālĕm > (g > ∅, ĭ > e) AO maestral "mistral". L'apparition de la variante maistral peut s'expliquer de plusieurs manières, soit par une évolution phonétique de maestral ou AO maiestral, soit par analogie sur maistre "maître".
- Riez (04):
Peuple des Rēii
(DFL
donne ē, à étudier) > *Rēiensīs
= *Rēiēsīs
> *[réyéːsé]
> (sorte de syncope)
[ryés] Riés (Riez, 04) (TGF1:60
: "ethnique Reii + suff. lat.
ou bien :
Rĕii
[rèyi] (quantité de e erronée
dans DFL
?) > (diphtongaison
conditionnée par y) *[r
En latin :
- cŭm + ăgō > *cŏăgō, (a > ĭ) *cŏĭgō ? > cōgō "pousser ensemble, rassembler"
- *cŏăgō >
Je regroupe ci-dessous deux évolutions vocaliques qui ont peut-être procédé du même fonctionnement : l'une en provençal, l'autre en français.
Le paragraphe présenté ici constitue un cas particulier de résolution d'hiatus par épenthèse ; je le place dans cette partie car il s'agit de l'épenthèse d'une voyelle entre deux voyelles. On peut considérer qu'entre [i] et [ʋ], l'épenthèse d'un [é] facilite l'articulation ; cette épenthèse a pu apparaître à l'occasion d'une sorte de différenciation de point d'articulation de la composante [i] ; en outre l'évolution iu > ieu a pu être favorisée par l'existence de mots avec ieu (Dieu, ieu, mieu...).
Dans les deux cas concernés ci-dessous, l'accent tonique se porte
initialement sur le premier élément vocalique : iʋ̯ et
Lorsque é, élément moins fermé, est apparu, il a dû
immédiatement attirer vers lui l'accent tonique (loi
de l'accent sur la voyelle la plus ouverte ci-dessus) : vieure
[vyéwré] "vivre", joeine [djwéyné] ou [djwèyné]
"jeune".
Précisions sur la prononciation de iu (ieu) en Provence :
Le contact de i (< ī) avec v ou b implosif a mené à iu en occitan : lat vīvĕrĕ > oc viure "vivre", lat rīvŭ(m) > oc riu "ruisseau", lat cīvĭtātĕ(m) > oc ciutat "cité", lat lībră(m) > oc liura "livre s.f."... En provençal,
L'évolution iu > ieu semble s'être produite essentiellement en Provence. Dans ses œuvres littéraires et dans les entrées du TDF, F. Mistral écrit viéure, riéu, escriéure.
viure "vivre"
Curieusement, pour "vivre", l'ALF donne très majoritairement [vi
Pour ALF "écrire", c'est encore plus net : seule la
prononciation [èskri
(SSÉPO:10, note 9, en parlant de l'épenthèse de e en gascon comme une "optimisation syllabique" dans *negr > g neguer [négé], *batr > g bater [bate]) : "Une épenthèse comparable est celle qui a lieu en provençal où la diphtongue [iw] est systématiquement remplacée par [jew] ([viw] → [vjew] viu ‘il vit' ou ‘vif’ adj.)".
-īvŭm > -iu > -ieu (
(scribere > escriure > escrieure "écrire")
rivum > riu > rieu "ruisseau"
vivere > viure > vieure "vivre"
...
Même en position prétonique, l'épenthèse se réalise :
civitatem > ciutat > cieutat (par la suite > [siówta], voir Prononciation des diphtongues atones à "Diphtongues").
.
Souvent le TDF signale la variante en en oei comme pr.ma..
buxitam > boista, boita > boeita "boîte"
buxum > boisse > boeisse "buis"
fodere > foire > foeire "fouir"
juvenem ou juene > joine > joeine "jeune"
En français, cette évolution affecte les
descendants du latin
ăquă(m)
> */è
Voir ci-dessus eau > iau.
-ĕllŭm > -eau (suffixe diminutif, aussi nŏvĕllŭm > "nouveau", castĕllŭm > "château"...)
bĕllŭm > "beau".
En occitan, -ĕllŭ(m)
mène logiquement à -èu /è
(Pour les notions d'ouverture et de fermeture des voyelles, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique").
Remarque : voir aussi ci-dessous l'harmonisation vocalique, qui affecte les voyelles prétoniques.
Essai d'énoncé de la loi :
(d'après LPODV:223) :
"(...) les voyelles françaises tendent à s'ouvrir en syllabe fermée et à se fermer en syllabe ouverte".
"(...) la loi de position [décrit] assez fidèlement la distribution des voyelles dans certains parlers français, notamment ceux du Midi de la France (...)"
(d'après LPEPH:199-200) :
En français, à partir du XVe et surtout du XVIe siècle :
- les voyelles toniques devant consonne prononcée (finale) ont tendance à s'ouvrir (par exemple : lat. mărĕm > [méːr] > [mèːr] "mer") alors que lat prātŭ(m) > [pré] (voir é < a latin) ;
- les voyelles en finale absolue ont tendance à se fermer (par exemple, [mòt] > [mót] "mot") (ci-dessous mŭttŭm).
Cette loi contient de nombreuses exceptions, et les causes de cette évolution ne sont pas clairement établies. Yves-Charles Morin propose comme origine des variations de quantité vocalique : voyelle longue => fermeture, voyelle brève => ouverture (ce qui rejoindrait l'ancien système d'évolution vocalique du latin ci-dessus) (LPEPH).
Bien que cette loi contienne de nombreuses exceptions, "son succès
vient probablement aussi de l'existence d'alternances
morphophonologiques bien connues et très vivantes dans le parler moderne
pour les voyelles moyennes, [é]~[è], [
(LPEPH:213) : autres exemples : "mer", "tel", "telle", "mère", par opposition à "blé", "nez", ou "fée" (avec a.fr. é < a latin).
Remarque : voir aussi ci-dessus la loi de position, qui concerne la dernière syllabe du mot.
L'harmonisation vocalique est un type d'assimilation vocalique à distance (dilation) décrit en français. La voyelle prétonique a tendance à s'assimiler à la voyelle tonique de la syllabe suivante.
PHF-p:60
: "le timbre de la voyelle tonique influence le timbre de la voyelle
atone qui la précède dans le mot." Cette transformation affecte surtout
[è] / [é], mais aussi [
Je pense que Maurice Grammont est le premier à introduire l'expression "harmonisation vocalique" (TPPF:24..., google.books), bien que ce phénomène fût décrit juste avant, au moins dans COPLF:72-73. Claude-Marie Gattel (DULF) donne déjà des prononciations issues de l'harmonisation vocalique ("châtaigne" châ-tè-gne, "châtaignier" châ-té-gnié, google.books).
Maurice Grammont (TPPF:13) : "Un autre phénomène général (...) est celui de l'harmonisation vocalique : les voyelles contenues dans deux syllabes consécutives ont tendance à s'assimiler au point de vue du timbre, la première prenant le même timbre que la seconde. Ainsi : été avec é inaccentué fermé, conformément à la règle générale, mais étais (ètè) avec assimilation de l'e inaccentué à l'è accentué ouvert."
L'auteur donne de nombreux exemples pour è/é (TPPF:41), par exemple : « près "presse", prèsõ "pressons", mais présé "presser, pressez, pressé" ».
Maurice Grammont indique aussi que [è] peut se fermer en [é] par
l'influence d'un [i] ou d'un [u] dans la syllabe
(TPPF:41) "L'harmonisation vocalique a lieu aussi avec une voyelle accentuée dont le point d'articulation est plus éloigné : èbèn "ébène" mais ébénist "ébéniste" [1], — plèr "plaire", plèzan "plaisant", mais plézīr "plaisir", — tèt "tête" mais tétü "têtu" (...) , — tü y è "tu y es" mais y é tū "y es-tu ?" (...)"
[1] Le cas de ébène / ébéniste montre chez l'auteur une première harmonisation de la première à la seconde syllabe dans [èbèn] puis une seconde harmonisation de la deuxième à la troisième syllabe [ébénist]. Voir la longue discussion à CNRTL "ébène".
L'harmonisation vocalique est bien une tendance, pas une règle : elle ajoute souvent une variante de prononciation à une autre, voir par exemple CNRTL "ébène" : [ébèn] / [èbèn] (la seconde variante par harmonisation vocalique).
André Martinet reprend la description de Maurice Grammont, en étudiant l'impact réel sur la prononciation actuelle du français (SéèF:2) :
"Il y a des personnes qui sont déterminées, dans leur choix de é ou de è, par le timbre de la voyelle de la syllabe suivante. Si cette syllabe comporte un i, un u ou un é, le choix sera é. Si elle comporte un ai, un a ou un on, c'est è qui sortira. On entendra donc, avec é, précis, élu, été, et, avec è, était, bêta, maison."
Puis il poursuit :
"Certains sont tentés de conserver, au pluriel des verbes, la voyelle du singulier. Ainsi, (il) met, prononcé /mè/, va entraîner un è dans (nous) mettons, (vous) mettez, alors que ceux qui se laissent entraîner par le timbre de la voyelle suivante, prononceront mettons avec è, mais mettez avec é. Ceux qui échappent aux deux pressions auront é aussi bien dans mettons que dans mettez."
Parfois, l'harmonisation vocalique prend l'apparence de l'alternance vocalique de l'occitan (ci-dessus), si un [é] final peut fermer un [è] précédent, mais ce n'est qu'une apparence : "fêter" ([fété] variante "par harmonisation vocalique", CNRTL "fêter"),"(il) fête" [fèt] ; châtaigne / châtaignier, crête / écrêter, j'aime / aimer...
Ce phénomène s'apparente à l'
Schémas généraux
ā et ă ne changent pas leur timbre.
|
latin
|
|
occitan
|
| ā, ă | > |
/a/ |
| ālă(m) |
ala "aile" |
|
| nāsŭ(m) |
nas "nez" |
|
| pătrĕ(m) |
paire "père" |
|
Mutation ā, ă > /a/ avec exemples en occitan.
Remarque : étudier l'article la > lò en rouergat, limousin...
Voir fermeture a > o devant m, n à la partie "m, n (nasalisations...)", exemples : lo pòn "le pain", la gròna "la graine".
À faire (cas de manducare
> variantes menjar, minjar, mingar).
Voir ci-dessus fermeture
du timbre entre nasale et nasale implosive.
Ex : *bătācŭlārĕ > oc badalhar, fr bâiller, (a.fr. bäaillier), *bătācŭlat > oc badalha, fr (il) bâille.
Cas d'amuïssement :
palanca (< phalanga) > AO planca "planche".
ornament, vassalatge, armadura, pescador, calamèu, meravilha..., monastier
Voir évolution
du
Lexique-provence estime que de nombreuses apophonies se sont réalisées (apophonies cachées), qui ont fait évoluer
Il y a eu des voyelles en pénultième de proparoxyton, qui ont
probablement évolué vers
(A. Thomas signale un affaiblissement en e pour ădjăcēns, EPF:214).
Souvent le représentant du ă disparaît par syncope :
- ădjăcēns > aiace > *aiece > aise ;
- aspărăgum > espargue "asperge".
En position
ĕ
>
ou s'il y a diphtongaison conditionnée :
ĕ
> iè
En position
ĕ > é ou ∅
Pour ĕ en hiatus devant voyelle : consonne + ĕ, ĭ + voyelle.
Schéma général :
ĕ
>
ou s'il y a diphtongaison conditionnée :
ĕ > iè
Exemples sans la diphtongaison conditionnée :
|
latin
|
|
occitan
|
| ĕ | > |
è |
| bĕnĕ |
bèn "bien" (1) |
|
| caelu(m) > cĕlu | cèu "ciel" |
|
| dĕcĕ(m) |
dètz "dix" |
|
| -ĕntĕ(m) |
-ènt "-ant" (1) |
|
| fĕbrĕ(m) |
fèbre "fièvre" |
|
| fĕl |
fèu "fiel" |
|
| fĕrŭ(m) |
fèr "fier" (2) |
|
| hĕrī | ièr (3) "hier" |
|
| hĕrbă(m) |
èrba "herbe" |
|
| lĕpŏrĕ(m) |
lèbre "lièvre" |
|
| mĕl |
mèu "miel" |
|
| pĕdĕ(m) |
pè "pied" |
|
| rĕm |
rèn "rien" (1) |
|
| tĕnĕt |
tèn "(il) tient" (1) |
|
| tĕpĭdŭ(m) |
tèbe "tiède" |
|
| vĕnit |
vèn "(il) vient" (1) |
|
Tableau : exemples de mutation ĕ > /è/.
(1) Pour l'orthographe et la prononciation de bèn, -ènt, rèn, tèn, vèn, voir le paragraphe ci-dessous.
(2) Le provençal fier est un francisme. Alors que fèr est toujours connu, avec le sens de "sauvage".
(3) Hęr, ęr /èr/ étaient connu en ancien occitan, comme hier. Hier, ièr est peut-être un francisme, à étudier.
Exemples avec la diphtongaison conditionnée :
|
latin
|
|
occitan
|
| ĕ | > |
ie |
| căthĕdră(m) | cadiera "chaise" |
|
| lĕctŭ(m) | liech / lièit "lit" |
|
| pĕjŏr |
piéger "pire" |
|
| vĕtŭlŭ(m)
> *vĕtlŭ |
vièlh "vieux" |
|
Tableau : exemples de diphtongaison conditionnée de /è/.
Voir action
fermante devant nasale implosive ci-dessus.
Une nasale
(Voir la comparaison avec l'évolution du français dans "Du latin au provençal 1" ici).
Dès l'ancien occitan, les dialectes à
l'ouest du Rhône ont fermé le è devant n et m, alors qu'il a toujours été conservé à
l'est du Rhône (GIPPM-1:155
et:156).
Cela explique les orthographes bẹn,
ardẹn... en ancien occitan dans DOM
(le ẹ médiéval représente é), les orthographes du gérondif et
du participe présent en
Je cite GIPPM-1:155 :
« Dès le
Le èn s'est conservé vers l'est à partir de Lansargues (commune de l'Hérault à quelques kilomètres de Montpellier) (GIPPM-1:156). « On a encore èn à Lansargues ; mais en à Montpellier. A l'E. du Rône, dans la marche nimoise et dans la plaine côtière jusqu'à Lansargues on prononce rèn, sèmpre, bè(n), tè(n), cènt, dènt, metènt (...). »
En effet, quand on écoute attentivement les enregistrements, on se rend
compte que les locuteurs de Provence respectent encore bien la
distinction bèn, rèn, tèn... / fen,
plen, sembla... (voir dans la partie "transcription phonétique"
: prononciation
de
en, én, èn).
Pour la graphie actuelle, les dictionnaires récents ne donnent pas l'accent grave dans ben, -ent (corrent), ren, ten, ven... (DOGMO, DBFP, GP, alors que la version précédente de GP donnait les participes présents en -ènt). Le site lexique-provence.fr encourage au contraire à utiliser l'accent grave dans ces cas.
Voir prononciation
de en, én, èn.
La prononciation des provençalisants
suit une règle inchangée depuis presque deux mille ans. Cela amène à
penser qu'il serait dommageable à la qualité de la langue, et à sa
richesse, d'abolir la distinction entre en et èn. Le site conserve cette distinction.
Certes les partisans de la non-accentuation pourront dire qu'il ne
s'agit que d'une abolition à l'écrit, et que les provençalisants sont
libres de conserver leur prononciation. Mais la plupart des
néo-provençalisants ignorent ces phénomènes complexes, et se fient
volontiers à l'écrit pour la prononciation. Frédéric Mistral avait tenu
à respecter cette distinction écrite entre en
et èn, sans que je sache s'il
s'est aidé de l'étymologie, ou bien de la prononciation effective. Il
apparaît plutôt qu'il s'est fié à la prononciation effective car par
exemple pour sembla, il donne
sèmbla, prononciation que j'ai
enregistrée vers Avignon. Pourtant ailleurs on a sembla
"il semble", plus en conformité avec l'étymologie (< sĭmŭlăt).
Voir aussi l'origine de la décision de ne pas distinguer én
et èn en graphie classique : (Robert
Lafont).
Si on ne connaît pas le latin, une règle logique peut aider à connaître s'il y a l'accent grave en provençal, que ce soit pour e ou pour en :
- Si le mot français est en /yè/, /yè̃/, alors le mot provençal est en /è/, /è̃/ : il porte l'accent grave (diphtongaison romane spontanée très réduite en occitan), et réciproquement :
"bien" <=> bèn ;
"rien" <=> rèn
;
"(il) tient" <=> tèn(e) ;
"(il) vient" <=> vèn(e).
Si le mot français est en ein, oin, alors le mot provençal est en /é̃/ (diphtongaison française type "plein", "foin").
"foin" => fen
;
"frein" => fren ;
"plein" => plen.
(On met à part les mots de type "lien" < lĭgāmĕn,
"sien" < sŭŭm).
- Cette règle ne peut pas aider quand ĕ
latin est
esp aprende <=> pr aprend(e) ;
esp corriente <=> pr corrènt ;
esp tiempo <=> pr tèmps ;
esp
vientre <=> pr vèntre.
Il y a cependant eu des réfections analogiques (?) en castillan : siembra, hiende alors qu'en occitan en général : sembla, fende.
Remarque : Si la voyelle è
se trouve entre m et n,
il y a fermeture de è dans
tout le domaine d'oc ; on écrira donc e
dans accent : membre, ment,
voir le paragraphe suivant.
Une nasale
Voir fermeture du timbre entre nasale et nasale implosive ci-dessus.
Je cite GIPPM-1 (p. 156) à propos de l'est du Rhône :
« e est généralement
fermé entre m et nasale
Cet aspect est à étudier davantage. Certains mots peuvent être des emprunts (membre, moment) et la quantité vocalique doit être abolie au moment des emprunts. Conséquence ? Par ailleurs, les formes comme amènt, cremènt (pour amant, cremant), amèm, cremèm (pour amam, cremam) sont analogiques de la deuxième conjugaison (partènt, partèm).
Pour ment,
ramentar... le TDF donne bien un e
fermé, et on a bien enregistré un
Ces mots semblent d'origine populaire, ce qui donne à penser que par la
voie populaire au moins, il y a bien une fermeture de è
compris entre m et nasale (n ou m)
Nemausŭs : Le nom
de la ville de Nîmes (< Nemausŭm)
provient sans doute d'une étape attestée Nemze/Nems
(GIPPM-1:263-264). Nemausŭs
était un
À partir de Nemze/Nems, je pense qu'on peut reconstituer une étape où la tonique e se ferme en i du fait de sa position entre nasale et nasale implosive : *Nimze/Nims. Puis peut-être apparition d'un e épenthique *Nims > Nimes ou une métathèse *Nimze > Nimez. La solution proposée par (LNVN in TGF1:159) : variante par apocope Nemaus(um) > *Nemes > Nimes, me semble moins plausible. En effet dans cette théorie :
- d'abord l'évolution e
> i n'a pas de raison de se produire, du moins
- ensuite la voyelle finale -e n'a pas de raison d'apparaître ; on aurait alors *Nema < Nemasu ou *Nemo < Nemosu.
Je cite GIPPM-1 (p. 156) :
« Tous nos parlers, je crois, ferment -e-
dans segne, engen <
Le GIPPM-1
(p. 159) laisse comprendre que le latin prĕtĭŭm
aurait dû donner prètz /près/
(avec e ouvert). Or c'est
/prés/ qui est connu en provençal (avec e
fermé), et même /pris/ (pr.rh.),
/pri/ (auv), /pré/ (lim), aux côtés de /près/ (rouerg), /prèts/ (g),
/prèi/ (auv) (TDF, les variantes en i
sont peut-être des
Cette analogie proposée par J. Ronjat est possible, mais pour prĕtĭŭm,
on se trouve dans le cas de la palatalisation
de
ty
: un i diphtongal de
transition a pu apparaître comme dans pōtĭōnĕm
> poison. On peut donc
prĕtĭŭm > */pret
Ainsi il est possible d'y voir une évolution /èi̯/ > /é/, qui
est une assimilation
réciproque : le /è/ et le /i/ convergent vers une valeur
intermédiaire, /é/. Le stade /èi̯/ a pu être très fugace. Ce cas
serait analogue à celui de esp
pĕctu "poitrine" > [pèkto] > [pèyto]
> [pétʃo] (ch espagnol).
Voir également le cas de cadiera. Le scénario n'est
pas le même partout en domaine d'oc (voir ci-dessus g /prèts/... : absence de l'i
diphtongal, ou absence d'assimilation réciproque). Pour prezzo,
l'italien du nord a prezzo /prètso/, mais l'italien du
sud a /prétso/ (je ne
sais pas l'expliquer). L'auvergnat /pri/ a pu suivre ièi̯ > i, ou bien il est
conforme à un schéma général de fermeture de /è/, /é/ : voir variante auv dricha
pour drecha (< dīrēctăm).
En français l'évolution est semblable mais la diphtongaison spontanée affecte ĕ :
prĕtĭŭm > /prétyʋ/ >
/prèi̯
Voir PHF-f2:341-342.
Voir la comparaison avec le français "moitié" :
mĕdĭĕtātĕ(m)
> *meyy
En occitan comme en français, ĕ latin post-tonique final latin est éliminé par les apocopes. Par exemple : pŏntĕ(m) > pòn(t), mărĕ > mar, căntārĕ > cantar,
Il faut remarquer que certaines apocopes de e final avaient déjà affecté le latin à l'époque classique : apocopes d'époque latine.
Schéma général :
ĭ, ē > é
Pour ĭ en hiatus devant voyelle : consonne + ĕ, ĭ + voyelle.
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| ĭ
> |
>
|
/é/ |
| ē
> |
||
| crĭstă(m) |
cresta "crête" |
|
| pĭră(m) |
pera "poire" |
|
| pĭscăt | pesca "(il) pêche" | |
| pĭsŭ(m) |
pese "pois" |
|
| frēnŭ(m) |
fren "frein" |
|
| gaul Lŭtēvă(m) |
Lodeva "Lodève" (34) | |
| (pĕnsăt
>) pēsăt |
pesa "(il) pèse" |
|
| plēnŭ(m) |
plen "plein" |
|
| sērŭ(m) |
ser, sera "soir" |
|
|
Devant r ou l
|
||
| vĭrĭdĕ(m) |
verd
"vert" |
|
|
clerc, clèrgue "clerc" | |
|
|
|
|
Tableau : exemples de mutation ĭ et ē toniques > /é/.
Voir la règle 2 de l'accent latin : vĭă "voie" était dissyllabe [via] ou [viya] (yod épenthique), avec l'accent sur ĭ, et l'accent est resté sur cette lettre. Le ĭ a ainsi échappé aux yodisations (Exceptions aux palatalisations à "Premières palatalisations").
En français, ce ĭ évolue en é puis en "oi" : vĭăm > "voie" (type "toile").
En occitan par contre, ce ĭ semble évoluer en i : vĭăm
> via (voir aussi it,
esp, cat, port
via), mais il faut se poser la question : ĭ a-t-il
d'abord évolué en é ? Il faut d'abord constater que dans des cas
semblables, ē et ĕ peuvent de même évoluer en i
: imparfaits de type hăbēbās > *habias > aviás, dĕus
> dius [di
Voici les arguments :
- vĭăm > via "voie" (
- 65 die
[dié] < *dĭăm (ALF 726 "jour").
(MÉ-ainz:576) "(...) [en français] l'i bref se diphtongue en ei qui plus tard devient oi. Il n'en est pas tout à fait de même pour le provençal. Dans cette langue en effet l'i bref accentué reste i devant un a, par exemple dans via = lat. via, et dans toute autre position il devient e fermé et non pas ei. Cette difficulté phonétique n'est peut-être pas aussi insurmontable qu'elle le semble au premier abord. L'i bref non suivi d'une autre voyelle devient e fermé, et l'i bref suivi d'un a reste i : voilà deux lois absolues." (puis l'auteur discute de i bref accentué suivi d'une autre voyelle : voir le cas discuté de *antius).
(FEW 14:380a,
note 1) (trad.all.)
"Dans cette forme ["vie"] et dans la plupart des formes suivantes,
(ZBIF:110) (trad.all.)
« Pour deux raisons, nous ne devrions
pas nous attendre à ce que l'évolution de via s'accorde avec
celui de *av
1. Supposons que le ĭ dans via
parvinsse au même timbre que ē dans habēbam (ce que
montre le français "voie"), alors l'ancien v
2. via comme substantif ainsi qu'adverbe ("loin") se comporte dans la phrase de façon complètement différente par rapport aux formes verbales sur le plan de l'accent tonique.
Cela vaut aussi aussi en francoprovençal pour l'évolution de via qui en général n'est pas la même, ou bien pas exactement la même, que celle de *aveam.
Dans le domaine où *aveam a donné avin, le substantif via(m) est devenu vi : en Dauphiné (attestation de1276 par Devaux 78, 32), dans le Lyonnais (début XIVe siècle, voir Rom. 39, 219), dans le Forez (XIIIe s., voir Rom. 22, 17, aussi Veÿ 52 n.), dans le département de l'Ain (XIIIe, XIVe siècle, voir Revue de Clédat I, 33, 17, Doc. ling. I, 109).
[...]
Dans le domaine où *aveam est devenu avey ou avi, on a aussi d'anciennes attestions du substantif vi (XIVe s., Savoie, voir Rev. sav. 1909, 74). Aujourd'hui surtout vi (Val Soana, lt. AG.III:2) ; "chaussée" : Sav. 973, 965, 955, H.-Sav.945 ; "sentier" : Sav. 965, 955, 954 ; voir aussi Constantin et Désormaux, Dict. sav. 423).
(note 1)
- La dissimilation a participé à la disparition de -v- dans l'imparfait des verbes III et II ; cela est montré dans les textes (trad.all.) (ancien dialecte romain), comme Vita di Cola di Rienzi [Rienzo ?] (ed. Muratori, Antiq. III) : on y trouve à l'imparfait des verbes III -eva et -ea (II -iva), seulement avere a avea sans exception (très nombreuses attestations).
- En revanche, on ne peut pas prouver que dans toute la Romania, les formes de l'imparfait à v effacé chez les verbes autres que avere, dovere, sapere, et autres (radical se terminant pas une labiale) soient analogiques ; c'est même très peu probable. C'est plutôt le faible accent tonique des formes verbales qui a favorisé la disparition de -v- (également là où la dissimilation n'entre pas en jeu) ; c'est ce que montrent le latin et le roman parfait 1e pers. cantai (l'anc.sard. II 1e pers. -ivi, 3e pers. -ivit à côté de I 1e pers. -ai, 3e pers. -ait prouve que le latin 1e pers. cantai n'est pas analogique de finīi, comme on l'explique habituellement.), cantarat [pour plus-que-parf. 3e pers. cantāverat], cantasset [pour subj. plus-que-parf. 3e pers. cantāvisset], finierat [pour plus-que-parf. 3e pers. fīnīverat], finisset [pour subj. plus-que-parf. 3e pers. fīnīvisset], anc.tosc. dee, die, dei, di, anc.ven. die, anc.lomb. dee, anc.gen. de 'debet' [dēbet "il doit"], anc.tosc. dea, dia 'debeat' [dēbeat "qu'il doive"].
- Sous l'influence du faible accent tonique, il est facilement compréhensible que -v- a disparu dans -evat, et pas dans -avat. D'une manière semblable nous avons dans les dialectes sud-italiens et l'ancien sarde parfait II 1e pers. -v- conservé, alors que pour I 1e pers. il a disparu, par exemple anc.nap. insive 'uscii', saglive 'salii' etc., à l'opposé de trovay etc. (fui, fuy), Loise de Rosa (Arch. stor. per le prov. nap. IV, 421 ff.). »
dīrēctŭm > dērĕctŭ(m) > oc drech, cat dret, fr "droit" (mais esp derecho) (ī ci-dessous)
quĭrītārĕ > oc cridar, fr crier.
hŏspĭtālĕ(m) > ostau "maison"
ăd ĭd
ĭpsŭm > adès,
AO
adès, adeis "tout à l'heure
(antériorité ou postériorité immédiate)..."
*cŏmĭnĭtĭārĕ > començar : le deuxième ĭ s'amuït.
(en interaction avec les formes conjuguées, qui ont dû se prononcer sur le mode cŏmĭnĭtĭō "je commence" à une date précoce)
hērēdĭtārĕ > AO eretar "hériter": les formes conjuguées comme l'infinitif n'ont jamais l'accent sur le ĭ ; cette voyelle aurait pu survivre par basculement de l'accent (type mastega) mais aucun descendant ne le montre. Quelques variante d'oïl et fr.pr. montrent une syncope du second ē : type erter, ertar (Thônes, Aussois... mais l'ouvrage ne donne pas la conjugaison) (FEW 4:410a), h.engad.. artêr, Haut Valais artar (FEW 4:411a).
pessĭmŭm > AO p
pe(n)sĭlĕm > AO p
Aussi : toponymes
en
Le ē des adverbes latins a subi la syncope : longē > luenh "loin" (à développer).
Le ĭ : à faire.
Voir infinitifs à prétonique longue : on a souvent deux variantes en AO :
Infinitifs
avec ē prétonique interne :
Il existe deux variantes en occitan :
blasphēmăt > *blastēmăt > (AO) blasmar / blastemar, "blâmer"
Variante non syncopée :
blasphēmăt > *blastēmăt > AO blastema => AO blastemar "blasphémer ; blâmer"
Variante syncopée :
blasphēmārĕ > *blastēmārĕ > AO blasmar => AO blasma "(il) blâme" (OM blama / blaima).
En position
ī
> i
ou s'il y a diphtongaison devant l :
ī
> ie
En position
ī
> i ou /∅/
La voyelle ī ne change donc pas son timbre depuis le latin.
Schéma général :
ī
> i
ou s'il y a diphtongaison devant l :
ī > ie
Exemples sans diphtongaison :
|
latin
|
|
occitan
|
| ī | > |
/i/ |
| dīcĕrĕ
(> *dīcrĕ) |
dire, díser "dire" |
|
| fīlĭŭ(m) |
filh "fils" |
|
| rīpă(m) |
riba "rive" |
|
| scrībĕre |
escriure "écrire" |
|
| spīnă(m) |
espina "épine" |
|
| trīstĕ(m) |
triste "triste" | |
| vĭcīnŭ(m) |
vesin "voisin" |
|
| vītă(m) |
vida "vie" |
|
Mutation de ī tonique > i avec exemples en occitan.
Exemples avec la diphtongaison devant l :
|
latin
|
|
occitan
|
| ī | > |
/i/ |
| anguillăm > anguīlă(m) |
anguiela "anguille" | |
| aprīlĕ(m) |
abrieu "avril" |
|
| argīllăm > argīlă(m) |
argiela "argile" | |
| fīlŭ(m) |
fieu "vie" |
|
| pīlă(m) |
piela "auge ; pilier" |
|
| vīllăm > vīlă(m) | viela "ville" (n.d.l....) |
|
Tableau : exemples de diphtongaison ī devant l.
Schéma général :
ī
> i
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| ī | > |
/i/ |
| hībērnŭ(m) | ivèrn "hiver" | |
| rīpārĭă(m) | ribiera "rivière" | |
Mutation de ī
prétonique > i avec
exemples en occitan.
Exemples de disparition par syncope :
(GIPPM-1:287-288) : "une voyelle prétonique peut tomber dans [les cas] où la consonne précédente peut former un groupe combiné usuel avec la consonne qui commence la syllabe suivante, exemple dīrēctŭ, c(o)rrotulāre > vpr. dreit ~ drech, croula".
dīrēctŭm > dērĕctŭ(m) > oc drech, cat dret, fr "droit" (mais esp derecho) (ē ci-dessus)
|
latin
|
|
occitan
|
| ī | > |
∅ |
| *dīrēctĭārĕ | dreiçar "dresser" | |
| dīrēctŭ(m) | drech, dreit "droit" | |
Disparition de ī
prétonique par syncope.
Schéma général :
ī > i ou ∅
(ī > i est souvent maintenu dans les verbes, ci-dessous)
Exemples :
rādīcīnăm
> (amuïssement du premier ī)
*radcina > (2es
palatalisations) racina
(on peut penser que si d
s'amuïssait d'abord, on aurait
|
latin
|
|
occitan
|
| dŏrmītōrĭŭ(m) | dormidor "dortoir" | |
| rādīcīnă(m) | racina "racine" | |
| Savinhac (1) |
||
Tableau : évolution de ī
prétonique interne
Il s'agit des verbes : il peut y avoir
• Infinitifs avec ī
en
Par exemple fīlārĕ
> filer, lībĕrārĕ
> liurar...
Ces infinitifs sont toujours en accord avec les formes
• Infinitifs avec ī
en
Voir infinitifs à prétonique longue : on a souvent deux variantes en AO, mais pour le moment je n'ai que des exemples où cette prétonique longue est conservée, et non perdue par syncope.
Dans l'infinitif latin, un nombre de syllabes supérieur ou égal à 4
peut entraîner une syncope prétonique (exemples à chercher). Mais
l'effet analogique des formes
- influence des formes
admīrārĕ (> amirar).
lat. pop. *arrīpārĕ > arribar "arriver"
castīgārĕ "châtier" : castīgăt "il châtie" > oc castia => castiar, castigar "châtier" (voir g devant a)
ērādīcārĕ > AO arazigar
"déraciner"
fătīgārĕ > AO fadiar,
fadigar : idem.
- influence des formes
exemples en occitan ?
ērādīcārĕ > français "arracher" (peut-être oc., esp. arrancar, dont l'origine n'est pas claire)
● En position
ŏ >
ou s'il y a diphtongaison conditionnée ou diphtongaison spontanée devant k, v :
ŏ > uò, ué (ci-dessous)
(sans doute à
rattacher à l'évolution de ū ci-dessous, pour
expliquer /
● En position
ŏ > o /
Cas particulier si o est à
l'initiale, en
souvent :
ŏ > o /óʋ̯/ (ci-dessous)
Schéma général :
● sans diphtongaison romane :
ŏ >
● avec diphtongaison romane (diphtongaison conditionnée ou diphtongaison spontanée devant k, v) :
ŏ > uò, ue
(voir ci-dessous évolution de ū)
Exemples sans la diphtongaison romane (mais assez souvent avec
la diphtongaison occitane) :
|
latin
|
|
occitan
|
| ŏ | > |
/ò/ (et [wò], [wa]...) |
| cŏr |
còr
"cœur" [kòr] [kwòr] [kwar]... |
|
| mŏlă(m) |
mòla "meule" [mòlo]
[mwòlo] [mwalo]... |
|
| ŏpĕră(m) |
òbra "œuvre" [òbro/a] |
|
| pŏpŭlu(m) |
pòple "peuple" [pòplé] |
|
Tableau : exemples de mutation ŏ > /ò/ pour l'occitan.
Exemples avec la diphtongaison conditionnée :
|
latin
|
|
occitan
|
| ŏ | > |
ue |
| cŏrĭŭ(m) |
cuer "cuir" |
|
| fŏlĭă(m) |
fuelha "feuille" |
|
| nŏctĕ(m) |
nuech "nuit" |
|
| ŏctō |
uech "huit" |
|
Tableau : exemples de diphtongaison conditionnée de ò pour l'occitan.
Exemples avec la diphtongaison
spontanée devant k,
v :
|
latin
|
|
occitan
|
| ŏ | > |
uò, ue |
| bŏvĕ(m) |
buòu "bœuf" |
|
| fŏcŭ(m) |
fuòc, fuec "feu" | |
| lŏcŭ(m) |
luòc, luec "lieu" |
|
| ŏcŭlŭ(m) > *ŏclŭ |
uelh "œil" |
|
| ōvŭ(m) > ŏvŭ(m) |
uòu "œuf" |
|
Tableau : exemples de diphtongaison spontanée de ò pour l'occitan.
Une nasale
Voir action fermante devant nasale implosive ci-dessus.
Dans le domaine d'oc, par un phénomène phonétique analogue au cas de ĕ, il y a fermeture de ŏ devant nasale implosive dès l'AO.
Je cite J. Ronjat (GIPPM-1:185, 186) : "Dès le
En espagnol (castillan), pour quelques mots, la fermeture de ò a dû se réaliser dans les mêmes conditions que l'occitan occidental. Cela serait prouvé par la non-diphtongaison du o (diphtongaison romane) :
abscŏndĭt > esconde "(il) cache" ;
cŏmĭtĕm > conde "comte" ;
hŏmĭnĕm > hombre "homme".
Au contraire, la diphtongaison du ò prouverait la conservation du timbre ouvert :
cŏmpŭtŭm > cuento "compte" ;
fŏntĕm
> fuente "source ; fontaine";
frŏntĕm > *fruente > frente "front" (amuïssement d'une voyelle) ;
*ĭncŏntrat > encuentra "(il) rencontre" ;
lŏngŭm > a.esp. luengo ;
pŏntĕm
> puente "pont".
Voir aussi ci-dessous
Sources :
(DCECH 4:131 in DÉRom /'mɔnt‑e/) (trad.esp.)
"L'absence de diphtongaison doit s'expliquer
par influence de la nasale".
(RSW 1, § 232 in DÉRom /'mɔnt‑e/) (trad.all.) :
"De même en espagnol, devant nasale
implosive, ŏ s'est parfois
fermé en ó : cŏmĭtĕm > conde "comte", abscŏndĭt
> esconde "(il) cache", hŏmĭnĕm
> hombre "homme" [mais pŏntĕm
> puente "pont", frŏntĕm
> *fruente > frente "front" avec évolution normale du
latin vulgaire ò]."
Une nasale
J. Ronjat (GIPPM-1:187) : "La fermeture de mount
est parallèle à celle de -men <
mente, etc..."
On retrouve en effet le même phénomène de fermeture pour ò
et pour è
dans le même environnement.
mŏntĕ(m)
> AO m
(au lieu de mònt
attendu)
Exceptions : mònt existe en gascon. En provençal, certaines régions ont aussi une alternance vocalique montar / mònta.
Pour *sŭbmŏnērĕ > *sŭbmŏn(ĕ)rĕ, on ne connaît
pas d'exception, ŏ donne toujours un o fermé puis [
- dans la variante a.esp. muent, la diphtongaison montre que ŏ a gardé sa valeur ouverte ;
- dans la variante monte (qui a évincé muent), la non-diphtongaison montre que ŏ s'est fermé de la même manière qu'en occitan général (voir DÉRom à /'mɔnt‑e/).
Pour ces deux mots d'origine grecque :
mŏnăchŭ(m) > monicu > *monigu > *mongu > monge "moine" ;
cănŏnĭcŭ(m) > *canonigu > canonge "chanoine" ;
Jules Ronjat (GIPPM-1:277-278, note 2 p. 277) donne trois explications possibles :
- le latin /
- -ŏnĭcus a subi l'influence analogique de mots en -ōnĭcus : centŭriōnĭcus "de centurion" ;
- au moment de la
En situation
En position
- ŏ > o /
- ŏ > o
/ó
Exemples ŏ initial > o
/
|
latin
|
|
occitan
|
| ŏ | > |
o
/ |
| cŏgnōscĕrĕ |
conóisser "connaître" |
|
| cŏllŏcārĕ |
colcar, cochar "coucher" |
|
| cŏmpŭtārĕ |
comptar, contar "compter",
"conter" |
|
| cŏrbĭcŭlă(m) |
corbelha "corbeille" |
|
| hŏnĕstŭ(m) |
onèst "honnête" |
|
| hŏnōrĕ(m) |
onor "honneur" (ci-dessous
/ównʋr/) |
|
| hŏspĭtālĕ(m) |
ostau "maison"
(hôtel) |
|
| mŏnētă(m) |
moneda "monnaie" |
|
| ŏrnāmĕntŭ(m) |
ornament "ornement" |
|
| pŏrcĕllŭ(m) | porcèu "pourceau" |
|
| Tŏlōsă(m) |
Tolosa /tʋlʋzo/a/ | |
| tŏnĭtrŭm
> tŏnĭtrŭ(m) |
tonèire, tonedre... |
|
| tŏrmĕntŭ(m) |
torment "tourment" |
|
Tableau : exemples d'évolution ŏ initial > o
/
(Voir GIPPM-1:296-297)
Lorsqu'on aboutit à ó roman
Remarque : quelques exemples de ŭ et ō
en
Voir aussi le français ci-dessus "mûrier" ?
ŏ
> o /ó
Aussi, par action de labiale (ci-dessus : labialisations) :
ŏ > /u/ : ŏpācŭm > ubac, excŏmmŭnĭcāre > AO escumergar
Exemples ŏ > /ó
Tableau : exemples d'évolution ŏ prétonique initial > o /óʋ̯/ pour
l'occitan. (En rouge : voie
savante)
Amuïssement :
Carpentŏractĕ > Carpentràs "Carpentras" (84).
L'étude de certains comparatifs nominatifs en latin et de leurs descendants en AO montre que -or > -er :
- gĕnĭtĭŏr > CS genser "plus gentil" (AimPeg in LR 3:461b) ;
- măjŏr > CS mager, maire "plus grand" ;
- mĕlĭŏr > CS męlher "meilleur" ;
- mĭnŏr > CS mẹnre "moindre, plus petit" ;
- pĕjŏr > CS pięger, pęire "pire" ;
- sĕnĭŏr > CS sẹnher "monsieur" ;
- sordĭdĭŏr > CS sordẹjer "pire".
Comme on le voit ci-dessus, l'aboutissement est parfois en -ire. Cela signifie qu'il y a eu syncope, par exemple pour măjŏr :
măjŏr /mayyor/ (> /mayyér/ ?) > /mayyr/ > /mayré/ (avec e de soutien ?)
Certains adjectifs ne montrent que cette variante en -ire : CS belaire "plus beau" < bellatĭŏr.
En position
ŭ, ō >
En position
ŭ,
ō > /ó/ > /
Dans les premiers siècles après J.-C., les deux voyelles latines ŭ et ō
évoluent vers /ó/.
Le timbre de ŭ évolue en ó :
- à la fin du IIIe siècle et au
début du IVe siècle en position
attesté dans Catŭrrīgăs (accent gaulois ci-dessus) IA > (année 333) Catorigas IB > Chòrjas "Chorges" (05) (IAAH:323).
- au milieu du IVe siècle en la
position
- au Ve siècle en position finale (IPHAF:55, 186, 190).
(dates pour la Gaule du nord, probablement peu différentes pour la Gaule du sud).
Cas particulier de conservation du timbre /ʋ/ de ŭ :
En
voyelle (+ éventuellement consonne qui va s'amuïr) + ŭ > voyelle + /ʋ̯/ :
post-tonique interne : tēgŭlŭ(m) > teule "tuile" (ci-dessous)
post-tonique finale : dĕŭm > dèu > dieu /dyéʋ̯/ (ci-dessous).
Le timbre de ō évolue en ó au IIe siècle (légère fermeture).
Un millénaire après la mutation ŭ
>
Le même phénomène a atteint le domaine d'oïl deux siècles auparavant (ci-dessous), et il affecte une partie importante du catalan de France (LO:25).
Remarque : je pense que la situation n'est pas si uniforme : encore aujourd'hui, au moins dans l'est du Vaucluse, mes enregistrements laissent parfois entendre un son intermédiaire entre /ó/ et /ʋ/, parfois complètement /ó/.
Je cite GIPPM-1:143 :
"[ʋ] continue
GIPPM-1:295 :
"L'évolution [
Je cite aussi HLPA:102 :
"mossa, en 1421, devient mousse en 1498 ; ola en 1421 devient oulo en 1508, consol en 1458 devient consoul en 1498".
Seul le provençal conserve le son /ó/ et dans une seule situation : "
mŭlgĕrĕ
> m
pŭlmōnĕm > poumon "poumon"
(DBFP
paumon ∼ parmon) ;
sŭlpŭrĕm
> s
Le provençal ainsi que le languedocien évitent l'apparition de /
- En provençal, la vocalisation de l
préconsonantique se fait en premier : cela produit /ów/ qui demeure même
après l'évolution générale /ó/ > /ʋ/. (PP:6) : "On voit que le provençal évite lui aussi
de produire une séquence [
- En languedocien, la fermeture /ó/ > /ʋ/
se réalise en premier, de ce fait même dans les régions à vocalisation
de l implosif, la vocalisation
ne se réalisera pas dans ce cas. (PP:5, 6) : "Aucun des parlers languedociens
vocalisant /l/ implosif ne le fait après /
Voir aussi ci-dessus, à une date plus ancienne, óu̯ > ói̯ (où il y a eu
même évitement de ów).
La graphie "classique" ou alibertine (utilisée dans lexique-provence)
conserve o, équivalent de
l'ancien
Pour le cas juste ci-dessus : móuser
"traire", l'accent aigu s'impose pour situer l'accent tonique, et c'est
le seul cas à ma connaissance où ó
se prononce [ó] et non [
Le même phénomène a lieu, mais plus tôt, au XIIe siècle :
- en tonique entravée : dĭŭrnŭm
> /djór/ > "jour" ;
- en prétonique libre : gŭbĕrnăt > /góvernə/ > "gouverne" ;
- en prétonique entravée : sŭb(ĭ)tānŭm
> /sódai̯n/ > "soudain"
(pour les prétoniques, voir ci-dessous les réactions des "non-ouistes");
(- en tonique libre, le problème ne se pose pas puisque ó a subi la diphtongaison française : ci-dessous).
Schéma général :
ŭ, ō >
Pour l'occitan, en position
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| ŭ
> |
/ó/ | >
o /ʋ/ |
| ō
> |
||
| angŭstĭă(m) |
angoissa "angoisse" |
|
| bŭccă(m) |
boca "bouche" |
|
| Bŭrgŭndĭă(m) | Borgonha "Bourgogne" |
|
| bŭxŭ(m) | bois "buis" (1) |
|
| crŭcĕ(m) |
crotz "croix" |
|
| cŭm(ŭ)lăt |
combla "il comble" |
|
| dĭŭrnŭ(m) |
jorn "jour" |
|
| gŭlă(m) | gola "gueule" (2) |
|
| lŭpă(m) | loba "louve" (3) |
|
| lŭpŭ(m) | lop "loup" (3) |
|
| mŭttŭ(m) | AO
m |
|
| mŭscă(m) | mosca "mouche" | |
| pŭtăt | poda "(il) taille" | |
| rŭbĕă(m) | roja "rouge" | |
| rŭptă(m) | rota "route" | |
| rŭptŭ(m) | rot "rompu" | |
| trŭncŭ(m) | tronc "tronc" | |
| évolution
/ó/ > /ʋ/ bloquée devant l + consonne en
provençal |
||
| ŭ > | /ó/ |
/ó/ |
| mŭlgĕrĕ | móuser "traire" | |
| sŭlpŭrem / sŭlfŭrem | soupre / soufre "soufre" | |
| -ōnĕ(m) |
-on "-on" | |
| -ōrĕ(m) |
-or "-eur" | |
| -ōsŭ(m) | -ós "-eux" | |
| -tĭōnĕ(m) | -(i)zon "-ison" (savant -cion "-tion") | |
| calōrĕ(m) | calor "chaleur" | |
| carbōnĕ(m) | carbon "charbon" | |
| dōnăt | dona "(il) donne" | |
| dōnŭ(m) | don "don" | |
| flōrĕ(m) | flor "fleur" | |
| hōră(m) | ora "heure" | |
| nĕpōtĕ(m) | nebot "neveu" | |
| nōdŭ(m) | nos "nœud" | |
| ōllă(m) | ola "marmite" (5) |
|
| ōrnăt | orna "(il) orne" (6) |
|
| pōmă(m) | poma "pomme" |
|
| spō(n)sŭ(m) | espós "époux" (7) |
|
| tōttŭ(m) | tot "tout" | |
| vōcĕ(m) | votz "voix" | |
Mutation ŭ,
ō > /ó/ > /ʋ/ en
position tonique, avec exemples en occitan. La mutation a
d'abord été ŭ, ō > /ó/.
Puis en occitan, une évolution vers /ʋ/ se réalise à partir du XIVe
siècle, de même qu'en français pour les ó
(1) Pour bŭxŭm >
(2) Pour gŭlăm, il reste à
expliquer la variante
(3) Pour lŭpŭm, lŭpăm,
l'expication des mots français "louve", "loup" est donnée ici
(paragraphe des
(4) Pour mŭttŭ(m)
> pr mòt
(
(5) Pour ōllă, oc ola
(et non òla) impose le latin ō (et non ŏ)
; les dictionnaires latins ne précisent souvent pas la quantité
vocalique. Ce ō est conforme à
l'évolution en latin aulă > ōllă,
voir par exemple cauda > cōdă (pour ōllă, avec
(6) Pour ōrnăt, le français
"orne" est un
(7) Les mots français "époux", "épouse" seraient des développements d'après "épouser" (CNRTL à "époux") : voir ci-dessous /ó/ en prétonique.
Cas de cōnstrŭĕrĕ, dēstrŭĕrĕ
> construire, destruire : voir ci-dessous le système dēstrŭō, frŭŏr, flŭō, dūcō.
J. Ronjat (GIPPM-1:143-148) présente des aboutissements
différents de /
Conservation de l'ancien timbre roman /ó/
Voir ci-dessus móuser, soupre.
Traitement francoprovençal.
Pour l'occitan, que ce soit
en position
Parfois ŭ et ō > /óʋ̯/, voir ci-dessous ŏ > /óʋ̯/.
*cŭrtĭcārĕ
> (voir DOM
acorchar)
Pour mōrŭs > amorier (avec
suffixe -ier) "mûrier" : le
français semble parfois suivre une fermeture de o
prétonique en u. Voir
ci-dessous ŏ
initial > u.
Pour le français,
on a le même aboutissement qu'en occitan (/ʋ/) dès le XIIe
siècle. Cependant aux XVIe et XVIIe siècles, une
réaction de certains grammairiens a réussi à imposer un retour vers /ó/
dans certains mots : "arroser", "corvée", "fromage", "soleil"... Ces
grammairiens étaient surnommés "non-ouistes",
et s'opposaient aux "ouistes",
qui étaient en faveur de la prononciation et de l'orthographe "ou". Ce
"ou" a ainsi survécu dans "fourmi", "fourniture", souris"... (d'après
Brunot in PHF-p:123). Comparer aussi les noms de ville
Boulogne (ville française) et Bologne (ville italienne), voir Bŏnōnĭă. Voir réaction
des non-ouistes (clivage oc/oïl).
Citons GIPPM-1:289-290 : "On observe dans des langues
très diverses une tendance générale des voyelles non intenses à
abrègement (évolution qui peut aller jusqu'à l'
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| ŭ
> |
/ó/ | >
/ʋ/
|
| ō
> |
||
| Bŭrgŭndĭă(m) |
Borgonha "Bourgogne" |
|
| fūsĭōnĕ(m)
> *fŭsĭōnĕ(m) |
foison "foison" |
|
| gŭbĕrnăt |
govèrna "il gouverne" |
|
| gŭbĕrnŭ(m) |
govèrn "gouvernement" |
|
| gaul Lŭtēvă(m) |
Lodeva "Lodève" (34) | |
| pŭlmōnĕ(m) |
poumon "poumon" |
|
| Rŭtēnŏs |
|
Rodés "Rodez" (12) |
| sŭbĭndĕ |
sovent "souvent" |
|
| pōtĭōnĕ(m) |
poison "poison" |
|
| prōmĭttĭt |
promet(e) "il promet" |
|
| *sōlĭcŭlŭ(m) |
solelh > soleu "soleil" |
|
Mutation ŭ,
ō > /ó/ > /ʋ/ en
position prétonique, avec exemples en occitan. La mutation a
d'abord été ŭ, ō > /ó/.
Puis en occitan, une évolution vers /ʋ/ se réalise à partir du XIVe
siècle, de même qu'en français pour les ó
Voir ci-dessus. (Y a-t-il des cas avec ŭ et ō ?)
Amuïssement :
cŏmpŭtārĕ >
comptar ; contar, en interaction avec cŏmpŭtăt.
La
aurĭcŭlă(m)
> aurelha "oreille" (cl, gl, tl)
compŭtăt > còmpta "il compte" ; cònta "il conte"
rēgŭlă(m)
> relha "reille du soc" (type
-lha)
trĕmŭlăt > trèmbla
"il tremble" (m
+ l)
vĕtŭlŭ(m)
> vièlh "vieux" (cl, gl, tl).
Il peut y avoir basculement d'accent tonique : > /ó/ > /ʋ/ :
trĕmŭlăt > tremola "il tremble"
tēgŭlă(m) > dauph tivola, tievola "tuile" (type -ula, -vola)
strangŭlăt > (pr.ma., g, auv,...) estrangola "il étrangle"
Voir gŭ en post-tonique interne.
Voir aussi ci-dessous en post-tonique finale.
|
latin
|
|
occitan
|
| ŭ |
> |
/ʋ/ |
| frāgŭlă(m) |
a fraula "fraise" | |
| rēgŭlă(m) | n.d.l. Reule
"La Réole, Larreule" |
|
| tēgŭlŭ(m) | teule "tuile" |
|
| trāgŭlă(m) | lim traula
"châsse d'un métier à tisser" |
|
Tableau. Conservation du timbre de ŭ latin en post-tonique interne dans des diphtongues de coalescence.
En post-tonique finale : le ŭ
issu de -ŭs, -ŭ(m)
évolue en /ó/ à la fin du Ve siècle en position finale (pour
le domaine d'oïl du moins : IPHAF:55,186,190), voir ci-dessus fin
Ve siècle. Puis il s'amuït au moment des apocopes,
au cours des VIIe et VIIIe siècles.
Pour -ō de 1e.p.s. (cantō "je chante"),
il évolue en /ó/ au Ve siècle, puis disparaît également au
moment des apocopes. De même pour
À étudier : sērŭm,
sērō > AO s
Voir gŭ en post-tonique finale.
Le timbre /ʋ/ de la voyelle latine ŭ
est resté figé grâce à des
Tableau. Conservation du timbre de ŭ latin en post-tonique finale dans des diphtongues de coalescence.
(1) pour clāvŭ(m) > clau
"clou", il est sans doute impossible de savoir s'il a évolué par
amuïssement de -v-, ou par
amuïssement de -ŭ puis vocalisation
de
-v. Pour le français, on
a forcément clāvŭ(m) > (amuïssement
de v) /klaʋ/
> /klaʋ̯/ > /klɑʋ̯/ > /klòʋ̯/ > (XIIe
siècle) /klʋ/ (IPHAF:118), sinon on aurait eu
Pour les noms de lieux d'origine
- Condomagos "marché de la confluence" > Condom (12, 32) /kῦdῦ/? (prononciations mal connues !).
- Noimagos
(Ptol), sans doute représentant du gaulois Noviomagos
"nouveau marché" > Nions
"Nyons" (de même origine que "Noyon" dans l'Oise, Noviomago,
IIIe s.) (TGF1:191). On peut penser que *
- Ricomagos "marché
royal" (peut-être avec c
prononcé à la gauloise /
- Senomagus (Senomagos
"vieux marché") IA, Peut > TDF Senòs
"Saint-Pierre-de-Senos" (bol84)
(par opposition à Noviomagos
"nouveau marché" > Noiomagos,
ancien nom de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sans descendance, ATSPTC:13-15). On attendrait
Il apparaît donc que, comme en français (Rotomagos > vers
1130 Ruëm > "Rouen",
Les représentants en occitan et français actuels destruire,
construire, conduch, fruch "détruire, construire, conduit,
fruit" contiennent u : cela
nécessiterait un ū long latin. Or les dictionnaires
donnent :
• frŭor, frŭctus ; frūx, frūgis (*frūctum > fruch, "fruit") ;
• -flŭĕre, flūxī, -flūxus (sans dérivé populaire ?) ;
Pour les trois premiers points ci-dessus, il est fort possible qu'on
ait une réalisation
consonantique
du segment final d'un u long. En tout cas, si le u
était parfois bref, il y a dû y avoir homogénéisation analogique
de tout le système, avec l'instauration d'un ū long généralisé.
En position
sans diphtongaison :
ū /
avec diphtongaison devant l :
ū
/
Remarque : le type fuòc /
ŏ > /
En position
ū /
Dans toute la France actuelle
(domaines d'oïl et d'oc) ainsi qu'en Italie du nord, le u
long latin (ū /
(Pour le wallon, voir DDBR:vocalisme§25, LGVW:57 et les simples citations dans LPEPH:213, IPHAF:91).
Selon F. de La Chaussée (IPHAF:91), la voyelle ū
change progressivement son timbre : de /
Trois explications ont été proposées pour expliquer ce phénomène (Pu>ü, source archivée ici) :
- influence du substrat gaulois (le celte ne possédait pas la voyelle /ʋ/ mais possédait bien la voyelle /u/) ;
- perte d'énergie dans l'articulation (IPHAF:91) ;
- érosion d'un système vocalique avec plus de quatre degrés d'aperture
Le débat n'est absolument pas tranché et aucune de ces trois explications ne l'a emporté.
En Gaule du nord, le processus d'antériorisation du u a peut-être commencé au IVe siècle pour s'achever au VIIe ou VIIIe siècle. L'antériorisation du u "a dû commencer après la palatalisation de k, g devant e, i, et même devant a" (IPHAF:69), sinon on aurait eu cūram > *sure ou *chure, et non "cure".
Pour le midi de la France, citons :
"le changement de u en ü n'avait pas été complet en Gaule
dès l'origine ; autrement le c
d'un mot comme cupa (> fr.
"cuve") aurait dû se palataliser (*chuve) ; d'autre part, vers le VIIIe
siècle, le nouveau son ne devait pas être répandu dans tout le midi de
la France, puisque c'est l'époque où le catalan qui conserve u
a commencé à se détacher de l'occitan." (Karl Gebhardt, source archivée
ici).
Les régions où l'on prononce /ë/ au
lieu de /u/, largement représentées dans le
L'antériorisation a aussi agi sur le /ʋ/ des diphtongues, voir effet
de
l'antériorisation du /ʋ/ sur la diphtongaison /ò/ > /ʋò/).
Schéma général :
ū > /
ou s'il y a diphtongaison devant l :
ū > /üò/ ou /yé/
Vers le VIIIe siècle, /ʋ/ devient /u/ comme dans tout le
domaine gallo-roman (antériorisation
du
/ʋ/).
Exemples sans diphtongaison :
|
latin
|
|
occitan
|
| ū /ʋ:/ > | /ʋ/ |
> /u/ |
| -dūcĕrĕ |
-duire (-durre) "-duire" |
|
| -dūcĕt |
-dutz "-duit" (adutz,
condutz...) |
|
| -ūră(m) | -ura (armadura
"armure"...) |
|
| cūră(m) |
cura "cure" |
|
| -dūnŭ(m) (Eberodūnŭm) |
-(s)un ("fort", dans
les noms de ville) (Embrun, a Ambrun "Embrun", 05 ; AO Embrezun) |
|
| frūctŭ(m) | fruch "fruit" |
|
| fūstĕm > *fūstă(m) |
fusta "poutre (fût)" |
|
| jūdĭcĕ(m) | jutge "juget" |
|
| lūcĕ(m) |
lutz "lumière" |
|
| lūcĕt |
lutz "(il) luit" |
|
| lūnă(m) | luna "lune" |
|
| mĭnūtŭ(m) | menut "menu" | |
| mūrŭ(m) | mur "mur" | |
| mūtăt | muda "(il) mue" | |
| nūllŭ(m) | nul "nul" | |
| plūmă(m) |
pluma "plume" |
|
| pūrgăt | purga "(il) purge" | |
| ūnă(m) | una "une" | |
| ūnŭ(m) | un "un" | |
| vĭrtūtĕ(m) | vertut "vertu" | |
Mutation de ū tonique > /ʋ/ > /u/ avec exemples en occitan.
Exemples avec la diphtongaison devant l :
|
latin
|
|
occitan
|
| ū /ʋ:/ > | /ʋ/ |
>
/üò/, /yé/ |
| cŭcūlŭ(m) |
coguòu, coguieu "coucou" |
|
| cūlŭ(m) |
cuòu, quieu "cul" |
|
| mūlŭ(m) |
muòu, mueu "mulet" |
|
| mūlă(m) |
muòla, muela "mule" |
|
Tableau : exemples de diphtongaison ū devant l.
Évolution de /u
Cas de pūlĭcĕm > (AO) piussa, (l) pieuse... "puce"
Je ne pense pas qu'il ait diphtongaison devant l,
mais plutôt une simple vocalisation
de l devant consonne,
puis évolution de /u
Voir d'ailleurs ci-dessous piucèla
en prétonique.
|
latin
|
|
occitan
|
| pūlĭcĕm | (AO) piussa, (l) pieuse... "puce" | |
Tableau : cas de pūlĭcĕm > (l) pieuse...
Schéma général :
ū > /
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| ū /ʋ:/ > | /ʋ/ |
> /u/ |
| frūmentŭ(m)
|
AO fromẹn "froment", voir frūmentŭm (ci-dessus). | |
| Hūgōnĕ(m) |
Ugon "Hugon" | |
| hūmānŭ(m) |
uman "humain" |
|
| jūmentŭ(m) |
AO
jumẹn "bête de somme" |
|
| ūnīrĕ |
unir "unir" |
|
| Ūcĕtĭăs |
Usès "Uzès" |
|
| ūrīnă(m) | (l) urina
"urine" (1) |
|
| Infinitifs avec ū en prétonique initiale : ci-dessous | ||
| fūmārĕ | AO fumar "fumer" | |
Mutation ū prétonique > /ʋ/ > /u/ avec exemples en occitan.
Évolution de /u
Cas de *pūllĭcĕllăm > AO piusęla, OA piucèla "pucelle"
(plutôt que *pŭllĭcĕllăm, voir
discussion FEW 9:526)
Il y a vocalisation
de l devant consonne
puis évolution de /u
Voir ci-dessus piucèla.
|
latin
|
|
occitan
|
| *pūllĭcĕllă(m) | AO piusęla, OA piucèla "pucelle" | |
Tableau : cas de pūllĭcĕllăm > piucèla...
Schéma général :
ū > ∅
(mais ū > u peut être maintenu dans les verbes, ci-dessous)
Exemples :
|
latin
|
|
occitan
|
| co(n)sūtūră(m) | AO costura "couture" | |
| mātūtīnŭ(m) | AO matin "matin" | |
| Infinitifs avec ū en prétonique interne : ci-dessous | ||
| adjūtārĕ | AO ajudar / aidar "aider" | |
Tableau : évolution de ū
prétonique interne
Il s'agit des verbes : il
peut y avoir
•
Infinitifs avec ū en
Pour les infinitifs de type fūmārĕ, le ū est
toujours conservé, de la même manière que les
autres mots avec ū en prétonique initiale (ci-dessus): fūmārĕ
> fumar (GIPPM-1:293), dūrārĕ > durar, jūrārĕ > jurar, mūtārĕ > mudar...
(PHHL:217), sūdārĕ > susar ; de même
pour les verbes de la deuxième conjugaison : lūcērĕ > lusir.
Les formes
•
Infinitifs avec ū en
Voir infinitifs à prétonique longue : on a souvent deux variantes en AO :
adjūtārĕ "aider" > ajudar / aidar
(b.lat.) dĭsjējūnārĕ
> AO dejunar (
mandūcārĕ "manger" > AO mandugar / AO manjar, mengar, menjar...
- variante non syncopée : mandūcārĕ > AO mandugar, manjuiar sont attestés : ces formes conservaient le u comme ajudar ci-dessus (manduc "je mange" PSW ; mandugar EGO sans source ; manduja "il mange" PSW).
- variante syncopée : AO mengar, mingar (fermeture de la
voyelle par influence fermante de m
et ng ; influence de
*pĕrtūsārĕ "percer"
> AO pertuzar / AO persar
(perçar) (ce dernier est un
- variante non syncopée : pertusar.
C'est probablement la seule variante en
AO
(pertuzar) (FEW 8:290b dit qu'on dispose de peu
d'occurrences, ce qui me semble à nuancer pour le moins) ; elle est
obtenue par l'influence des formes
- variante syncopée : perçar
(